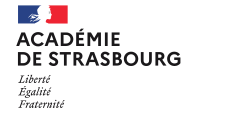Lettres
Contribution des IA-IPR de lettres au projet "Tous en mouvement"
Remarque préalable : on pourra développer des compétences d’expression liées à l’enseignement du français aux différents niveaux du collège :
- En 6ème et en 5ème : expression descriptive et narrative.
- En 4ème : expression écrite explicative
- En 3ème : expression orale et écrite argumentative
I. Evoquer l’antiquité de la question de l’hygiène de vie (Hygeia est une divinité grecque de la bonne santé)
- Evoquer l’adage (extrait de la dixième satire de Juvénal) :
- Eloge de la modération, de la tempérance ; ainsi la frugalitas, la frugalité qui consiste à manger simplement et légèrement est l’une des vertus civiques du mos majorum (= les règles de vie non écrites) des anciens Romains/ / versus les orgies de la décadence…
- Enquêter sur l’hygiène et la médecine antiques, notamment sur la culture thermale des Romains.
II. En 6ème (et en 5ème en cours de Latin sur les trois niveaux) : travail d’enrichissement lexical et/ ou étymologique
- La voracité, la gloutonnerie, la gourmandise etc.
- En contrepoint de la gloutonnerie, le personnage du gourmet, la gastronomie…
- Les termes médicaux et leur étymologie souvent grecque ou latine (aliment, hygiène, boulimie ; aérophagie ; obésité, anorexie…)
- Etymologie de la cuisine, et des termes culinaires :
III. Exploiter des textes pouvant se raccorder aux programmes
- Quelques recettes du traité culinaire d’Apicius (De re coquinaria = De l’art de cuisiner), cuisinier de l’empereur Tibère au début de notre ère.
- Une fable comme « Le Loup et la Cigogne » de La Fontaine.
- Un épisode des Malheurs de Sophie ?
- Un épisode du Roman de Renart ?
- Un conte mettant en scène la gourmandise ou la modération ?
- En 6ème : les textes fondateurs, et références antiques
- Textes bibliques : Gourmandise, septième péché capital…
- La mythologie : thème de l’ogre : Saturne, Chronos
- La gourmandise, thème littéraire ?
- Des sources antiques :
- Enfin le récit de Plutarque (Vie de Lucullus) expliquant le fameux proverbe « Lucullus dîne chez Lucullus » :
[40] XL. Les dîners de Lucullus étaient d'un nouveau riche, même les jours ordinaires; car, non seulement par les tentures de pourpre, les vases incrustés de pierres précieuses, les danses et les intermèdes musicaux, mais par l'extrême raffinement et la variété des plats, il se faisait envier des gens grossiers. En tout cas, Pompée se fit apprécier pendant une maladie, où son médecin lui ordonnait de manger une grive. Comme ses serviteurs lui avaient appris que, dans la saison d'hiver où l'on était, on ne pouvait trouver de grives que chez Lucullus, car il en nourrissait, Pompée ne leur permit pas d'aller en chercher là et dit au médecin : « Donc, si Lucullus ne faisait pas bonne chère, Pompée ne vivrait pas? » Et il se fit préparer autre chose qu'on pût trouver facilement. Caton était l'ami et le familier de Lucullus; mais il lui en voulait tant de sa conduite et de son genre de vie qu'un jeune homme faisant au Sénat, mal à propos, un discours ennuyeux et long sur le luxe et la tempérance, Caton se leva et lui dit : « Ne finiras-tu pas d'être riche comme Crassus, de vivre comme Lucullus et de parler comme Caton? » Selon quelques-uns, ce propos a bien été tenu, mais ce n'était pas par Caton.
[41] XLI. Cependant Lucullus ne prenait pas seulement plaisir à ce genre de vie, il s'en vantait, comme le montrent certains mots qu'on rapporte de lui. Par exemple, des Grecs étant venus à Rome, il les reçut à sa table plusieurs jours de suite; mais eux, par une réaction bien propre à leur race, eurent honte et déclinèrent à la fin son invitation, ne voulant pas qu'il fît chaque jour de si grandes dépenses à cause d'eux. Lucullus leur dit donc en souriant : « Il y a bien une part de ces frais pour vous, messieurs les Grecs; cependant la plus grosse part est pour Lucullus. » Un jour qu'il dînait seul, on n'avait préparé qu'un seul service et un repas modeste. Il se fâcha et fit appeler le serviteur préposé à cet office, qui s'excusa sur le manque d'invités; il n'avait pas cru que Lucullus eût besoin d'un repas somptueux : « Que dis-tu? répliqua le maître; ne savais-tu pas que Lucullus dîne aujourd'hui chez Lucullus? » Comme, naturellement, on parlait beaucoup de cette prodigalité dans la ville, Cicéron et Pompée l'abordèrent une fois sur le Forum où il se délassait. L'un d'eux était un de ses amis les plus intimes; avec l'autre, il y avait eu un conflit à l'occasion de la campagne d'Asie, mais cela n'empêchait pas Lucullus et Pompée de se fréquenter et d'avoir souvent ensemble des conversations courtoises. Cicéron, donc, salua Lucullus affectueusement et lui demanda s'il était satisfait de cette rencontre : « On ne peut plus », répondit Lucullus, et il lui demanda de prolonger l'entretien. « Nous voulons, dit alors Cicéron, dîner aujourd'hui chez toi, mais sans plus d'apprêts que si tu étais seul. » Comme Lucullus faisait des façons et leur demandait de lui fixer un jour, ils s'y refusèrent formellement et ne le laissèrent même pas parler à ses serviteurs, de peur qu'il n'ordonnât un menu plus abondant. Sur sa demande, ils lui permirent seulement de dire à un esclave devant eux, qu'il dînerait aujourd'hui dans la salle d'Apollon, l'une des plus riches de sa maison. C'était là un stratagème, qui trompa les deux invités. Car, à ce qu'il paraît, pour chaque salle à manger, le prix du repas était fixé d'avance. Chacune avait son installation et son service particulier, de sorte que les esclaves, en apprenant où Lucullus voulait dîner, savaient ce qu'il fallait dépenser, de quel ordre devaient être l'appareil et l'ordonnance du festin. Lucullus avait l'habitude, dans la salle d'Apollon, de dépenser cinquante mille drachmes; et c'est ce qu'il fit ce jour-là. Aussi Pompée et Cicéron furent-ils stupéfaits de la rapidité des apprêts, quand la dépense était si grande. Voilà donc l'arrogance avec laquelle Lucullus traitait la richesse, comme une Barbare en captivité chez lui.
à télécharger
- TOUS EN MOUVEMENT Contribution des IAIPR de lettres(docx, 22 Ko)