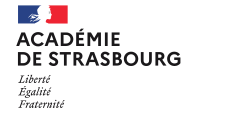1.1. Un journal de lecture, pour quoi faire ?
De même que l’on trouve différents termes pour parler de journal de lecture1, ses usages en sont multiples. De plus, comme le note Sylviane Ahr2, le journal de lecture apparaît comme un “objet hybride”, “tantôt objet scolaire, tantôt objet personnel proche du journal intime”.
Ce double aspect est bien visible dans les récents accompagnements de programmes du lycée :
L’idée générale du carnet […] est de favoriser le travail autonome de l’élève. [Il est] le moyen d’une étude active de l’œuvre, impliquant les élèves et facilitant l’appropriation d’œuvres patrimoniales qui peuvent leur sembler très lointaines. Les activités proposées visent à intégrer, dans la lecture littéraire, la part de plaisir qui se trouve dans les lectures personnelles ou choisies, en proposant une sorte de tiers lieu favorisant l’appropriation des œuvres par les élèves et leur engagement personnel dans la lecture et l’interprétation.
On rejoint ici un usage du journal de lecture que Sylviane Ahr, pratiquant une recension des pratiques effectives de classe, définit comme “consensuel”.
Favorisant le plaisir de lire, [le journal de lecture] constitue un espace de liberté pour les lectures que les élèves réalisent, majoritairement malgré tout, dans le cadre scolaire.
Ce “tiers-lieu” que serait le journal de lecture s'incrit dans un candre contraignant3 et offre de riches potentialités mais il est parfois difficile pour les enseignants de l'appréhender aisément4.
Le journal de lecture fait d’ailleurs émerger la nécessité de ré-interroger nos représentations de la lecture de la littérature chez les élèves, comme le rappelle S. Ahr :
L’utilisation de cet outil s’appuie-t-il sur des savoirs de référence clairement circonscrits, sur une conception de la lecture de la littérature clairement identifiée ?
Les orientations qu’elle adopte vis-à-vis du journal de lecture renvoient à une lecture perçue comme cheminement. A la métaphore du journal intime, celle-ci préfère celle du journal de voyage, journal de bord des lectures, ou plutôt des apprentissages de la lecture si on suit Monique Lebrun5 qui dans un chapitre datant de 1996, expliquait que :
le journal est un exercice régulier d'écriture où le rédacteur se considère, en tant que lecteur, comme objet d'observation ; ce n'est donc pas un journal intime, au sens habituel du terme, mais un journal d'apprentissage.

Dans l’expérimentation que nous avons menée cette année, nous appuyant sur le travail de Manon Hebert6, nous avons considéré le journal de lecture comme
une écriture de travail libre, transitoire et éphémère; avant tout au service de l’élaboration de la pensée et de l’échange des opinions et qui, idéalement, devrait permettre à l'élève d’opérer un retour sur le chemin parcouru entre son interprétation spontanée initiale et son interprétation finale et/ou celle des autres.
Tenir un journal de lecture, permet au jeune lecteur de développer ses compétences. Dans un article intitulé “Cahier et débat dans le second degré : pour un apprentissage de la lecture littéraire”, Sylviane Ahr, Agnès Brunet, Cécile Couteaux et Françoise Ravez détaillent la façon dont le journal de lecture participe de la formation du lecteur. Celui-ci est défini comme un espace :
-
pour apprendre à questionner sa lecture
-
pour devenir un lecteur critique autonome
-
pour construire des compétences énonciatives et langagières
Dans l’expérimentation menée cette année, en nous appuyant sur les travaux de Manon Hébert, nous avons fait le choix de guider le travail de rédaction des élèves à travers l’apprentissage explicite de sept stratégies de lecture (Prédire, Se questionner, Ressentir, Visualiser, Découvrir, Faire des liens, Juger) permettant de faciliter la verbalisation, de soutenir une lecture esthétique et critique des œuvres lues et de développer les compétences de lecture des élèves du secondaire.
Notes
- On parle de carnet de lecture, ou de lecteur, de journal de lecteur ou de lecture. C’est ce dernier terme que nous avons retenu.
- “De quelques usages du carnet/journal de lecteur/lecture dans le second degré”, Disptyque 25
- Écrire pour lire : le carnet de lecture subjective, Jean-François Massol et Caroline Esposito
- En témoigne également le relevé des usages fait par Sylviane Ahr en 2012.
- Lebrun, M. (1996a). Un outil d'approriation du texte littéraire: le journal dialogué . In J.-L. Dufays, L. Gemenne et D. Ledur (dir.), Pour une lecture littéraire 2: Bilan et confrontations, (p. 272-281).
- Manon Hébert, Co-élaboration du sens dans les cercles littéraires entre pairs en première secondaire : étude des relations entre les modalités de lecture et de collaboration