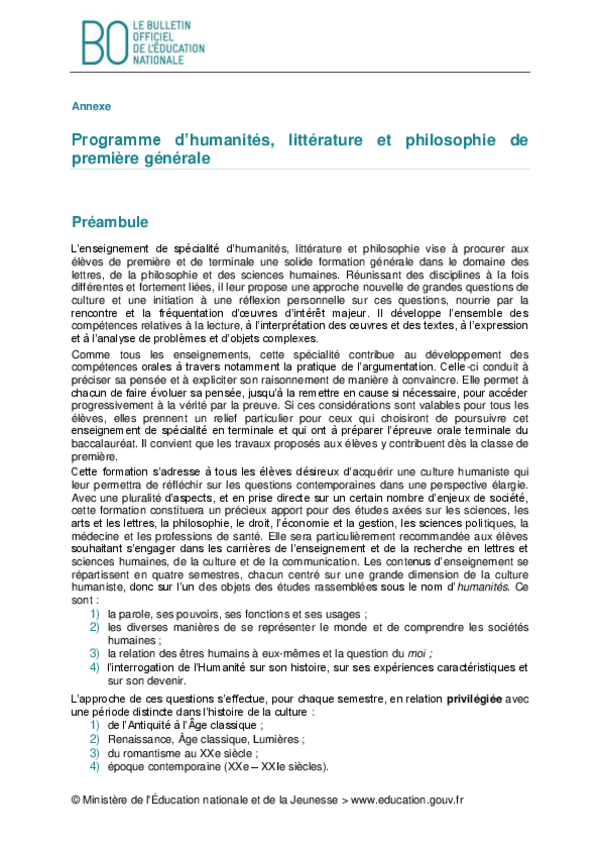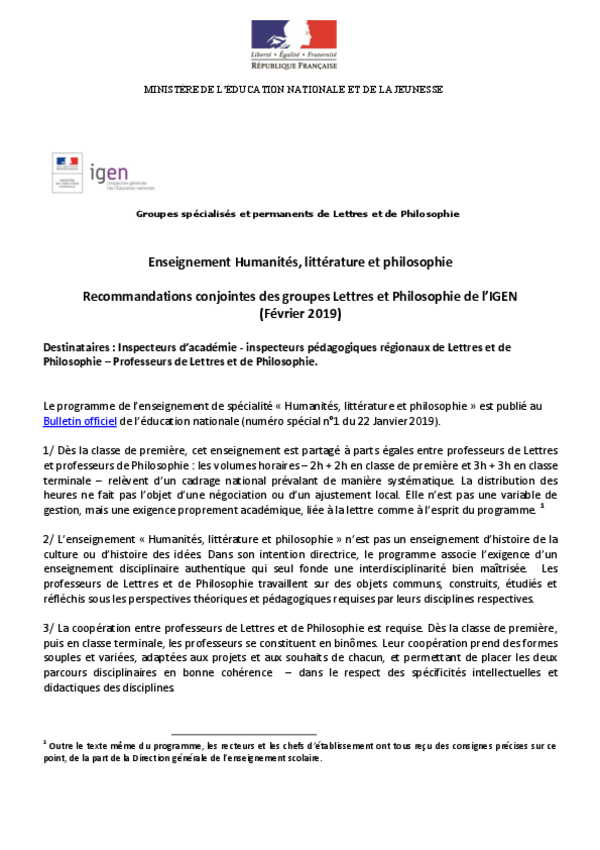Ressources Spécialité HLP
Conférence de Yann Martin: l'humanité en question
Diverses ressources
Les représentations du monde
1) Découverte du monde et pluralité des cultures. Cyrano de Bergerac, les Etats et Empires de la lune
Thème : « Les représentations du monde »
Sous-thèmes : « Découverte du monde et pluralité des cultures » ;
« Décrire, figurer, imaginer » ;
« L’homme et l’animal »
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cyrano DE BERGERAC (1619-1655) : Les Etats et Empires de la Lune
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INTRODUCTION GENERALE
⸻ Lecture page 45 ⸻
⸻ Distribution du plan et rapide résumé, sans analyse, de la trame principale ⸻
⸻ Echange général sur l’œuvre ⸻
Comment qualifier l’œuvre ?
Une œuvre baroque :
Participent ici au mouvement baroque un style très travaillé, des fantaisies débridées, surchargées et bigarrées, des personnages pleins de relief mais sans profondeur. Le baroque, c’est de l’exubérance sobre, de la sobriété exubérante, un contenu sobre dans l’écrin d’une forme exubérante.
Une œuvre de pluralité :
A propos du titre : pourquoi le pluriel ? Mis à part l’Eden, un seul empire est décrit sur la Lune [bien qu’il y en ait plusieurs : cf. p104- à propos des guerres].
Il est probable que les termes « Etats et Empires » doivent être pris au sens large comme « domaine » [« état » avec un petit « e », de ce fait] : en effet dans l’œuvre s’opposent les états de grâce, de disgrâce (cf. Eden), de science, d’ignorance, de paix et de guerre, etc. L’œuvre est en ce sens une œuvre de pluralité.
Une œuvre d’altérité :
Le nourrisson qui ne connaît que lui-même, à travers ses impressions primitives, ne connaît que l’identité. Mais en grandissant, il va peu à peu élargir le cercle de son observation, et s’apercevoir que ses parents, les insectes et animaux de compagnie qui l’entourent, ou encore les autres enfants, ne sont pas lui, et qu’ils sont différents de lui. Lui-même va apprendre à relativiser sa propre existence (stade du miroir, Lacan), à ne plus se voir comme le centre du monde.
Le roman de Bergerac nous fait sentir comme des enfants en ce qu’il nous fait revivre cette initiation du décentrement, et de manière extrême, car ici, il ne s’agit pas d’ouvrir la porte de sa maison, ni même de voyager dans d’autres pays, mais carrément sur une autre planète.
Une œuvre d’identité :
Mais l’œuvre reste réaliste, et ne fait pas de la lune une utopie exagérée. Elle a, comme la terre, ses défauts et ses tyrans. L’autre n’est au fond pas si différent de moi, et je suis un autre pour l’autre moi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AU DELA DU GEOCENTRISME
Le roman débute par une insulte jetée à la face du lecteur : Vous n’êtes pas des humains, mais des cafards, des aliens, des étrangers, et vous vous trouvez dans un coin poussiéreux et reculé de l’univers ! Voilà la vérité que depuis Copernic (1473-1543) l’homme occidental (incarné dans le roman par le vice-roi du Canada puis par certains Lunaires) a du mal à admettre, même aujourd’hui (chacun de nous se considère involontairement et irrépressiblement comme le centre du monde). Pourquoi un tel refus d’admettre la vérité ?
Deux obstacles provoquent et provoqueront toujours l’hésitation à rejeter le géocentrisme (théorie selon laquelle le soleil tourne autour de la terre) :
1) OBSTACLE PERSPECTIVISTE.
Quand je me trouve sur Terre, il n’est pas absolument faux de dire que la terre est plate (car je ne vois pas de courbure à l’horizon), qu’elle est immobile (je ne la sens pas bouger sous mes pieds) et fixe (je vois le soleil se déplacer, pas la terre).
En effet, toute perception dépend des circonstances qui l’entourent, et particulièrement la perception du mouvement. Le mouvement n’est qu’un changement de position entre deux choses : il peut donc être difficile de savoir laquelle de ces deux choses est restée immobile, et laquelle a quitté sa position. Il est indéniable pour tout le monde que le Soleil change de position par rapport à la Terre. Cependant, si on considère que la terre est fixe, c’est le soleil qui doit se mouvoir, alors que si on considère que le soleil est fixe, c’est la terre qui doit se mouvoir. Autrement dit, à partir d’une seule et même OBSERVATION, les deux INTERPRETATIONS sont aussi cohérentes et légitimes l’une que l’autre !
Comment trancher alors ? Il faut soit :
- comparer avec d’autres éléments. Par exemple, on observe que les étoiles tournent aussi toutes autour de la terre, à même vitesse et alors même qu’elles sont à différentes distances d’elle, ce qui incline à penser que c’est plutôt la terre qui tourne.
- changer de perspective d’observation, pour rectifier son interprétation, d’où la nécessité pour le narrateur de voyager en dehors de la Terre. Le voyage spatial est bien la méthode la plus simple pour savoir si le soleil tourne vraiment autour de la terre, et si la lune ne serait pas une terre, comme notre terre une lune.
[Cependant attention, Bergerac se perd lui-même à ce jeu. p47-s : le narrateur s’élève verticalement de Paris, puis, redescendant d’une façon tout aussi verticale, atterrit au Canada : cela est censé prouver pour Bergerac le mouvement de la Terre. Mais dans la réalité au lieu du roman, il serait atterri à son point de départ à Paris, car avec la Terre, c’est aussi l’atmosphère terrestre tout entière qui se déplace et qui aurait entraîné la montgolfière. Si l’atmosphère ne se mouvait pas, et la terre si, nous serions constamment balayés de rafales allant toutes dans le même sens, d’Est en Ouest, et à plus de 1700 km/h !]
2) OBSTACLE ANTHROPOCENTRISTE.
L’anthropocentrisme, c’est la théorie d’après laquelle l’homme est au centre de l’univers (géocentrisme) et surtout en constitue le but principal : le soleil serait là pour nous réchauffer, les vaches pour nous donner du lait, les fruits pour nous nourrir, etc. [cf. p53 : l’anthropocentrisme est défini comme « l’orgueil insupportable des humains, qui leur persuade que la Nature n’a été faite que pour eux ; comme s’il était vraisemblable que le Soleil, un grand corps, quatre cent trente-quatre fois plus vaste que la Terre, n’eût été allumé que pour mûrir ses nèfles [un fruit d’hiver] et pommer ses choux [donner aux choux une belle forme de pomme, aux feuilles resserrées] ».
C’est une théorie qui nous rassure (Dieu prendrait soin de nous), et flatte notre orgueil (nous serions le petit bijou d’un vaste univers qui n’en serait que l’écrin).
Le narrateur oppose deux arguments à l’anthropocentrisme du vice-roi :
Premièrement (p50), il révèle une contradiction interne. En général, la nature place au centre, non ce qui reçoit la vitalité (pulpe, chair, et donc ici la Terre), mais ce qui prodigue la vitalité (noyau, parties génitales, et donc ici Soleil). L’anthropocentriste se contredit donc en voulant soutenir à la fois que la Terre reçoit la vitalité et qu’elle est au centre du système solaire.
Deuxièmement (p53), le narrateur remarque qu’il serait étrange, car peu économique, que le Soleil ne soit là que pour la Terre, quand les autres globes seraient laissés à l’abandon d’un Dieu stupide qui les aurait créés sans raison.
Jusqu’ici le narrateur conserve une forme de finalisme, car il affirme que la Nature ne fait pas tout que pour l’homme, mais qu’elle fait quand même certaines choses pour lui.
Mais dans un autre passage (p53) il semble abandonner son finalisme, en affirmant que « si ce Dieu visible [le Soleil] éclaire l’homme, c’est par accident [par hasard], comme le flambeau du roi éclaire par accident au crocheteur qui passe par la rue. » Autrement dit, nous avons de la lumière parce qu’il y a un soleil, mais ce n’est pas pour que nous ayons de la lumière qu’il y a un soleil.
Le narrateur, pour éradiquer l’anthropocentrisme, va même jusqu’à soutenir que, si chaque étoile est un soleil, et chaque astre une Terre, il y a des chances que l’univers soit infini.
p54 : L’infini est certes incompréhensible (je ne peux pas m’en former une image), mais le néant, qui cernerait un monde fini, l’est bien plus. Je ne peux pas comprendre un monde infini, mais une partie de monde infini, alors que je ne peux même pas comprendre une partie de néant (l’air, le vide, le noir, sont encore quelque chose, et donc ne sont pas le néant).
-------------------------------------------------------------------------------------
SUR LE PODIUM DE L’UNIVERS, QUELLE PLACE TERRE ET LUNE OCCUPENT-ELLES ?
Comment Bergerac parvient-il à faire de la Lune un astre éminemment mystérieux et non étiquetable, ni utopie, ni dystopie ?
La philosophie infinitiste de Bergerac laisse sous-entendre l’existence d’une infinité de mondes, mais l’œuvre n’en présente, directement ou indirectement, que quatre : La Terre, la Lune, l’Eden, et le Soleil. Il est indéniable que l’Eden est le plus parfait des quatre, et que le Soleil arrive en second. Mais la hiérarchisation de la Terre et de la Lune est beaucoup plus nuancée et ambiguë.
Deux critères sont à envisager pour hiérarchiser la Terre et la Lune :
- l’identité ou la différence DE NATURE (apparence physique, coutumes, etc.) ;
- l’égalité, la supériorité ou l’infériorité MORALE.
Ce qui est identique de nature ne peut pas être supérieur ou inférieur d’un point de vue moral, mais seulement égal. Il reste donc quatre combinaisons possibles :
1- La Lune est différente de nature et supérieure moralement à la Terre :
- elle abrite l’Eden ; elle est l’endroit que Dieu a élu pour placer les deux premiers êtres humains.
- sur bien des points, les Lunaires sont supérieurs aux Terriens. ex : leur manière plus loyale de faire la guerre ; leur science supérieure.
2- La Lune est différente de nature mais égale moralement à la Terre :
La Lune est le reflet symétrique de la terre, un « monde renversé » (p130, dit le narrateur), un monde miroir, ni meilleur ni pire. Ex : Villes terriennes immobiles VS villes lunaires mobiles ; Terriens sur deux pattes VS Lunaires sur quatre pattes ; Nourriture terrienne de matière VS nourriture lunaire d’odeurs, etc. ; sur Terre on tue les athées par le feu, et sur la Lune on les noie (p 109).
3- La Lune est identique de nature et égale moralement à la Terre :
Les Lunaires prennent le narrateur pour un animal comme les Terriens européens ont pris les amérindiens ou les noirs pour des animaux.
4- La Lune est différente de nature et inférieure moralement à la Terre :
La conclusion de l’œuvre postule que la lune serait l’exil des impies, parce que :
- p160 : Dieu a voulu séparer ces impies des terriens de bonne volonté, afin que les premiers n’empêchent pas les seconds de progresser sur la voie de la rédemption.
- p160 : Dieu n’a pas envoyé Jésus sur la Lune, car, comme il est omniscient, il savait qu’ils rejetteraient tous Jésus, et qu’ils deviendraient donc encore plus condamnables à ses yeux.
-La lune abrite l’Antéchrist lui-même, ce personnage mystérieux qui aurait prêché la négation de l’Evangile.
Mais cependant, peut-être le narrateur est-il dans l’erreur, retombé qu’il est à ce moment de l’œuvre sur la planète Terre (et donc symboliquement dans les anciens préjugés géocentristes).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LE JARDIN D’EDEN
Comment unifier nouveauté et ancienneté, et placer sur la Lune, sans décevoir le lecteur qui s’attend à une découverte inédite, le vieil et bien connu jardin d’Eden ?
Bergerac provoque la surprise chez le lecteur en plaçant l’Eden sur la Lune. Le voyage sur la Lune se révèle donc être autant un voyage dans l’espace que dans le temps, une régression à l’origine de l’humanité et de l’univers.
D’ailleurs, cela rentre presque en contradiction avec la lutte de Bergerac contre l’anthropocentrisme, de placer le centre de tout, certes non sur terre mais sur la Lune…
[ Résumé de la Genèse : Dans l’Ancien Testament, le jardin d’Eden, ou paradis terrestre, est le lieu béni où Dieu créa les deux premiers humains, Adam et Eve. Il y plaça deux arbres, l’arbre de vie, garant de leur immortalité et de leur bonheur, et l’arbre de Science, que cependant il leur interdit de toucher. Eve, dupée par Lucifer déguisé en serpent, céda à la tentation et en mangea le fruit, puis le donna à Adam.
Le fruit de la connaissance les sortit à jamais de leur inconscience heureuse, et ils furent bannis à jamais de l’Eden, condamnés à souffrir et à mourir. ]
Bergerac développe astucieusement cette mythologie et l’adapte à la Lune et au récit :
Par exemple, l’arbre de vie sauve le narrateur de sa chute (p59), et explique l’immortalité d’Enoch et d’Hélie. De toute façon, la seule présence à l’Eden suffit à rajeunir littéralement le narrateur (p61).
Adam aurait tellement craint la fureur de Dieu suite à leur désobéissance, que pour fuir il se serait élevé vers la Terre, seul lieu suffisamment éloigné de son courroux.
De manière générale, l’Eden est un lieu archétypal, un moule déterminant la forme et la réalité des choses terrestres qui n’en sont que le reflet. Ex :
- La foudre a pour origine le mouvement de l’épée flamboyante des chérubins qui protègent l’Eden. (p71-72). La foudre nous remémorerait donc peut-être notre ancien péché et pour cette raison provoquerait notre terreur. [+ les arcs-en-ciel seraient des répercussion atmosphériques dégradées de la foudre (p72)].
- Le « coton de Notre-Dame », ce « je ne sais quoi de blanc qui voltige en automne » (p73) est la bourre dont Enoch qui tisse se débarrasse.
- Achab qui aborde la lune est cause du caractère « lunatique » de la femme sur Terre.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’ARBRE DE SCIENCE ET SON FRUIT
Quel est le rapport dialectique, fait d’affinités et de conflits, de rebondissements et de détours, de l’homme à la connaissance ? En quoi la connaissance humaine est-elle autant diabolique que divine ?
La genèse offre un riche symbolisme là-dessus :
- Le fruit de la science est interdit par Dieu = il y a quelque chose de sacrilège dans la connaissance. C’est tenter de rejoindre l’omniscience de Dieu lui-même. Les savants actuels ne ressemblent-ils pas à des demi-dieux, capables de manipuler l’atome, l’ADN, et d’envoyer des sondes spatiales aux confins de la galaxie ?
- Goûter le fruit fait perdre l’Eden à Eve, à Adam, et à leurs descendants = la connaissance rend malheureux, par opposition à l’insouciance bénie de l’animal. Et tout être humain naît pécheur parce qu’il naît désireux, et désireux de connaître.
Bergerac développe ce symbolisme, et littéralement, et métaphoriquement, en dotant le fruit d’une écorce (dans la Genèse, il n’est d’ailleurs jamais dit qu’il s’agit d’une pomme, mais en latin fruit = pomum, et pomme = malum : Bergerac choisit d’ailleurs de parler de « pomme » p70). Manger la chair du fruit rend savant, mais en goûter l’écorce rend ignorant et même oublieux du savoir appris. [p72 : « la plupart des fruits qui pendent à ce végétant sont environnés d’une écorce de laquelle si vous tâtez, vous descendrez au-dessous de l’homme, au lieu que le dedans vous fera monter aussi haut que l’ange. »]
=> Hyp 1: l’écorce, c’est le livre ou le problème extérieur qui se pose à l’intellect ; la chair, la vérité. Trop lire produit souvent un docte stupide, un simple érudit, qui s’intéresse plus à la forme littéraire des vérités qu’aux vérités elles-mêmes qu’il a par là oubliées.
Hyp 2 : Parfois aussi certains ne franchissent pas l’écorce = incapables de percer le sens d’une vérité.
Hyp 3 : On pourrait peut-être prolonger la métaphore et parler du noyau du fruit, qu’il ne faut pas atteindre, sous peine de se casser les dents…
Selon Bergerac, Dieu aurait frotté les gencives d’Adam avec cette écorce lors de son expulsion (p 70) ; par là il perd la force de ses pouvoirs magiques (ex : quand il s’élève de la Lune vers la Terre) et oublie le chemin pour retrouver l’Eden (que le narrateur trouve tout de même par pur hasard !) => Hyp : Le progrès scientifique de l’humanité correspond probablement à une réminiscence de la sagesse perdue d’Adam.
Cette sagesse sacrilège mais parfaite nous laisse rêveur ! : cf. p71 le récit d’Hélie qui goûte le fruit : « Je m’adressai par bonheur à l’une de ces pommes que la maturité avait dépouillée de sa peau, et ma salive à peine l’avait mouillée que la philosophie universelle m’absorba. Il me sembla qu’un nombre infini de petits yeux se plongèrent dans ma tête, et je sus le moyen de parler au Seigneur. »
-------------------------------------------------------------------------------------
ANIMAL OU HOMME ?
Le perspectivisme touche les théories astronomiques, mais aussi bien les théories anthropologiques terriennes et lunaires. Un extraterrestre est-il un homme ou un animal, et en fonction de quels critères ?
Dans le roman, c’est à la fois le narrateur et les lunaires qui constituent réciproquement des juges et des objets de jugement.
Le jugement du narrateur sur les Lunaires évolue rapidement ; en l’espace d’un paragraphe (p73-74), il voit graduellement ses ravisseurs comme de « grands animaux », des « faunes », des « bêtes-hommes », puis enfin comme des « hommes », dont toutefois la particularité est de marcher sur quatre pattes. Le narrateur passe d’un jugement faux basé sur le seul physique à un jugement plus juste basé sur leur comportement organisé et l’existence de leur ville.
Mais peut-on en vouloir à quiconque de juger d’abord d’après l’apparence ? Comment jugerions-nous un homme sans tête, un homme violet, ou un crabe qui fait des mathématiques ? La perception d’une différence pousse forcément à juger que l’autre est différent : il faut du temps pour reconnaître l’identité (psychique) au-delà de la différence (physique). L’essentiel n’est pas de bien juger du premier coup, mais de rectifier son jugement.
Les Lunaires seront beaucoup plus longs à reconnaître la nature humaine du narrateur. [Y aurait-il influence de l’effet de groupe ? Car en effet, le démon remarque avec justesse qu’un Lunaire parvenu sur terre aurait été méprisé et tué comme un animal.] [Les Lunaires doivent connaître certains animaux car p65 il est précisé que mille se sont échappé du bateau de Noé en direction de la Lune…]
Eux le considèrent successivement comme :
- « la femelle du petit animal de la reine » (p76), un Espagnol précédemment capturé, pris pour un « singe » (p91). Le narrateur a-t-il moins de barbe ou est-il plus efféminé que lui ? [p 92 : Les Lunaires essaient même de les faire se reproduire !] [+ p88 le patron de l’auberge le prend pour un « magot »].
- un « perroquet plumé » (p102) à cause de la bipédie. C’est là une reprise implicite de la critique par Diogène le chien de la définition platonicienne de l’homme comme « bipède sans plumes », qui convient effectivement aussi bien à un homme qu’à un poulet plumé !
- une « espèce d’autruche » (p104) à cause du port droit du cou.
Les arguments des Lunaires contre l’humanité du narrateur ne sont pas dénués de fondement, mais étonnant, car ils considèrent comme défauts ce qui précisément pour un Terrien est avantage :
ARGT 1 - p 101 : La bipédie n’est pas le signe d’une distinction d’avec les animaux (qui peuvent être bipèdes (oiseaux) ou semi-bipèdes (singes)), mais la marque du mépris de Dieu qui a placé le terrien, si instable sur ses deux jambes, dans un état de déséquilibre et donc de fragilité, car si les oiseaux sont bipèdes, ils sont, en compensation, ailés. Le narrateur se demande (p76) si ce ne serait pas la culture humaine, plutôt que Dieu, qui aurait défiguré sa nature originelle : après tout, un bébé marche bien à quatre pattes, et si on ne le forçait à rien d’autre, finirait-il vraiment par marcher sur deux ? La culture participe-t-elle au développement de l’humanité, ou l’entrave-t-elle ?
ARGT 2 - p102 : Le pouvoir qu’a l’homme de dresser le cou pour contempler le cel indique sa volonté de communiquer avec Dieu. Mais, alors que pour les Terriens c’est une marque de supériorité et d’élection divine, c’est pour les Lunaires la preuve que les Terriens ont à se plaindre de leur condition au ciel, au lieu, comme eux, de rendre grâce à la terre de la leur.
ARGT 3- Le fait que le narrateur accomplisse des actions alambiquées et même apprenne à parler leur langue ne les impressionne pas, car en effet, un perroquet parle sans pour autant raisonner, et les animaux peuvent faire des choses incroyables, mais seulement par instinct, c’est-à-dire par automatisme (p103).
Mais les Lunaires sont loin d’être irréprochables, puisqu’ils doivent recourir à la censure de l’opinion du peuple (p103) et à la menace d’une exécution (p109), car le narrateur se met à affirmer que leur Terre n’est qu’une Lune.
C’est donc à l’habitant du soleil d’instruire ceux de la Lune. Son intervention in extremis au tribunal sauve le narrateur, et représente une critique par Bergerac du fanatisme religieux occidental et de l’esclavagisme africain et américain. Voici ses arguments :
ARGT 1 (p110) - (= Critique de l’Inquisition, qui torturait les hérétiques pour les forcer à croire en Dieu.) On peut forcer quelqu’un à dire ce qu’il ne pense pas, mais pas à penser ce qu’il ne pense pas. La liberté de penser est inaliénable, mais même aussi, en un sens incontrôlable : je ne suis pas responsable de mes convictions, et je ne peux pas me forcer à être convaincu de quelque chose, car la conviction dépend de la raison, pas de la volonté. On ne peut donc pas m’accuser de quelque chose qui ne relève pas de mon pouvoir.
ARGT 2 (p110-111) - Si le narrateur n’est qu’un animal, il est donc mû par l’instinct, et n’est donc pas responsable de ce qu’il dit. On ne reproche pas à un chien d’aboyer plutôt que de miauler.
ARGT 3 (p111) - Mais si vous considérez que le narrateur est un animal doué de raison, et bien il n’en demeure pas moins un simple animal, sans importance, dont il ne faut pas se soucier. [lecture p111 : l’homme ne cherche pas à régler le comportement de fourmis !]
Le narrateur est donc libéré, mais moins parce qu’on a reconnu sa liberté de penser et de parler [on le force d’ailleurs à se dédire (p112)], que parce qu’on le considère comme un animal irresponsable ! Ce n’est donc pas parce que, par exemple, les noirs ne sont plus soumis à l’esclavagisme, qu’on les reconnaît forcément comme des hommes…
-------------------------------------------------------------------------------------
LE DEMON DU SOLEIL
Comment conceptualiser l’esprit, via la fiction d’un être exclusivement spirituel ? Quelle est la nature de l’esprit et de ses rapports avec la matière ?
P77-82, le narrateur fait la rencontre d’un habitant du soleil, qui lui parle de son histoire, mais aussi de sa nature.
Les habitants du soleil sont ce que les humains appellent illusoirement des « esprits » ou êtres « immatériels », pour la raison qu’ils ne tombent sous aucun des cinq sens. Mais ce n’est pas parce que je ne peux pas capter quelque chose par mes sens que cette chose est forcément immatérielle : on ne laisserait pas un aveugle-né affirmer que la couleur est immatérielle sous prétexte qu’il ne la voit pas !
Ainsi, « il n’y [a] rien dans la nature qui ne [soit] matériel » (p81). Par conséquent, même l’esprit est fait de matière, mais d’une matière très fine et subtile (conséquence probable du milieu de vie brûlant et destructeur qu’est le soleil). Si nous avions un sixième sens, que verrions-nous donc ?
Bergerac critique ici la vanité humaine, qui préfère déclarer insaisissable en soi ce qui n’est insaisissable que pour ses sens. Il critique aussi la tendance qu’ont les philosophes et scientifiques à chercher une réponse par la réflexion là où il n’y a en réalité qu’une réponse par la perception sensible : les philosophes sont comme des aveugles-nés s’imaginant pouvoir trouver, en réfléchissant seulement, ce qu’est la couleur. La science repose donc plus essentiellement sur la sensation que sur la réflexion. Le plus grand génie de l’univers, s’il ne possède aucun sens, sera incapable de trouver la vérité.
Les habitants du soleil peuvent prendre trois formes pour les humains :
1) Leur forme naturelle d’esprit matériel mais insensible aux cinq sens humains. Ils vivent 4000 ans.
2) Une forme semi-sensible, accessible à tel ou tel autre sens humain exclusivement (ouïe = oracle ; vue = spectre ; toucher = incubes [+odorat ? goût ?]. Sous cette forme, notre démon raconte, entre autres, avoir été le démon de Socrate : Socrate en effet prétendait mystérieusement entendre des voix et être guidé comme par un ange gardien et sage.
3) Une forme sensible et humaine, par incarnation. Dans le roman, notre démon incarne successivement un vieillard puis un jeune homme.
D’après le roman, nous serions donc potentiellement entourés de ces êtres imperceptibles, qui se ne manifestent toutefois qu’à ceux qui le méritent par leur sagesse ou leur bonté. Ces êtres ne sont pas des anges, mais tout comme, puisqu’ils colonisent d’autres planètes et améliorent leurs habitants. Ils seraient la source de l’inspiration des grands artistes, philosophes et même magiciens [p78 : Agrippa, les Rose-Croix, Faust, etc.].
Toutefois, sont-ils si bons que cela ? Après tout, leur intention première n’est que de décharger leur astre surpeuplé (p80). De plus, il leur arrive de faire du mal, aux hommes (fantômes, incubes, etc.), qui, il est vrai, l’ont peut-être mérité, mais aussi à eux-mêmes, car le Soleil n’est que presque totalement exempt de guerres.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) Exemple de textes
Les représentations du monde
Propositions de textes philosophiques
1ère partie : les changements de la représentation du monde à partir de la Renaissance
- La Théogonie d’Hésiode, VIIIème av JC. :
Au début régnait Chaos et l’espace était fait de vide. Puis, il y eut Gaïa, l’ancêtre de la terre. Ensuite vint Tartaros, l’abîme, et Éros, la force de l’amour : Éros l’éternel. De Chaos vint Erèbe et la noire Nuit. Et de Nuit, à son tour sortirent Éther et Lumière. Gaïa enfanta le ciel (Ouranos) et développa la terre. Ainsi fut créé le monde. Le ciel et la terre avaient une charpente solide, la mer se jetait sur la rive de la terre. Toutes sortes de créatures peuplaient la terre ; les poissons s’ébattaient dans les vagues, les oiseaux dans le ciel et des animaux de toutes les espèces se pressaient sur le sol d’un pas agile. Mais manquait encore à cette création celui qui dominerait de son esprit ce large monde. Alors, Prométhée arriva sur terre. Il prit de l’argile et façonna un modèle à l’image des dieux. Il enferma dans sa poitrine les attributs du bien comme du mal, ceux que l’on trouve dans l’âme de chaque créature vivant sur cette terre. Ainsi forma-t-il l’âme humaine. La déesse Athéna, son amie céleste, admirant l’ouvre de Prométhée, insuffla la vie aux humains et leur donna l’esprit.
- La genèse (version abrégée), traduction Louis Segond (1910) :
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide : il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme, et l’esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne ; et Dieu sépara la lumière d’avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le premier jour.
Dieu dit : Qu’il y ait une étendue entre les eaux, et qu’elle sépare les eaux d’avec les eaux. Et Dieu fit l’étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l’étendue d’avec les eaux qui sont au-dessus de l’étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l’étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le second jour.
Dieu dit : Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l’amas des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit : Que la terre produise de la verdure, de l’herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l’herbe portant de la semence selon leur espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le troisième jour.
Dieu dit qu’il y ait des luminaires dans l’étendue du ciel, pour séparer le jour d’avec la nuit ; que ce soient des signes pour marquer les époques, les jours et les années ; et qu’ils servent de luminaires dans l’étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit ; il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l’étendue du ciel, pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d’avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le quatrième jour.
Dieu dit : Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l’étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce ; il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit, en disant : Soyez féconds, multipliez, et remplissez les eaux des mers ; et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le cinquième jour.
Dieu dit : Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu’il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l’assujettissez ; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit : Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d’arbre et portant de la semence : ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu’il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le sixième jour.
Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre, qu’il avait faite : et il se reposa au septième jour de toute son œuvre, qu’il avait faite. Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu’en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu’il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés.
Lorsque l’Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n’était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore : car l’Éternel Dieu n’avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n’y avait point d’homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s’éleva de la terre, et arrosa toute la surface du sol. L’Éternel Dieu forma l’homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l’homme devint un être vivant. Puis l’Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l’orient, et il y mit l’homme qu’il avait formé. L’Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l’arbre de la vie au milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et du mal...
Par contraste avec les mythes, un texte scientifique contemporain qui résume la vision actuelle de l’origine de l’univers : Aurélien Barrau, Big bang et au-delà, les nouveaux horizons de l’Univers, 2013, p. 9-11.
L’Univers a 13,81 milliards d’années.
Au commencement il n’y avait ni temps, ni espace, ni aucune particules aujourd’hui identifiées. N’existait qu’une sorte de mousse constituée de cordes ou de boucles. Cette mousse enfle et se complexifie. l’espace, le temps, la gravitation émergent. Une force unifiée régit alors l’Univers dont la taille commence à croître démesurément. Cette brève, mais immensément intense, phase d’inflation cesse brutalement. S’y dessinent les fluctuations microscopiques à l’origine des galaxies et des étoiles… Apparaissent les forces et corpuscules connus. La température chute. l’Univers poursuit son expansion mais le rythme s’est calmé. Matière et antimatière se sont en grande partie annihilées, seul un infime reliquat demeure, auquel nous devons pourtant tout ce qui nous compose aujourd’hui. Les premiers noyaux se forment. l’Univers est encore si chaud qu’il est opaque à sa propre lumière, immédiatement absorbée dès qu’elle commence à se propager. Le monde n’est qu’un étrange bain sombre de constituants élémentaires en interaction. Enfin, la température devient assez faible pour que les électrons puissent se joindre aux noyaux et former des atomes ! Le cosmos devient transparent.
La gravitation reprend peu à peu ses droits. Des nuages de gaz s’effondrent. Apparaissent les étoiles qui se structurent en galaxies. Les plus massives de ces étoiles vivent très peu de temps, explosent et forment des trous noirs, des « astres occlus ». Les éléments lourds, essentiels pour l’apparition de la vie, commencent à être synthétisés. Autour des étoiles, se forment des planètes au sein desquelles peut prendre naissance une chimie subtile. La température moyenne de l’Univers n’est plus que de quelques degrés au-dessus du zéro absolu (-273°C). Étonnamment, l’expansion de l’Univers accélère à nouveau ! La distance entre les corps célestes augmente exponentiellement et une évolution imprévue semble se dessiner. Voilà où nous en sommes.
Cette histoire est notre histoire. Elle est ce qu’on croit être le moins mauvais récit de nos origines. Elle est le cadre dans lequel se déploie ou se déplie notre physique. Elle constitue un mélange, parfois savant, souvent baroque, de quasi-certitudes et de spéculations effrénées. Elle ne s’achève pas ici. Elle se prolonge dans de multiples directions. Les interrogations et incompréhensions sont plus nombreuses que les réponses et les évidences.
- Présentation succincte et claire de l’astronomie grecque :
https://www.astronomes.com/lhistoire-de-lastronomie/lastronomie-grecque
- La cosmologie d’Aristote : géocentrisme et distinction entre le monde sublunaire et le monde supralunaire, Pierre Pellegrin, Dictionnaire Aristote, Ellipses, 2007, p. 184-186 :
L’univers d’Aristote est unique, fini, éternel, sphérique et globalement parfait. Cette éternité de l’univers est une partie importante de la réponse d’Aristote à Parménide. Le problème de la venue à l’être du Tout […] se trouve ainsi disqualifié. Aristote rompt donc avec la cosmogonie, pour devenir le premier cosmologiste, le premier et le seul avant longtemps, puisque ses successeurs affronteront de nouveau le problème de l’origine du cosmos. Étant éternel, l’univers doit être, dans une certaine mesure parfait, autrement il serait corruptible. Il est constitué de sphères concentriques sur lesquelles sont fixés des corps célestes. Elles ont comme centre commun le centre de la Terre, laquelle est immobile au centre de l’univers. La dernière de ces sphères est le « premier ciel » sur lequel sont fixées les étoiles fixes. Il est mû directement par le dieu d’Aristote, le premier moteur immobile. Les planètes, quant à elles, sont animées d’une part du mouvement général du premier ciel et, d’autre part des mouvements des sphères sur lesquelles elles sont fixées. On parle donc de « sphères » par habitude et par commodité, mais il faudrait parler d’anneaux sphériques, dans lesquels sont enchâssées les planètes. Pour rendre compte des mouvements apparemment irréguliers des planètes, Aristote semble avoir repris l’hypothèse d’Eudoxe de Cnide selon laquelle chaque astre se trouve sur plusieurs sphères concentriques mais dont les axes de rotation ne sont pas les mêmes. Il fallait ainsi trois sphères pour rendre compte du mouvement de la Lune et trois autres pour celui du Soleil, mais quatre pour le mouvement des autres planètes. Callipe de Cysique, successeur d’Eudoxe, introduisit de nouvelles sphères, ce qui amena leur nombre à trente-quatre, y compris la sphère des fixes. Une tradition affirme que Callipe a travaillé avec Aristote. Mais, alors qu’Eudoxe et Callipe proposaient une hypothèse ou, si l’on veut, une sorte de fiction théorique pour, comme Simplicius le leur fait dire, « sauver les phénomènes », c’est-à-dire les apparences et notamment les apparences des mouvements irréguliers des planètes, Aristote considère que son modèle théorique décrit une situation réellement existante. […]
L’univers d’Aristote est affecté d’une césure profonde entre que ce la tradition a appelé les régions supralunaire et sublunaire – Aristote parle des « choses de la-bas » et des « choses d’ici ». La première, qui s’étend entre la sphère des fixes et l’orbite de la Lune, est le lieu des seuls mouvements des corps célestes, tous réductibles, par le biais de la théorie des sphères concentriques, à des mouvements circulaires réguliers. Elle est entièrement pleine, puisqu’il n’y a pas de vide dans l’univers aristotélicien, et elle est plus précisément constituée d’anneaux sphériques concentriques tangents. Aristote soutient, dans le traité Du ciel, que cette région est entièrement composée d’un élément propre, différent des quatre éléments du monde sublunaire, que la tradition a nommé la « quintessence », dont la propriété essentielle est de ce mouvoir en cercle. La région sublunaire, en revanche, qui est celle dans laquelle nous vivons, est composée des quatre éléments qu’Aristote a empruntés à Empédocle : la terre, l’eau, l’air, le feu. Cette région sublunaire est affectée de mouvements divers et souvent désordonnés, et même si des régularités assez nombreuses s’y repèrent – ce qui rend possible d’appliquer la science, et notamment la physique à cette région sublunaire –, elles sont affectées d’un certain coefficient d’incertitude.
- Présentation succincte du système géocentrique de Ptolémée :
https://www.universalis.fr/encyclopedie/systeme-geocentrique-de-ptolemee/
« Dans sa Syntaxe mathématique, plus connue sous le titre d'Almageste, et dans laquelle la dernière observation consignée date de 141, Claude Ptolémée (IIe siècle) expose l'ensemble des connaissances astronomiques de son époque. Il décrit en particulier le mouvement du Soleil, de la Lune et des planètes autour de la Terre, considérée comme le centre du monde, au moyen d'un ensemble complexe de trajectoires circulaires décrites d'un mouvement uniforme : les déférents, autour de la Terre, et les épicycles, dont les centres parcourent les déférents. Ptolémée parvient ainsi à prédire le mouvement des astres avec une bonne précision, compatible avec celle des observations menées durant l'Antiquité. À une époque où l'on ne connaissait rien des causes physiques du mouvement des planètes, cette description purement géométrique et cinématique pouvait être considérée comme entièrement satisfaisante. Le système de Copernic n'est à cet égard pas supérieur à celui de Ptolémée. Kepler constatera cependant que les mouvements circulaires uniformes ne donnaient pas une bonne éphéméride de Mars, ce qui le conduira à découvrir les lois qui portent son nom. » James Lequeux, Universalis.fr
- Pour un dessin du système géocentrique de Ptolémée :
https://www.universalis.fr/encyclopedie/systeme-geocentrique-de-ptolemee/
Présentation détaillée du documentaire « Galilée, la naissance d’une étoile » sur Canopé :
cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/93735/93735-15475-19459.pdf
- Galilée, extrait de Sidereus Nuncius (cité par Alexandre Koyré, Du monde clos à l’univers infini, Gallimard,1957, p. 118)
Chacun peut se rendre compte avec la certitude des sens, que la lune est dotée d’une surface non point lisse et polie, mais faite d’aspérités et de rugosités, et que, tout comme la face de la terre elle-même, elle est toute en gros renflements, gouffres profonds et courbures. Ce n’est pas, à mon avis, un mince résultat que d’avoir mis fin à des controverses concernant la Galaxie ou Voie lactée et d’en avoir rendu l’essence manifeste, non seulement aux sens, mais à l’intellect ; et c’est chose plaisante et magnifique, que d’avoir en outre montré du doigt la substance de certaines étoiles, qualifiées jusqu’à présent de nébuleuses par tous les astronomes, substance toute différente de ce qu’on croyait. Mais ce dont la portée est bien au-delà de toute surprise et admiration et m’a par-dessus tout déterminé à réclamer l’attention de tous les astronomes et philosophes, c’est certes notre découverte de quatre planètes demeurées inconnues et invisibles à tous nos prédécesseurs, planètes qui accomplissent leur révolution autour d’une grosse étoile déjà connue, tout comme Vénus et Mercure autour du soleil et qui sont tantôt en avance et tantôt en retard sur elle, sans que leur digression dépasse jamais certaines limites. Tout cela a été découvert et observé récemment au moyen des perspicilli (du télescope), que j’avais inventé de par une illumination préalable de mon esprit par la Grâce divine.
- Galilée, extrait du Dialogue sur les deux grands systèmes du monde, Points, p. 89-90 :
« Au lecteur avisé. Les années passées, on a publié à Rome un édit salutaire qui, pour faire face aux dangereux scandales de l’époque actuelle, imposait opportunément silence à l’opinion pythagoricienne de la mobilité de la terre. Il n’a pas manqué de personnes pour affirmer témérairement que ce décret procédait non d’un examen judicieux, mais d’une passion trop peu informée, et on a entendu se plaindre et dire que des Consulteurs inexpérimentés en observations astronomiques ne devaient pas par de brusques interdictions couper les ailes aux intellects spéculatifs. Mon zèle n’a pu se taire en entendant ces téméraires lamentations. Pleinement instruit de cette décision très prudente, j’ai jugé bon de paraître publiquement sur le Théâtre du Monde comme simple témoin de la vérité. […]
C’est à cette fin que j’ai pris dans la discussion le parti de Copernic, cheminant comme en pure Hypothèse Mathématique, cherchant par les voies les plus artificieuses à la présenter comme supérieure à l’hypothèse de l’immobilité de la terre, quand on prend cette dernière non pas absolument, mais telle qu’elle est défendue par certains : péripatéticiens de profession, ils n’en retiennent que le nom, puisque, sans se promener jamais, ils se contentent d’adorer les ombres, philosophant sans être informés comme il le faut, se souvenant seulement de quatre principes mal compris.
Je traiterai de trois thèmes principaux. Je chercherai d’abord à montrer que toutes les expériences qu’on peut faire sur la terre sont insuffisantes pour conclure à sa mobilité, mais aussi qu’elles peuvent indifféremment s’accorder aussi bien avec la mobilité de la terre qu’avec son repos ; et j’espère à cette occasion révéler bien des observations qui furent ignorées de l’Antiquité. En second lieu, j’examinerai les phénomènes célestes, en donnant de la force aux hypothèses coperniciennes comme si elles devaient absolument obtenir la victoire, et j’ajouterai de nouvelles réflexions qui rendent l’astronomie plus facile sans pour autant répondre à une nécessité de la nature. En troisième lieu, je proposerai une ingénieuse fantaisie. Il se trouve que j’ai dit, il y a bien des années, que le problème non résolu du flux de la mer pouvait recevoir quelque lumière si on admettait le mouvement de la Terre. […]
J’espère que ces remarques permettront au monde de savoir que, si d’autres nations ont navigué plus que nous, nous n’avons pas réfléchi moins qu’elles et que, si nous continuons à affirmer la stabilité de la Terre et nous contentons de voir dans le contraire une curiosité mathématique, cela ne vient pas de notre ignorance de la pensée des autres, cela vient, entre autres, de raisons qui nous recommandent la piété, la religion, la connaissance de la toute-puissance divine et la conscience de la faiblesse de l’esprit humain.
Alexandre Koyré, Du monde clos à l’univers infini, Gallimard, 1957.
J’ai essayé […] de définir les schémas structurels de l’ancienne et de la nouvelle conception du monde et de décrire les changements produits par la révolution du XVIIe siècle. Ceux-ci me semblent pouvoir être ramenés à deux éléments principaux, d’ailleurs étroitement liés entre eux, à savoir la destruction du Cosmos, et la géométrisation de l’espace, c’est-à-dire a) la destruction du monde conçu comme un tout fini et bien ordonné, dans lequel la structure spatiale incarnait une hiérarchie de valeur et de perfection, monde dans lequel « au-dessus » de la Terre lourde et opaque, centre de la région sublunaire du changement et de la corruption, s’« élevaient » les sphères célestes des astres impondérables, incorruptibles et lumineux, et la substitution à celui-ci de l’Univers indéfini, et même infini, ne comportant plus aucune hiérarchie naturelle et uni seulement par l’identité des lois qui le régissent dans toutes ses parties, ainsi que par celle de ses composants ultimes placés, tous, au même niveau ontologique ; et b) le remplacement de la conception aristotélicienne de l’espace, ensemble différencié de lieux intramondains, par celle de l’espace de la géométrie euclidienne – extension homogène et nécessairement infinie – désormais considéré comme identique, en sa structure, avec l’espace réel de l’Univers. Ce qui, à son tour, impliqua le rejet par la pensée scientifique de toutes considérations basées sur les notions de valeur, de perfection, d’harmonie, de sens ou de fin, et finalement, la dévalorisation complète de l’Être, le divorce total entre le monde des valeurs et le monde des faits.
- Kant : différence entre connaître et penser
Texte à trouver
- Aurélien Barrau sur la notion de « multivers » : cf. Big bang et au-delà, les nouveaux horizons de l’Univers, 2013
Texte à extraire
2ème partie : l’homme à l’épreuve de l’altérité
Introduction : comment définir l’homme ?
- Pic de la Mirandole : l’homme est un être indéterminé qui peut déterminer lui-même sa nature
Déjà Dieu, Père suprême et suprême Architecte, avait construit, avec des lois d’une mystérieuse sagesse, cette maison du monde que nous voyons, auguste temple de sa divinité : il avait orné la région supra-céleste d’intelligences, il avait animé les astres éthérés d’esprits immortels, il avait peuplé d’une foule de toutes sortes d’animaux les parties pourrissantes et bourbeuses du monde inférieur. Mais après cette œuvre, l’Artisan désirait qu’il y eût quelqu’un qui appréciât la raison d’une telle œuvre, en aimât la beauté, en admirât la grandeur. C’est pourquoi quand tout cela fût terminé, comme Moïse et Timée en témoignent, en dernier lieu, il pensa à créer l’homme. Mais il n’y avait pas dans les archétypes de quoi façonner une nouvelle race, ni dans les trésors de quoi doter ce nouveau fils d’un héritage, ni parmi les sièges d’honneur du monde entier un siège où ce contemplateur de l’univers pût s’asseoir. Tout était déjà rempli : tout avait été distribué aux ordres supérieurs, moyens et inférieurs. Mais il n’eût pas été digne de la puissance du Père, au dernier acte de la génération, comme par épuisement, de se trouver dépourvu […]
Enfin le parfait Artisan décida qu’à celui à qui rien ne pouvait être donné en propre serait commun tout ce qui avait été donné en particulier à chacune des créatures. Il prit donc l’homme, cette œuvre d’un type indéfini, et l’ayant placé au milieu du monde, il lui parla ainsi : « Ô Adam, nous ne t’avons donné ni une place déterminée, ni une physionomie propre, ni aucun don particulier, afin que la place, la physionomie, les dons que toi-même tu aurais souhaités, tu les aies et tu les possèdes selon tes vœux, selon ta volonté. Pour les autres, leur nature définie est régie par des lois que nous avons prescrites ; toi, tu n’es limité par aucune barrière, c’est de ta propre volonté, dans le pouvoir de laquelle je t’ai placé, que tu détermineras ta nature. Je t’ai installé au milieu du monde afin que de là tu examines plus commodément autour de toi tout ce qui existe dans le monde. Nous ne t’avons ni céleste ni terrestre, ni mortel ni immortel, afin que, maître de toi-même, et ayant pour ainsi dire l’honneur et la charge de façonner et de modeler ton être, tu te composes la forme que tu aurais préférée. Tu pourras dégénérer en formes inférieures qui sont animales, tu pourras, par décision de son esprit, être régénéré en formes supérieures qui sont divines. » Ô libéralité suprême du Dieu Père, suprême et merveilleuse félicité de l’homme ! A lui est donné d’avoir ce qu’il désire, d’être ce qu’il veut. Les animaux, en naissant, apportent avec eux (comme dit Lucilius) « du sein de leur mère », ce qu’ils posséderont. Les esprits les plus haut placés furent, dès le début et aussitôt après, ce qu’ils seront éternellement. A l’homme naissant Dieu a donné les semences les plus variées et les germes de toutes espèces de vie. […]
Mais à quoi bon tout cela ? Afin que nous comprenions, puisque nous sommes nés capables de devenir ce que nous voulons, que nous devons veiller à ce que l’on ne dise pas de nous qu’alors que nous étions d’un rang élevé, nous l’avons ignoré et sommes devenus semblables à des bêtes et à des animaux inconscients ; mais que plutôt se vérifie cette parole du prophète Asaph : « Vous êtes des Dieux et tous vous êtes fils du Très-Haut ». Afin que, n’abusant pas de la miséricordieuse libéralité du Père, nous ne fassions pas du libre-arbitre, qu’il nous a donné pour nous sauver, la cause de notre damnation.
Pic de la Mirandole, De la dignité de l’homme, 1486 (cité dans le recueil de Luc Ferry et Claudine Germé, Des animaux et des hommes, Le livre de poche, 1994)
- Kant, l’homme ne devient homme que par l’éducation
L’homme est la seule créature qui doive être éduquée. Par éducation en entend, en effet, les soins (l’alimentation, l’entretien), la discipline, et l’instruction avec la formation. Dès qu’ils les possèdent quelque peu, les animaux usent de leurs forces régulièrement, c’est-à-dire de telle sorte qu’elles ne leur soient pas nuisibles. La plupart des animaux ont besoin d’être nourris certes ; ils n’ont pas besoin de soins. On entend par soins les précautions que prennent les parents pour éviter que les enfants ne fassent un usage nuisible de leurs forces. [...] La discipline transforme l’animalité en humanité. Par son instinct un animal est déjà tout ce qu’il peut être ; une raison étrangère a déjà pris soin de tout pour lui. Mais l’homme doit user de sa propre raison. Il n’a point d’instinct et doit se fixer lui-même le plan de sa conduite. Or puisqu’il n’est pas immédiatement capable de le faire, mais au contraire vient au monde pour ainsi dire à l’état brut, il faut que d’autres le fassent pour lui. La discipline empêche que l’homme soit détourné de sa destination, celle de l’humanité, par ses penchants animaux. Elle doit par exemple lui imposer des bornes de telle sorte qu’il ne se précipite pas dans les dangers sauvagement et sans réflexion. La discipline est ainsi simplement négative ; c’est l’acte par lequel on dépouille l’homme de son animalité ; en revanche l’instruction est la partie positive de l’éducation. [...] L’homme ne peut devenir homme que par l’éducation. Il n’est que ce que l’éducation fait de lui. [...] L’homme peut ou bien être simplement dressé, dirigé, mécaniquement instruit, ou bien être réellement éclairé. On dresse des chiens, des chevaux ; on peut aussi dresser des hommes. L’éducation n’est pas encore à son terme avec le dressage ; en effet il importe avant tout que les enfants apprennent à penser.
Emmanuel Kant, Réflexions sur l’éducation (1776-1787).
- Pascal Picq, la difficile définition de l’homme : cf. Qu’est-ce que l’humain ?, Le pommier, 2003.
Passage à sélectionner.
1. L’homme et l’animal : l’homme est-il un animal comme les autres ?
Étude comparée de deux longs passages de Montaigne et de Descartes :
- Montaigne, Apologie de Raymond Sebond, Essais, Livre 2, 1588 : entre l’homme et les autres animaux pas de différence de nature mais seulement de degré
Considérons donc pour cette heure l’homme seul, sans secours étranger, armé seulement de ses armes, et dépourvu de la grâce et connaissance divine, qui est tout son honneur, sa force et le fondement de son être. Voyons combien il a de tenue en ce bel équipage. Qu’il me fasse entendre par l’effort de son discours, sur quels fondements il a bâti ces grands avantages qu’il pense avoir sur les autres créatures. Qui lui a persuadé que ce branle admirable de la voûte céleste, la lumière éternelle de ces flambeaux roulant si fièrement sur sa tête, les mouvements épouvantables de cette mer infinie, soient établis et se continuent tant de siècles pour sa commodité et pour son service ? Est-il possible de rien imaginer de si ridicule que cette misérable créature, qui n’est pas seulement maîtresse de soi, exposée aux offenses de toutes choses, se dise maîtresse et emperière de l’univers, duquel il n’est pas en sa puissance de connaître la moindre partie, tant s’en faut de la commander ? Et ce privilège qu’il s’attribue d’être seul en ce grand bâtiment, qui ait la suffisance d’en reconnaître la beauté et les pièces, seul qui en puisse rendre grâces à l’architecte et tenir compte de la recette et mise au monde, qui lui a scellé ce privilège ? […]
Pourquoi les privons-nous et d’âme, et de vie, et de discours [de raison] ? Y avons-nous reconnu quelque stupidité immobile et insensible, nous qui n’avons aucun commerce avec eux, que l’obéissance ? Dirons-nous que nous n’avons vu en nulle autre créature qu’en l’homme l’usage d’une âme raisonnable ? […] La présomption est notre maladie naturelle et originelle. La plus calamiteuse et frêle de toutes les créatures, c’est l’homme, et quant et quant la plus orgueilleuse. […] C’est par la vanité de son imagination qu’il s’égale à Dieu, qu’il s’attribue les conditions divines, qu’il se trie soi-même et sépare de la presse des autres créatures, taille la part aux animaux ses confrères et compagnons, et leur distribue telle portion de facultés et de forces que bon lui semble. Comment connaît-il, par l’effort de son intelligence, les branles internes et secrets des animaux ? Par quelle comparaison d’eux à nous conclut-il la bêtise qu’il leur attribue ?
Quand je joue avec ma chatte, qui sait si elle passe son temps de moi plus que je ne fais d’elle ? […] Ce défaut qui empêche la communication d’entre elle et nous, pourquoi n’est-il aussi bien à nous qu’à elles ? C’est à deviner à qui est la faute de ne nous entendre point ; car nous ne les entendons non plus que nous. Par cette même raison, elles nous peuvent estimer bêtes, comme nous les en estimons. […] Il nous faut remarquer la parité qui est entre nous. Nous n’avons quelque moyenne intelligence de leur sens : aussi les bêtes du nôtre, environ à même mesure. Elles nous flattent, nous menacent et nous requièrent, et nous elles. Au demeurant, nous découvrons bien évidemment qu’entre elles il y a une pleine et entière communication et qu’elles s’entr’entendent, non seulement celles de même espèce, mais aussi d’espèces diverses. […] En certain aboyer du chien le cheval connaît qu’il y a de la colère ; de certaine autre sienne vois il ne s’effraie point. Aux bêtes mêmes qui n’ont pas de voix, par la société d’offices que nous voyons entre elles, nous argumentons aisément quelque autre moyen de communication : leurs mouvements discourent et traitent : « A peu près comme on voit les enfants recourir au geste par leur impuissance à s’exprimer avec les mots », Lucrèce, De la nature. Pourquoi non, tout aussi bien que nos muets disputent, argumentent et content des histoires par signes ? […]
Au reste, quelle sorte de notre suffisance [nos facultés] ne reconnaissons-nous aux opérations des animaux ? […] Les hirondelles que nous voyons au retour du printemps fureter tous les coins de nos maisons, cherchent-elles sans jugement et choisissent-elles sans discrétion, de milles places, celle qui leur est la plus commode à se loger ? […] pourquoi épaissit l’araignée sa toile en un endroit et relâche en un autre ? Se sert à cette heure de cette sorte de nœud, tantôt de celle-là, si elle n’a et délibération, en pensée, et conclusion ? Nous reconnaissons assez, en la plupart de leurs ouvrages, combien les animaux ont d’excellence au-dessus de nous et combien notre art est faible à les imiter. Nous voyons toutefois aux nôtres, plus grossiers, les facultés que nous y employons, et que notre âme s’y sert de toutes ses forces ; pourquoi n’en estimons-nous autant d’eux ? Pourquoi attribuons-nous à je ne sais quelle inclination naturelle et servile les ouvrages qui surpassent tout ce que nous pouvons par nature et par art ? […]
Quant au parler, il est certain que, s’il n’est pas naturel, il n’est pas nécessaire. Toutefois je crois qu’un enfant qu’on aurait nourri en pleine solitude, éloigné de tout commerce (qui serait un essai malaisé à faire), aurait quelque espèce de parole pour exprimer ses conceptions ; et ce n’est pas croyable que nature nous ait refusé ce moyen qu’elle a donné a plusieurs autres animaux : car, qu’est-ce autre chose que parler, cette faculté que nous leur voyons de se plaindre, de se réjouir, de s’entr’appeler au secours, se convier à l’amour, comme ils font par l’usage de leur voix ? Comment ne parleraient-elles entr’elles ? Elles parlent bien à nous, et nous à elles. En combien de sortes parlons-nous à nos chiens ? Et ils nous répondent. D’autre langage, d’autres appellations divisons-nous avec eux qu’avec les oiseaux, avec les pourceaux, les bœufs, les chevaux, et changeons d’idiome selon l’espèce. […]
Nous ne sommes ni au-dessus, ni au-dessous du reste : tout ce qui est sous le Ciel, sit le sage, court une loi et fortune sans pareille, « Tout est enchaîné dans les liens de la fatalité » (Lucrèce, De la nature). Il y a quelque différence, il y a des ordres et des degrés ; mais c’est sous le visage d’une même nature : « Chaque chose a son développement propre, et toutes conservent les différences que la nature leur a décrétées » (Lucrèce, De la nature). Il faut contraindre l’homme et le ranger dans les barrières de cette police. Le misérable n’a garde d’enjamber par effet au-delà ; il est entravé et engagé, il est assujetti de pareille obligation que les autres créatures de son ordre, et d’une condition fort moyenne, sans aucune prérogative, préexcellence vraie et essentielle. […]
Je dis donc, pour revenir à mon propos, qu’il n’y a point d’apparence d’estimer que les bêtes fassent par inclination naturelle et forcée les mêmes choses que nous faisons par notre choix et industrie. Nous devons conclure de pareils effets pareilles facultés et confesser par conséquent que ce même discours [intelligence], cette même voie, que nous tenons à ouvrer [que nous suivons dans nos ouvrages], c’est aussi celle des animaux.
Montaigne, Apologie de Raymond Sebond, GF, 1989, p. 57-71.
- Descartes, Discours de la méthode, 1636 : l’homme diffère par nature des animaux du fait qu’il soit le seul à posséder une âme
S’il y avait de telles machines, qui eussent les organes et la figure d’un singe, ou de quelque autre animal sans raison, nous n’aurions aucun moyen pour reconnaître qu’elles ne seraient pas en tout de même nature que ces animaux, au lieu que, s’il y en avait qui eussent la ressemblance de nos corps et imitassent autant nos action que moralement il serait possible, nous aurions toujours deux moyens très certains pour reconnaître qu’elles ne seraient point pour cela de vrais hommes. Dont le premier est que jamais elles ne pourraient user de paroles, ni d’autres signes en les composant, comme nous faisons pour déclarer aux autres nos pensées. Car on peut bien concevoir qu’une machine soit tellement faite qu’elle profère quelques-unes à propos des actions corporelles qui causeront quelque changement en ses organes : comme, si on la touche en quelque endroit, qu’elle demande ce qu’on veut lui dire ; si en un autre, qu’elle crie et qu’on lui fasse mal, et choses semblables ; mais non pas qu’elles les arrange diversement, pour répondre au sens de tout ce qu’on lui dira en sa présence, ainsi que les hommes les plus hébétés peuvent le faire. Et le second est que, bien qu’elles fissent plusieurs choses aussi bien, ou peut-être mieux qu’aucun de nous, elles manqueraient infailliblement en quelques autres, par lesquelles on découvrirait qu’elles n’agiraient pas par connaissance, mais seulement par la disposition de leurs organes. Car au lieu que la raison est un instrument universel, qui peut servir en toutes sortes de rencontres, ces organes ont besoin de quelque particulière disposition pour chaque action particulière ; d’où vient qu’il est moralement impossible qu’il y en ait assez de divers en une machine pour la faire agir en toutes les occurrences de la vie, de la même façon que notre raison nous fait agir.
Or, par ces deux mêmes moyens, on peut aussi connaître la différence qui est entre les hommes et les bêtes. Car c’est une chose bien remarquable qu’il n’y a point d’hommes si hébétés et si stupides, sans en excepter mêmes les insensés, qu’ils ne soient capables d’arranger ensemble diverses paroles, et d’en composer un discours par lequel ils fassent entendre leurs pensées ; et au contraire, il n’y a point d’autre animal, tant parfait et tant heureusement né qu’il puisse être, qui fasse le semblable. Ce qui n’arrive pas de ce qu’ils ont fautes d’organes, car on voit que les pies et les perroquets peuvent proférer des paroles ainsi que nous, et toutefois ne peuvent parler ainsi que nous, c’est-à-dire en témoignant qu’ils pensent ce qu’ils disent ; au lieu que les hommes qui, étant nés sourds et muets, sont privés des organes qui servent aux autres pour parler, autant ou plus que les bêtes, ont coutume d’inventer d’eux-mêmes quelques signes, par lesquels ils se font entendre à ceux qui, étant ordinairement avec eux, ont loisir d’apprendre leur langue. Et ceci ne témoigne pas seulement que les bêtes ont moins de raison que les hommes, mais qu’elles n’en ont point du tout. […]
Et on ne doit pas confondre les paroles avec les mouvements naturels, qui témoignent les passions, et peuvent être imités par des machines aussi bien que par les animaux ; ni penser, comme quelques anciens, que les bêtes parlent, bien que nous n’entendions pas leur langage : car s’il était vrai, puisqu’elles ont quelques organes qui se rapportent aux nôtres, elles pourraient aussi bien se faire entendre de nous qu’à leurs semblables. C’est aussi une chose fort remarquable que, bien qu’il y ait plusieurs animaux qui témoignent plus d’industrie que nous en quelques-unes de leurs actions, on voit toutefois que les mêmes n’en témoignent point du tout en beaucoup d’autres : de façon que ce qu’ils font mieux que nous ne prouve pas qu’ils ont de l’esprit ; car, à ce ce compte, ils en auraient plus qu’aucun de nous et feraient mieux en toute chose ; mais plutôt qu’ils n’en ont point, et que c’est la Nature qui agit en eux, selon la disposition de leurs organes : ainsi qu’on voit qu’une horloge, qui n’est composée que de roues et de ressorts, peut compter les heures, et mesurer le temps, plus justement que nous avec toute notre prudence. […]
Après l’erreur de ceux qui nient Dieu, laquelle je pense avoir ci-dessus assez réfutée, il n’y en a point qui éloigne plutôt les esprits faibles du droit chemin de la vertu, que d’imaginer que l’âme des bêtes soit de même nature que la nôtre, et que, par conséquent, nous n’avons rien à craindre, ni à espérer après cette vie, non plus que les mouches et les fourmis ; au lieu que, lorsqu’on sait combien elles diffèrent, on comprend beaucoup mieux les raisons, qui prouvent que la nôtre est d’une nature entièrement indépendante du corps et, par conséquent, qu’elle n’est point sujette à mourir avec lui ; puis, d’autant qu’on ne voit point d’autres causes qui la détruisent, on est naturellement porté à juger de là qu’elle est immortelle.
René Descartes, Discours de la méthode, 1636, GF, p. 79-81.
Quelle place pour l’homme dans la nature ? : la classification des animaux de Linné à Darwin.
- Linné, Système de la nature, 1735 (extrait cité dans Luc Ferry et Claudine Germé, Des animaux et des hommes, Le livre de poche, 1994, p. 233-236). Il classe l’homme parmi les animaux, mammifères et primates à côté des singes.
- Darwin, La descendance de l’homme, 1871. (Cité par Luc Ferry et Claudine Germé, Des animaux et des hommes, Le livre de poche, 1994, p. 309-311)
Quelques naturalistes, profondément frappés des aptitudes mentales de l’homme, ont partagé l’ensemble du monde organique en trois règnes : le règne Humain, le règne Animal et le règne Végétal, attribuant ainsi à l’homme un règne spécial. Le naturaliste ne peut ni comparer ni classer les aptitudes mentales, mais il peut ainsi que j’ai essayé de le faire, chercher à démontrer que, si les facultés mentales de l’homme diffèrent immensément en degré de celles des animaux qui lui sont inférieurs, elles n’en diffèrent pas quant à leur nature. Une différence de degré, si grande qu’elle soit, ne nous autorise pas à placer l’homme dans un règne à part. […] Par conséquent, si l’on veut déterminer la position de l’homme dans le système naturel ou généalogique, l’extrême développement du cerveau ne doit pas l’emporter sur une foule de ressemblances portant sur des points d’importance moindres ou même n’en n’ayant aucune. […]
Si nous considérons la conformation embryologique de l’homme, – les analogies qu’il présente avec les animaux inférieurs, – les rudiments qu’il conserve, – et les réversions auxquelles il est sujet, nous serons à même de reconstruire en partie par l’imagination, l’état primitif de nos ancêtres, et de leur assigner approximativement la place qu’ils doivent occuper dans la série zoologique. Nous apprenons ainsi que l’homme descend d’un mammifère velu, pourvu d’une queue et d’oreilles pointues, qui probablement vivait dans les arbres, et habitait l’ancien monde. Un naturaliste qui aurait examiné la conformation de cet être l’aurait classé parmi les Quadrumanes aussi sûrement que l’ancêtre commun et encore plus ancien des singes de l’ancien et du nouveau monde. […] Il y a sans doute une difficulté à vaincre avant d’accepter pleinement la conclusion à laquelle nous sommes ainsi conduits sur l’origine de l’homme, c’est la hauteur du niveau intellectuel et moral auquel s’est élevé l’homme. Mais quiconque admet le principe général de l’évolution, doit reconnaître que, chez les animaux supérieurs, les facultés mentales sont, à un degré très inférieur, de même nature que celles de l’espèce humaine et susceptible de développement.
3) Autre exemple de textes
Platon, Timée, 33b-34
« [le] Dieu donna au monde la forme la plus convenable et la plus appropriée à sa nature ; or la forme la plus convenable à l'animal qui devait renfermer en soi tous les autres animaux ne pouvait être que celle qui renferme en elle toutes les autres formes. C'est pourquoi, jugeant le semblable infiniment plus beau que le dissemblable, il donna au monde la forme sphérique, ayant partout les extrémités également distantes du centre, ce qui est la forme la plus parfaite et la plus semblable à elle-même. Il polit toute la surface de ce globe avec le plus grand soin par plusieurs raisons ; ce monde n'avait besoin ni d'yeux ni d'oreilles, parce qu'il ne restait en dehors rien à voir ni rien à entendre; il n'y avait pas non plus autour de lui d'air à respirer; il n'avait besoin d'aucun organe pour la nutrition, ni pour rejeter les aliments digérés ; car il n'y avait rien à rejeter ni rien à prendre. (…) L'auteur du monde estima qu'il vaudrait mieux que son ouvrage se suffit à lui-même, que d'avoir besoin de secours étranger. De même, il ne jugea pas nécessaire de lui faire des mains, parce qu'il n'y avait rien à saisir ni rien à repousser ; et il ne lui fit pas non plus de pieds, ni rien de ce qu'il faut pour la marche ; mais il lui donna un mouvement propre à la forme de son corps, et qui (…) appartient principalement à l'esprit et à l'intelligence. Faisant tourner le monde constamment sur lui-même et sur un même point, Dieu lui imprima ainsi le mouvement de rotation, et lui ôta les (…) autres mouvements, ne voulant pas qu'il fût errant à leur gré. Le monde enfin, n'ayant pas besoin de pieds, pour exécuter ce mouvement de rotation, il le fit sans pieds et sans jambes.
(…) Il le polit, l'arrondit de tous côtés, plaça ses extrémités à égale distance du centre, en forma un tout, un corps parfait, composé de tous les corps parfaits (…) ; et ainsi il fit un globe tournant sur lui-même, un monde unique, solitaire, se suffisant par sa propre vertu, n'ayant besoin de rien autre que soi, se connaissant et s'aimant lui-même.»
Diderot, Prospectus de l’Encyclopédie (1751) (remarque : texte remplacé ensuite par le Discours préliminaire à l’Encyclopédie)
« PROSPECTUS
L’ouvrage que nous annonçons n’est plus un ouvrage à faire. Le manuscrit et les dessins en sont complets. Nous pouvons assurer qu’il n’y aura pas moins de huit volumes et de six cents planches, et que les volumes se succéderont sans interruption.
Après avoir informé le public de l’état présent de l’Encyclopédie, et de la diligence que nous apporterons à la publier, il est de notre devoir de le satisfaire sur la nature de cet ouvrage et sur les moyens que nous avons pris pour l’exécution. C’est ce que nous allons exposer avec le moins d’ostentation qu’il nous sera possible.
On ne peut disconvenir que, depuis le renouvellement des lettres parmi nous, on ne doive en partie aux dictionnaires les lumières générales qui se sont répandues dans la société, et ce germe de science qui dispose insensiblement les esprits à des connaissances plus profondes. Combien donc n’importait-il pas d’avoir en ce genre un livre qu’on pût consulter sur toutes les matières, et qui servît autant à guider ceux qui se sentiraient le courage de travailler à l’instruction des autres, qu’à éclairer ceux qui ne s’instruisent que pour eux-mêmes !
(…)
Nous avons senti, avec l’auteur anglais, que le premier pas que nous avions à faire vers l’exécution raisonnée et bien entendue d’une Encyclopédie, c’était de former un arbre généalogique de toutes les sciences et de tous les arts, qui marquât l’origine de chaque branche de nos connaissances, les liaisons qu’elles ont entre elles et avec la tige commune, et qui nous servît à rappeler les différents articles à leurs chefs. Ce n’était pas une chose facile. Il s’agissait de renfermer en une page le canevas d’un ouvrage qui ne se peut exécuter qu’en plusieurs volumes in-folio, et qui doit contenir un jour toutes les connaissances des hommes.
Cet arbre de la connaissance humaine pouvait être formé de plusieurs manières, soit en rapportant aux diverses facultés de notre âme nos différentes connaissances, soit en les rapportant aux êtres qu’elles ont pour objet. Mais l’embarras était d’autant plus grand, qu’il y avait plus d’arbitraire. Et combien ne devait-il pas y en avoir ? La nature ne nous offre que des choses particulières, infinies en nombre, et sans aucune division fixe et déterminée. Tout s’y succède par des nuances insensibles. Et sur cette mer d’objets qui nous environnent, s’il en paraît quelques-uns, comme des pointes de rochers qui semblent percer la surface et dominer les autres, ils ne doivent cet avantage qu’à des systèmes particuliers, qu’à des conventions vagues, et qu’à certains événements étrangers à l’arrangement physique des êtres, et aux vraies institutions de la philosophie.
(…)
C’est de nos facultés que nous avons déduit nos connaissances ; l’histoire nous est venue de la mémoire ; la philosophie, de la raison ; et la poésie, de l’imagination : distribution féconde à laquelle la théologie même se prête ; car dans cette science les faits sont de l’histoire, et se rapportent à la mémoire, sans même en excepter les prophéties, qui ne sont qu’une espèce d’histoire où le récit a précédé l’événement : les mystères, les dogmes et les préceptes sont de philosophie éternelle et de raison divine ; et les paraboles, sorte de poésie allégorique, sont d’imagination inspirée. Aussitôt nous avons vu nos connaissances découler les unes des autres ; l’histoire s’est distribuée en ecclésiastique, civile, naturelle, littéraire, etc. La philosophie, en science de Dieu, de l’homme, de la nature, etc. La poésie, en narrative, dramatique, allégorique, etc. De là, théologie, histoire naturelle, physique, métaphysique, mathématique, etc. ; météorologie, hydrologie, etc. ; mécanique, astronomie, optique, etc. ; en un mot, une multitude innombrable de rameaux et de branches, dont la science des axiomes ou des propositions évidentes par elles-mêmes doit être regardée, dans l’ordre synthétique, comme le tronc commun. »
Descartes, Le monde, (1633) Ch VI
« CHAPITRE VI -Description d'un nouveau Monde et des qualités de la matière dont il est composé.
Permettez donc pour un peu de temps à votre pensée de sortir hors de ce Monde pour en venir voir un autre tout nouveau que je ferai naître en sa présence dans les espaces imaginaires, Les philosophes nous disent que ces espaces sont infinis et ils doivent bien en être crus puisque ce sont eux-mêmes qui les ont faits. Mais afin que cette infinité ne nous empêche et ne nous embarrasse point, ne tâchons pas d'aller jusques au bout, entrons-y seulement si avant que nous puissions perdre de vue toutes les créatures que Dieu fit il y a cinq ou six mille ans 1; et après nous être arrêtés là en quelque lieu déterminé, supposons que Dieu crée de nouveau tout autour de nous tant de matière que, de quelque côté que notre imagination se puisse étendre, elle n'y aperçoive plus aucun lieu qui soit vide. »
Pascal (1623-1662), Pensées, Vanités 31-38
« Imagination.
C’est cette partie dominante dans l’homme, cette maîtresse d’erreur et de fausseté, et d’autant plus fourbe qu’elle ne l’est pas toujours, car elle serait règle infaillible de vérité si elle l’était infaillible du mensonge. Mais étant le plus souvent fausse, elle ne donne aucune marque de sa qualité, marquant du même caractère le vrai et le faux. Je ne parle pas des fous, je parle des plus sages et c’est parmi eux que l’imagination a le grand droit de persuader les hommes. La raison a beau crier, elle ne peut mettre le prix aux choses.
Cette superbe puissance ennemie de la raison, qui se plaît à la contrôler et à la dominer, pour montrer combien elle peut en toutes choses, a établi dans l’homme une seconde nature. Elle a ses heureux, ses malheureux, ses sains, ses malades, ses riches, ses pauvres. Elle fait croire, douter, nier la raison. Elle suspend les sens, elle les fait sentir. Elle a ses fous et ses sages, et rien ne nous dépite davantage que de voir qu’elle remplit ses hôtes d’une satisfaction bien autrement pleine et entière que la raison. Les habiles par imagination se plaisent tout autrement à eux mêmes que les prudents ne se peuvent raisonnablement plaire. Ils regardent les gens avec empire, ils disputent avec hardiesse et confiance, les autres avec crainte et défiance. Et cette gaieté de visage leur donne souvent l’avantage dans l’opinion des écoutants, tant les sages imaginaires ont de faveur auprès des juges de même nature.
Elle ne peut rendre sages les fous, mais elle les rend heureux, à l’envi de la raison, qui ne peut rendre ses amis que misérables, l’une les couvrant de gloire, l’autre de honte.
Qui dispense la réputation, qui donne le respect et la vénération aux personnes, aux ouvrages, aux lois, aux grands, sinon cette faculté imaginante ? (…)
Nos magistrats ont bien connu ce mystère. Leurs robes rouges, leurs hermines dont ils s’emmaillotent en chats fourrés, les palais où ils jugent, les fleurs de lys, tout cet appareil auguste était fort nécessaire. Et si les médecins n’avaient des soutanes et des mules et que les docteurs n’eussent des bonnets carrés et des robes trop amples de quatre parties, jamais ils n’auraient dupé le monde, qui ne peut résister à cette montre si authentique. S’ils avaient la véritable justice et si les médecins avaient le vrai art de guérir, ils n’auraient que faire de bonnets carrés. La majesté de ces sciences serait assez vénérable d’ellemême. Mais n’ayant que des sciences imaginaires il faut qu’ils prennent ces vains instruments, qui frappent l’imagination, à laquelle ils ont affaire. Et par là en effet ils s’attirent le respect. (…)
L’imagination dispose de tout. Elle fait la beauté, la justice et le bonheur qui est le tout du monde. »
Condorcet, Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain, 1795
« Y a-t-il, sur le globe, des contrées dont la nature ait condamné les habitants à ne jamais jouir de la liberté, à ne jamais exercer leur raison ?
Cette différence de lumières, de moyens ou de richesses, observée jusqu’à présent chez tous les peuples civilisés, entre les différentes classes qui composent chacun d’eux ; cette inégalité, que les premiers progrès de la société ont augmentée et pour ainsi dire produite, tient-elle à la civilisation même, ou aux imperfections actuelles de l’art social ? Doit-elle continuellement s’affaiblir pour faire place à cette égalité de fait, dernier but de l’art social, qui, diminuant même les effets de la différence naturelle des facultés, ne laisse plus subsister qu’une inégalité utile à l’intérêt de tous, parce qu’elle favorisera les progrès de la civilisation, de l’instruction et de l’industrie, sans entraîner ni dépendance, ni humiliation, ni appauvrissement ? En un mot, les hommes approcheront-ils de cet état, où tous auront les lumières nécessaires pour se conduire d’après leur propre raison dans les affaires communes de la vie, et la maintenir exempte de préjugés ; pour bien connaître leurs droits et les exercer d’après leur opinion et leur conscience ; où tous pourront, par le développement de leurs facultés, obtenir des moyens sûrs de pourvoir à leurs besoins ; où enfin, la stupidité et la misère ne seront plus que des accidents, et non l’état habituel d’une portion de la société ?
Enfin, l’espèce humaine doit-elle s’améliorer, soit par de nouvelles découvertes dans les sciences et dans les arts, et par une conséquence nécessaire, dans les moyens de bien-être particulier et de prospérité commune ; soit par des progrès dans les principes de conduite et dans la morale pratique ; soit enfin par le perfectionnement réel des facultés intellectuelles, morales et physiques, qui peut être également la suite, ou de celui des instruments qui augmentent l’intensité ou dirigent l’emploi de ces facultés, ou même de celui de l’organisation naturelle.
En répondant à ces trois questions, nous trouverons, dans l’expérience du passé, dans l’observation des progrès que les sciences, que la civilisation ont faits jusqu’ici, dans l’analyse de la marche de l’esprit humain et du développement de ses facultés, les motifs les plus forts de croire que la nature n’a mis aucun terme à nos espérances. »
- 1 Estimation de l'âge du monde habituelle au XVIIe siècle.
4) Exemple de trame de parcours
5) Exemple de progression commune
|
LES REPRÉSENTATIONS DU MONDE : RENAISSANCE, AGE CLASSIQUE, LUMIÈRES : PROPOSITION DE PROGRESSION COMMUNE |
|
PHILOSOPHIE |
|
Introduction : Qu’est-ce qu’une « représentation du monde » ? -Faire comprendre aux élèves qu’une représentation du monde est une certaine interprétation en leur faisant comparer des textes de nature différente (mythe, théorie scientifique : Hésiode, Genèse, Galilée, etc.) - Définir les concepts principaux : monde, représentation, mythe, science, connaissance, croyance, imagination, etc. pour faire comprendre la pluralité des moyens de donner un sens et un ordre à ce que l’on perçoit. - Faire comprendre aux élèves que cette représentation a pour but d’apprivoiser l’inconnu, l’altérité (tout ce qui est différent de soi et de ce qu’on connaît), mais que ce faisant elle explique autant qu’elle masque, méconnaît des aspects de la réalité. (Exemples à trouver)
|
|
Problématique générale : Les hommes ont toujours cherché à donner un ordre et un sens au monde pour le rendre familier. Or toute découverte qui les confronte à l’inconnu ou à l’altérité remet en cause cette familiarité. Dès lors comment les hommes ont-ils accueilli et pensé les découvertes qui les ont contraints à transformer leur représentation du monde pendant l’époque moderne (de la Renaissance aux Lumières) ? |
|
1ère partie : Les changements de la représentation du monde à partir de la Renaissance |
|
La représentation du monde de l’Antiquité jusqu’au Moyen Age entre connu et inconnu. - La cosmologie grecque formalisée par Ptolémée et sa reprise par le christianisme et l’étendue du monde connu. Carte + texte explicatif (Aristote, Ptolémée).
|
|
La Révolution Copernicienne et Galiléenne : - La remise en cause de l’héliocentrisme par Copernic et surtout par Galilée. - Le changement de méthode dans la cosmologie : l’utilisation de la lunette astronomique. Non plus seulement observer et raisonner, mais expérimenter, interroger la nature. - Travail sur des textes de Galilée, extrait d’un documentaire (Galilée, la naissance d’une étoile), |
|
Du monde clos à l’univers infini : - Comment est-on passé d’un monde fini et centré sur l’homme à un monde infini et indifférent à l’homme ? Texte de Koyré. - Pouvons-nous nous représenter ce monde infini ? Différence entre connaître et penser (Kant), entre savoir (expérimenter) et spéculer (Cf. Aurélien Barrau). Ouverture : l’univers est infini, Ce décentrement n’a cessé de se poursuivre jusqu’à aujourd’hui (la notion de « multivers », extrait d’une émission de France culture avec Aurélien Barrau…) |
|
Évaluation partie 1 : commentaire philosophique
|
|
2ème partie : l’homme à l’épreuve de l’altérité : autres espèces, autres cultures |
|
Intro : qu’est-ce que l’homme ? - Qu’est-ce qu’une définition (Aristote) et pourquoi est-ce difficile de définir l’homme ? Pic de la Mirandole (être indéterminé), Kant : l’humanité s’acquiert par l’éducation. - L’homme s’est donc toujours défini par rapport aux autres (dieux, animaux). Intermédiaire entre Dieu et les animaux : La Genèse, Machiavel... Prolongements : les questions posées par les préhistoriens sur le propre de l’homme et le « début » du genre « homo » Rappel de la problématique générale. |
|
L’homme est-il un animal comme les autres ? - L’homme se distingue par ce qui le différencie des autres animaux, mais cela est-il légitime ? Controverse entre Descartes et Montaigne : Descartes - Les animaux ont-ils une âme, pensent-ils ? - La question du langage des animaux. - L’homme dans la classification : de Linné au XVIIIè à Darwin. - L’inversion des rôles dans la fiction : La planète des singes (film)… - Ouverture sur les découvertes de l’éthologie et la question du droit des animaux. |
|
Exercice oral : une controverse « faut-il accorder des droits aux animaux » ? |
|
|
|
La découverte des autres cultures Les grands voyages d’exploration et l’expansion du monde à partir du XVème siècle : - Exemple de la découverte de l’Amérique. Le changement de la représentation du monde physique. Travailler sur des cartes et des textes d’explorateurs. - La confrontation à des cultures très différentes : L’exemple de « la controverse de Valladolid », la tentation de rejeter l’autre pour ne pas se remettre en cause. Parallèle avec le rejet des animaux. (Texte de Las Casas) - Ouverture : les zoos humains et le racisme. |
|
L’homme vu de l’extérieur : du regard étranger à l’ethnologie - Qu’est-ce qu’une culture ? Et qu’est-ce que nous apprend la diversité des cultures ? - Ouverture : la naissance de l’ethnologie. De l’ethnocentrisme spontané à l’acceptation de la diversité humaine : Lévi-Strauss, Race et histoire.
|
|
- Conclusion générale : vers un nouvel humanisme encore à construire, qui ne se fonde pas sur l’exclusion de figures de l’altérité (animaux, autres « civilisations » ou « races »), mais où l’homme prend aujourd’hui conscience avec les problèmes écologiques des limites et de la finitude de la terre. |
|
Évaluation bilan commune : commentaire philosophique + essai littéraire |
Les pouvoirs de la parole
1) Exemple de travail de problématisation
« L’homme a toujours senti – et les poètes ont souvent chanté – le pouvoir fondateur du langage, qui instaure une réalité imaginaire, anime les choses inertes, fait voir ce qui n’est pas encore, ramène ici ce qui a disparu. C’est pourquoi tant de mythologies, ayant à expliquer qu’à l’aube des temps quelque chose ait pu naître de rien, ont posé comme principe créateur du monde cette essence immatérielle et souveraine, la Parole. Il n’est pas en effet de pouvoir plus haut, et tous les pouvoirs de l’homme, sans exception, qu’on veuille bien y songer, découlent de celui-là. »
Emile Benvéniste, Cours de linguistique générale, p. 25
Parler, c’est exprimer sa pensée au moyen de signes linguistiques. La parole, comme usage par un sujet d’un système de signes, est en elle-même le signe d’une faculté de l’homme, celle de constituer collectivement un système de signes, puis de le comprendre et de l’utiliser individuellement. Autrement dit, la parole est signe de l’intelligence de l’homme, cet animal qui parle, ce smart phone, cette voix intelligente. Mais dire que la parole est le signe d’une faculté ou d’une puissance propre à l’homme, ce n’est pas dire que la parole est en elle-même un pouvoir. Le sceptre de l’empereur est signe de son pouvoir, mais il n’est pas son pouvoir. Or la première question est pour nous de savoir dans quelle mesure la parole a des pouvoirs, voire est un pouvoir. En quoi la parole constituerait-elle par elle-même et en elle-même un pouvoir ?
Parler, c’est exprimer, c’est-à-dire « pousser au dehors ». Par la parole, la pensée est poussée en dehors de nous. L’intention qui préside à toute parole, c’est de faire sortir la pensée de son état initial d’enfermement sur elle-même, de son for intérieur, de telle sorte que nos pensées cessent de n’exister que pour nous. Parler, ainsi, c’est montrer ses pensées à autrui. C’est dire que la parole est toujours fondamentalement adressée : elle est la manifestation à autrui de l’activité intérieure, invisible qu’est notre pensée. La parole suppose donc toujours un auditeur possiblement capable de la comprendre, et par suite que le locuteur et l’auditeur appartiennent à une même communauté linguistique. Parler, c’est abolir le caractère privé d’une pensée ; c’est communiquer au sens premier du mot : « mettre en commun » ce qui ne l’était pas jusqu’alors.
En ce sens, l’on peut dire que parler est un acte qui dérive toujours d’un jugement intérieur premier : nous parlons parce que nous jugeons que notre pensée, d’une manière ou d’une autre, concerne autrui, doit ou mérite de lui être dite. Sinon, serait-on tenté de dire, on ne parle pas, ou du moins ne devrait-on pas le faire. En effet, s’il nous arrive bien de parler tout seuls, le soliloque est souvent, peut-être toujours, regardé comme quelque chose qui ne devrait pas avoir lieu : c’est la parole du fou, qui parle à quelqu’un qui n’est pas là, voire qui se parle à lui-même comme s’il était quelqu’un d’autre ; ou la parole narcissique de celui qui « s’écoute parler » (Narcisse n’écoute que lui-même puisque, enfermé dans l’amour qu’il se porte à lui-même, seule la nymphe Echo répond à ses supplications) ; ou la parole de l’esseulé, de l’abandonné qui tente vainement de parler alors que personne ne l’écoute, ne prête attention à ce qu’il dit. On pourrait objecter que l’écriture est une activité d’expression solitaire tout à fait normale : en effet contrairement à l’image de l’ivrogne parlant tout seul à sa table de bistrot, celle de l’écrivain seul à son bureau loin de nous répugner, nous charme. Ecrire, c’est parler en silence, tout seul, sur du papier. Mais il n’y a là qu’une apparence puisqu’en vérité l’écrivain n’est pas seul à son bureau, mais avec son futur lecteur. La différence entre la parole écrite et la parole orale réside donc moins dans le fait qu’il y ait ou non relation à autrui, que dans la temporalité de la relation à autrui que l’écriture et l’oralité engagent respectivement. En effet, dans la parole écrite le travail d’expression précède la communication (j’exprime mes sentiments, passant par des dizaines de brouillons s’il le faut, puis j’envoie ma lettre en écrivant l’adresse sur l’enveloppe) ; tandis que dans la parole orale l’expression et la communication sont simultanées : je suis écouté au moment même où je parle. Ecrire, c’est fondamentalement tracer sa pensée, lui donner une trace, une forme d’existence durable, substantielle, éternelle, si bien que l’écriture permet la séparation du locuteur et de son destinataire : le destinataire n’a pas besoin d’être présent au moment de l’écriture, et inversement le locuteur n’est pas présent au moment de la lecture. (Au contraire, il serait étrange d’écrire à quelqu’un ou de lire quelqu’un en sa présence, à moins que le locuteur soit aphone ou que l’on veuille ne pas être entendu d’une autre personne présente.) L’écriture est une parole permanente, toujours là, au fond de nos bibliothèques ; parole qui n’est pas une expression solitaire, puisqu’au contraire l’écriture augmente considérablement le champ et le pouvoir de communication de la parole, puisqu’elle permet de l’adresser à autrui, malgré la séparation du rédacteur et du lecteur. La permanence de l’écrit vise précisément à rendre possible cette adresse malgré leur séparation effective. (Cf. annexe 1)
La parole orale suppose, au contraire de la parole écrite, la coprésence de l’orateur et de l’auditeur. Et pour cause : parce que la parole orale s’abolit dans l’acte même de son énonciation, parce qu’elle est un acte fondamentalement temporel, elle est, comme tous les enfants de Chronos, dévorée par lui aussitôt née. La pérexistence de la parole est toute entière suspendue à l’acte d’écoute qui lui est contemporain. La parole, aussitôt achevée, disparaitrait totalement si elle n’existait pas encore dans et par la mémoire de celui qui l’a écoutée. Sans la mémoire de l’auditeur, parler serait comme écrire sur l’eau. C’est donc dans l’écoute que la parole demeure, si bien que la parole appelle l’écoute comme le mourant demande le soignant. Mais si la parole est bien l’enfant de Chronos, c’est parce que la parole est bien une sorte de naissance : non seulement elle met au jour nos pensées au sens où elle les révèle à autrui, mais aussi en un sens plus fondamental où elle les fait exister. Si prendre la parole, c’est commencer à parler, la parole semble être un perpétuel commencement. Les mots naissent dans ma bouche les uns après les autres. La pensée semble se découvrir elle-même au moment où elle s’énonce. Même l’écrivain ne sait pas précisément, au moment où il commence un livre, ce qu’il va y écrire. (Cf. annexe 2) Au moins peut-il se raturer, jeter ses brouillons à la corbeille ; ce que ne peut faire l’orateur : parler, contrairement à écrire, c’est marcher sur un fil sans filet de sécurité. Parce que la parole est adressée au moment même où elle s’exprime, l’expression peut non seulement être maladroite, mais elle est toujours aussi irréversible (« chérie, reviens, ce n’est pas ce que je voulais dire ») D’où le courage que réclame la prise de parole. Prendre la parole, c’est risquer de ne pas parvenir à bien parler, voire de ne pas parvenir à parler tout court. Le bègue s’énerve puis abandonne, humilié, sa tentative d’expression : « un un un ca ca caffff, un expresso. » Le bégaiement est assurément un état pathologique de la parole, dont on sait qu’il peut être lié au stress qu’implique la relation de parole. Mais il ne faut pas oublier qu’en vérité il constitue toujours le rapport natif de l’homme à sa propre parole : l’enfant (de infans qui veut dire celui qui ne parle pas) commence à parler en échouant, en balbutiant (de balbo, qui veut dire bègue). Et si nous parlons avec facilité la plupart du temps, c’est parce que nos paroles sont laconiques et usuelles. Mais dès lors que nous devons tenir la parole, faute d’éloquence, notre parole se disloque. Le roi d’Angleterre Georges VI, qui était bègue, a du parler au peuple anglais durant neuf longues minutes à la radio, pour déclarer la guerre à l’Allemagne nazie : « Je n’ai aucun pouvoir de décision, seulement une autorité qui me vient de ce que le peuple veut que je parle pour lui, et je ne sais pas parler », confie-t-il à son orthophoniste juste avant de prendre l’antenne dans Le discours d’un roi de Tom Hooper. C’est dire que la prise de parole s’apparente moins ici à un pouvoir qu’à une vulnérabilité. Les timides ne parlent pas parce que, craintifs, il se terrent dans le silence qui les protège du regard d’autrui. Le pouvoir semble ici davantage du côté de la conscience observante et jugeante de celui qui écoute : le verbe « écouter » vient d’ailleurs du latin auscultare qui a également donné en français le verbe ausculter. Ecouter, c’est ausculter autrui. Parler, c’est donc conférer à autrui le pouvoir de nous ausculter comme un docteur, de percevoir l’intérieur de notre âme. Si l’écoute sauve la parole, elle permet donc aussi de la juger et de la condamner : « Je vous le dis, de toute parole sans fondement que les hommes auront proférée, ils rendront compte au Jour du Jugement. Car c’est d’après tes paroles que tu seras justifié et c’est d’après tes paroles que tu seras condamné. » dit Jésus dans L’évangile selon Matthieu. La parole demande autrui pour se soumettre à lui : parler, c’est d’ailleurs lui « soumettre ses idées. » C’est nous exposer au double sens du mot : nous montrer, et nous rendre vulnérable. (Cf. annexe 3)
Toutefois, l’écoute n’est pas que l’auscultation figée et surplombante de l’âme d’autrui. L’écoute suppose le silence, de silere qui veut dire se taire. Ecouter, c’est s’abstenir de parler, si bien que prendre la parole, c’est faire taire, c’est couper la parole d’autrui. L’écoute suppose donc que l’on entende au double sens du mot : percevoir les sons (on ne peut rien entendre dans ce brouhaha où tout le monde parle) et comprendre les significations (celui qui ne comprend pas cesse d’ailleurs très vite d’écouter). Mais plus profondément, écouter n’est pas simplement entendre et comprendre un discours, c’est se laisser pénétrer de la parole d’autrui, se laisser modifier, affecter par elle. Ainsi l’élève qui, au professeur lui reprochant ses bavardages, prétend attester de son écoute en répétant ses derniers mots, se leurre : il a entendu, peut-être même compris, mais il n’a pas véritablement écouté. C’est dire que le silence requis par l’écoute de la parole n’est pas seulement un silence extérieur, une absence de bruit, mais aussi un silence intérieur, une suspension du jugement. La parole d’autrui ne peut occuper notre attention qu’à la condition que cette dernière lui ménage une certaine place, un certain vide. Autrement dit, si en parlant nous ouvrons notre âme à autrui, ce n’est que parce qu’il nous a d’abord donné accès à la sienne en nous prêtant l’oreille. Dès lors, parler n’est pas simplement exposer sa pensée au jugement d’autrui, c’est aussi répandre sa pensée, envahir autrui, prendre possession de son âme en emplissant sa mémoire de nos paroles. Ecouter, c’est bien suivre ce que l’on nous dit, en silence, comme on suit un chef. La parole conduit celui qui l’écoute. En ce sens écouter, c’est bien obéir, de obaudire qui signifie précisément « écouter » ! Non seulement toute obéissance suppose que la parole de commandement soit écoutée, mais plus profondément toute écoute est obéissance à la parole écoutée, car toute parole commande d’être écoutée, et ce faisant conduit l’âme de l’auditeur. (Cf annexe 4)
Synthèse du problème :
Si l’on concède que le pouvoir, c’est de trouver obéissance, alors il faudrait admettre maintenant que la parole est la quintessence du pouvoir. L’essence du pouvoir, c’est d’être écouté, c’est d’avoir la parole et de réduire par-là les autres au silence. Mais cela nous révèle une chose aussi fondamentale que paradoxale : l’essence du pouvoir, c’est d’être vulnérable et, à bien des égards, impuissant. La parole est le pouvoir, puisqu’elle seule peut diriger les âmes. Mais elle n’est que parole, faillible, fragile, et vulnérable. Le pouvoir ne serait d’ailleurs jamais un problème s’il n’était foncièrement toujours un manque de pouvoir. L’inquiétude perpétuelle du chef, c’est de ne pas être écouté, de ne pas parvenir à l’être. Parce que la parole est le pouvoir, elle manque de pouvoir, et cherche donc à se donner du pouvoir. Il ne s’agit plus alors de penser le pouvoir que la parole est, mais les pouvoirs que la parole a ou doit avoir pour être pleinement pouvoir : l’art, l’autorité, la séduction.
Annexes
Annexe 1 : La défiance de Platon à l’égard de l’écriture dans Phèdre
Le premier paradoxe de l’écriture est que, en rendant possible l’adresse de la parole malgré la séparation du locuteur et de son lecteur, elle entérine cette séparation, voire la creuse. Parce que les paroles s’envolent et que les écrits restent, l’écriture semble dispenser de l’effort de mémoire. Mais c’est bien ce que Platon, dans la bouche du roi Thamous, reproche à l’invention que Theuth lui présente en ventant « une connaissance qui donnera plus de mémoire » : « L’écriture, lui répond Thamous, développera l’oubli dans les âmes de ceux qui l’auront acquise, par la négligence de la mémoire ; se fiant à l’écrit, c’est du dehors, par des caractères étrangers, et non du dedans, et grâce à l’effort personnel, qu’on rappellera ses souvenirs. Tu n’as donc pas trouvé un remède pour fortifier la mémoire, mais pour aider à se souvenir. » La multiplication des discours écrits, leur disponibilité permanente, engendre des ignorants. Mais il y a plus dans la défiance platonicienne à l’égard de l’écriture : par ces traces, la parole gagne en habileté tout en perdant son adresse. En effet, dans la tranquillité de son bureau, le logographe peut élaborer son discours, lui faire atteindre son point d’excellence, en faire une œuvre. Mais la séparation de l’écrivain et du lecteur que présuppose l’écriture a deux inconvénients majeurs : d’une part le lecteur ne peut interroger l’orateur, alors même que l’écrit, enfermé dans son silence figé, « a toujours besoin du secours de son père » ; d’autre part comme le lecteur n’est pas présent lors de l’adresse de la parole écrite, celle-ci ne sait pas vraiment à qui elle s’adresse, ne peut observer comment elle est reçue. Ecrire, c’est toujours un peu comme jeter une bouteille à la mer, c’est parler à l’aveuglette : « Une fois écrit, chaque discours s’en va rouler de tous côtés, et passe indifféremment à ceux qui s’y connaissent et à ceux qui n’ont rien à en faire ; il ignore à qui il doit ou ne doit pas s’adresser. » Dès lors une librairie ressemble à un capharnaüm où chaque auteur de discours parle tout le temps, en même temps que tous les autres, et en s’adressant à n’importe quel lecteur. Ce capharnaüm silencieux s’appelle aujourd’hui « internet », et plus spécifiquement le « réseau social ». En ce sens, le paradoxe de la trace écrite est qu’en voulant sauver la pensée, elle la tue. Prenez en notes.
(Analyse à développer davantage).
Annexe 2 : Merleau-Ponty, extrait de la Phénoménologie de la perception (p.206)
« Si la parole présupposait la pensée, si parler c’était d’abord se joindre à l’objet par une intention de connaissance ou par une représentation, on ne comprendrait pas pourquoi la pensée tend vers l’expression comme vers son achèvement, pourquoi l’objet le plus familier nous paraît indéterminé tant que nous n’en avons retrouvé le nom, pourquoi le sujet pensant lui-même est dans une sorte d’ignorance de ses pensées tant qu’il ne les a pas formulées pour soi ou même dites et écrites, comme le montre l’exemple de tant d’écrivains qui commencent un livre sans savoir au juste ce qu’ils y mettront. Une pensée qui se contenterait d’exister pour soi, hors des gènes de la parole et de la communication, aussitôt apparue tomberait à l’inconscience, ce qui reviendrait à dire qu’elle n’existerait même pas pour soi. »
Annexe 3 : La supériorité de l’écoute et la vulnérabilité de la parole dans le Sermon XXIII de Saint Augustin
« Bien qu’en raison de la commodité pour faire entendre notre voix, nous paraissons nous tenir en un lieu plus élevé que vous, pourtant c'est d’un lieu réellement plus élevé encore que vous jugez, et que nous, nous sommes jugés par vous. On nous appelle docteurs, mais nous avons souvent besoin d'un docteur et nous ne voulons point passer pour maîtres : il y aurait danger et prévarication, car le Seigneur a dit : « Ne cherchez point à être appelés maîtres ; vous n'avez qu'un maître, le Christ » Il y a donc danger à être maître, sécurité à être disciple. Aussi est-il dit dans un psaume : « Vous ferez entendre à mon oreille la joie et l'allégresse » et l’auditeur du verbe est moins exposé en entendant la divine parole que celui qui la profère ; il reste tranquillement debout, il écoute et se réjouit à la voix de l'Époux. »
Annexe 4 : la psychagogie dans le Phèdre de Platon (271c-272b traduction de Paul Vicaire)
« Puisque le propre du discours est d’être une psychagogie, un art de conduire les âmes, celui qui se propose d’être un habile orateur doit nécessairement savoir combien il y a d’espèces d’âmes. Or il y en a un tel et tel nombre, avec telles et telles qualités – et par suite se constituent en telles et telles personnalités. Une fois ces distinctions établies, on passe aux discours : il y en a telle et telle espèce, et chacun a tel et tel caractère. Dès lors tels hommes, en vertu de la relation causale dont je parlais, sous l’action de tels discours, sont faciles à persuader de telle chose ; et tels autres hommes, pour cette même raison, sont difficiles à persuader. Quand on a suffisamment réfléchi sur tout cela, il faut après en considérer l’effet et l’application pratique, avec un sens assez fin pour en suivre le développement. Autrement on ne gagnerait rien par rapport aux discours entendus naguère, à l’école. Mais quand on est à même de dire par quels discours est persuadé tel homme, et qu’on peut, étant à ses côtés, voir clair en lui et se faire à soi-même la leçon : « Voilà l’homme, voilà la nature dont naguère on parlait à mes cours ; à présent, cette nature est devant moi, et il faut lui appliquer les discours que voici, pour faire naître la persuasion que voici », - lors donc qu’on est en possession de toutes ces données, qu’on y ajoute la connaissance des conjectures dans lesquelles il faut parler ou se taire, qu’on sait en outre discerner l’opportunité, ou l’inopportunité tout aussi bien, du style concis, du style apitoyant, du style véhément, et de toutes les formes de discours qu’on aura apprises – alors la beauté et la perfection de l’art sont atteintes ; auparavant, c’est impossible. Mais si en parlant, en écrivant, une partie de ces conditions vient à faire défaut, on a beau prétendre parler avec art : celui qu’on ne réussit pas à persuader a l’avantage. »
2) Propositions de textes philosophiques
Aristote: définition de la parole
Les sons émis par la voix sont les symboles des états de l’âme, et les mots écrits les symboles des mots émis par la voix. Et de même que l’écriture n’est pas la même chez tous les hommes, les mots parlés ne sont pas non plus les mêmes, bien que les états de l’âme dont ces expressions sont les signes immédiats soient identiques chez tous, comme sont identiques aussi les choses dont ces états sont les images. […]
Et de même qu’il existe dans l’âme tantôt un concept indépendant du vrai et du faux, et tantôt un concept à qui appartient nécessairement l’un ou l’autre, ainsi en est-il pour la parole ; car c’est dans le composition et la division que consiste le vrai et le faux. En eux-mêmes les noms et les verbes sont semblables à la notion qui n’a ni composition, ni division : tels sont l’homme, le blanc, quand on y ajoute rien, car ils ne sont encore ni vrais, ni faux. En voici une preuve : bouc-cerf signifie bien quelque chose, mais il n’est encore ni vrai, ni faux, à moins d’ajouter qu’il est ou qu’il n’est pas, absolument parlant ou avec référence au temps.
Aristote, De l’interprétation, IV av. JC
Gorgias, la puissance de la parole
(8) Le discours est un tyran très puissant qui, par un corps très petit et tout à fait invisible, accomplit des actes au plus haut point divins, car la parole peut faire cesser la peur, dissiper le chagrin, exciter la joie, accroître la pitié […] Les incantations enthousiastes nous procurent du plaisir par l’effet des paroles, et chassent le chagrin. C’est que la puissance de l’incantation, dans l’âme, se mêle à l’opinion, la charme, la persuade et, par sa magie, change ses dispositions. De la magie et de la sorcellerie sont nés deux arts qui produisent les erreurs de l’âme et les artifices de l’opinion. (11) Nombreux sont ceux qui, sur nombre de sujets, ont convaincu et convainquent encore nombre de gens par la fiction d’un discours mensonger. Car si tous les hommes avaient en leur mémoire le déroulement de tout ce qui s’est passé, s’ils connaissaient tous les événements présents, et, à l’avance, les événements futurs, le discours ne seraient pas investi d’une telle puissance ; mais lorsque les gens n’ont pas la mémoire du passé, ni la vision du présent, ni la divination de l’avenir, il a toutes les facilités. C’est pourquoi la plupart du temps, les gens confient leur âme aux conseils de l’opinion. Mais l’opinion est incertaine et instable, et précipite ceux qui en font usage dans des fortunes incertaines et instables.
Gorgias, Eloge d’Hélène, §8-11, Ve av JC.
Aristote : définition de la rhétorique
La rhétorique est le pendant de la dialectique : car l’une et l’autre portent sur des matières qui – étant communes, d’une certaine façon, à tout le monde – sont la compétence de tout un chacun et ne relèvent d’aucune science délimitée. C’est pourquoi tout le monde, d’une certaine façon, prend part aux deux, car tout le monde, jusqu’à un certain point, se mêle tant de critiquer ou de soutenir un argument que de défendre ou d’accuser. Cela dit, la plupart des gens le font soit au petit bonheur, soit par une familiarité dérivée d’une disposition acquise (hexis). Mais puisqu’on peut y parvenir des deux manières, il est clair qu’en ces matières, on pourrait procéder aussi par méthode. Car la cause pour laquelle on parvient à ses fins tant par familiarité que du fait du hasard, il est possible de la discerner et – tout le monde , dès lors peut en convenir – une telle étude est la tâche d’une technique.
Utilité de la rhétorique, p. 120-122.
La rhétorique est utile, d’abord parce que le vrai et le juste ont naturellement plus de force que leurs contraires ; aussi, quand les décisions ne sont pas convenablement prises, est-ce nécessairement par sa propre faute que l’on est battu et cela mérite d’être blâmé. En outre, il y a de certaine personnes que, eussions-nous la science la plus exacte, nous ne saurions grâce à elle facilement persuader par nos discours. c’est en effet à l’enseignement qu’appartient le discours conforme à la science, chose impraticable ici. […]
En outre, il faut être capable de persuader des thèses contraires, comme aussi dans les syllogismes, non pour soutenir effectivement l’une et l’autre (car il ne faut pas persuader de ce qui est mal) mais pour que le procédé ne nous échappe pas et afin que, si quelqu’un d’autre use des discours à des fins injustes, nous soyons nous-mêmes en état de la réfuter. […]
De surcroît, il serait absurde, alors qu’il est honteux d’être incapable de se défendre physiquement, qu’il ne soit pas honteux de ne pouvoir le faire verbalement, mode de défense plus propre à l’homme que le recours à la force physique. Mais, objectera-t-on, user à des fins injustes de cette puissance du discours peut nuire gravement, à quoi l’on rétorquera que cet inconvénient est commun à tous les biens – excepté la vertu – et surtout aux aux biens les plus utiles comme la force, la santé, la richesse et le pouvoir.
Ch. 2. (Re)définition de la rhétorique, p. 124-126.
Posons que la rhétorique est la capacité de discerner dans chaque cas ce qui est potentiellement persuasif. […]
Parmi les moyens de persuasion, les uns sont non techniques, les autres techniques. j’appelle non technique tout ce qui n’est pas fourni par nous, mais existait préalablement, comme les témoins, [...] etc. ; est technique tout ce qu’il est possible d’élaborer par la méthode et par nous-mêmes. Aussi, parmi ces moyens, les uns sont-ils à utiliser, les autres à découvrir. Parmi les moyens de persuasion fournis par le moyen du discours, il y a trois espèces. Les uns, en effet, résident dans le caractère de celui qui parle, les autres dans le fait de mettre l’auditeur dans telle ou telle disposition, les autres dans le discours lui-même, par le fait qu’il démontre ou paraît démontrer.
Aristote, La poétique : la mimesis et les vertus de la fiction
A l’origine de l’art poétique dans son ensemble, il semble bien y avoir deux causes, toutes deux naturelles. Imiter est en effet, dès leur enfance, une tendance naturelle aux hommes – et ils se différencient des autres animaux en ce qu’ils sont des êtres fort enclins à imiter et qu’ils commencent à apprendre à travers l’imitation –, comme la tendance commune à tous, de prendre plaisir aux représentations ; la preuve en est ce qui se passe dans les faits : nous prenons plaisir à contempler des images les plus exactes de choses dont la vue nous est pénible dans la réalité, comme les formes d’animaux les plus méprisés et les cadavres. Une autre raison est qu’apprendre est un grand plaisir non seulement pour les philosophes, mais pareillement aussi pour les autres hommes – quoique les points communs entre eux soient peu nombreux à ce sujet. On se plaît en effet à regarder les images car leur contemplation apporte un enseignement et permet de se rendre compte de ce qu’est chaque chose […]
Ch. VI, p. 92-93.
la tragédie est donc l’imitation d’une action noble, conduite jusqu’à sa fin et ayant une certaine étendue, en un langage relevé d’assaisonnement dont chaque espèce est utilisée séparément selon les parties de l’oeuvre ; c’est une imitation faite par des personnages en action et non par le moyen d’une narration, et qui par l’entremise de la pitié et de la crainte, accomplit la purgation des émotions de ce genre…
Ch. IX, p. 98.
Le rôle du poète est de dire non pas ce qui a réellement eu lieu mais ce à quoi on peut s’attendre, ce qui peut se produire conformément à la vraisemblance ou à la nécessité. En effet la différenciation entre l’historien et le poète ne vient pas du fait que l’un s’exprime en vers ou l’autre en prose (…) ; mais elle vient de ce fait que l’un dit ce qui a eu lieu, l’autre ce à quoi on peut s’attendre. Voilà pourquoi la poésie est une chose plus philosophique et plus noble que l’histoire : la poésie dit plutôt le général, l’histoire le particulier.
Marcel Détienne, Les maîtres de vérité dans la Grèce archaïque : changement de l’autorité de la parole
Dans la Grèce archaïque, trois personnages, le devin, l’aède, le roi de justice, ont en commun le privilège de dispenser la vérité du seul fait d’être pourvus des qualités qui les distinguent. Le poète, le voyant et le roi partagent un même type de parole. Grâce à la puissance religieuse de mémoire, de Mnémosyné, le poète ainsi que le devin ont directement accès à l’au-delà, ils perçoivent l’invisible, ils énoncent « ce qui a été, ce qui est, ce qui sera. » Doté de ce savoir inspiré, le poète célèbre par sa parole chantée les exploits et les actions humaines qui entrent ainsi dans l’éclat et la lumière et qui reçoivent force vitale et plénitude de l’être. De façon homologue, la parole du roi, se fondant sur des procédures ordaliques, possède une vertu oraculaire ; elle réalise la justice, elle instaure l’ordre du droit sans preuve ni sans enquête. […] le discours vrai, c’est « le discours prononcé par qui de droit et selon le rituel requis », ainsi que le dira Michel Foucault [dans L’ordre du discours]. […]
Quelle est donc la place du philosophe et du sophiste dans la lignée des « Maîtres de vérité » ? Comment la parole de l’un et de l’autre se différencie-t-elle de la parole efficace et porteuse de réel que profèrent devin, poète et roi de justice ? Comment se fait le passage d’une pensée marquée par l’ambiguïté et par sa logique à une autre qui semble ouvrir un nouveau régime intellectuel, celui de l’argumentation, du principe de non-contradiction, ainsi que dialogue avec le sens, avec l’objet d’un énoncé et de sa référence ?
Il nous a semblé que le contexte socio-historique pouvait contribuer à une généalogie de l’idée de vérité. […] Nous avons relevé les marques d’un procès de laïcisation de la parole […] dans l’assemblée militaire apportant le droit égal à la parole pour tous ceux qui font partie du cercle des guerriers et peuvent ainsi discuter des affaires communes. Quand la réforme hoplitique, par l’imposition d’un nouveau type d’armement et de comportement à la guerre, entre dans les usages de la cité, aux environs de 650 avant notre ère, quand cette réforme favorise l’apparition des citoyens-soldats « égaux et semblables », la parole dialogue, la parole profane, celle qui agit sur autrui, la parole qui cherche à persuader et se réfère aux affaires du groupe, ce type de parole gagne du terrain et, peu à peu, rend désuète la parole efficace et porteuse du vrai.
Par sa fonction nouvelle et qui est fondamentalement politique, en rapport avec l’agora, le logos, parole et langage, devient un objet autonome, soumis à ses propres lois. Deux grandes directions vont s’ouvrir dans la réflexion sur le langage. d’une part, le logos, comme instrument des rapports sociaux : quel est son mode d’action sur autrui ? Rhétorique et sophistique vont analyser les techniques de persuasion, développer l’analyse grammaticale et stylistique du nouvel instrument. Tandis que l’autre voie, explorée par la philosophie, s’ouvre sur le logos comme moyen de connaissance du réel : la parole est-elle le réel, tout le réel ? Et qu’en est-il du réel exprimé par les nombres, celui que découvrent les mathématiciens et les géomètres ?
Marcel Détienne, Les maîtres de vérité dans la Grèce archaïque, p. 6-8
Foucault, l’autorité du discours
Chez les poètes grecs du VIe siècle encore, le discours vrai – au sens fort et valorisé du mot – le discours pour lequel on avait respect et terreur, celui auquel il fallait bien se soumettre, parce qu’il régnait, c’était le discours prononcé par qui de droit et selon le rituel requis ; c’était le discours qui disait la justice et attribuait à chacun sa part ; c’était le discours qui, prophétisant, non seulement annonçait ce qui allait se passer , mais contribuait à sa réalisation, emportait avec soi l’adhésion des hommes et se tramait ainsi avec le destin. Or voilà qu’un siècle plus tard la vérité la plus haute ne résidait plus déjà dans ce qu’était le discours ou dans ce qu’il faisait, elle résidait dans ce qu’il disait : un jour est venu où la vérité s’est déplacée de l’acte ritualisé, efficace, et juste, d’énonciation, vers l’énoncé lui-même : vers son sens, sa forme, son objet, son rapport à sa référence. Entre Hésiode et Platon un certain partage s’est établi, séparant la discours vrai et le discours faux ; partage nouveau puisque désormais le discours vrai n’est plus le discours précieux et désirable, puisque ce n’est plus le discours lié à l’exercice du pouvoir. Le sophiste est chassé.
Foucault, L’ordre du discours, Gallimard, 1971, p. 16-17
Aristote, le syllogisme (les règles à suivre pour atteindre la vérité par le discours)
Le syllogisme est un discours dans lequel, certaines [propositions] étant posées, une autre distincte des premières s’ensuit nécessairement, en vertu même des propositions qui ont été posées. C’est une démonstration quand le syllogisme a pour point de départ des propositions vraies et premières, ou des propositions telles que la connaissance que nous en avons est tirée de propositions premières et vraies. C’est, en revanche, un syllogisme dialectique lorsqu’il conclut à partir de propositions admises. Sont vraies et premières les propositions qui produisent la conviction, non pas par d’autres propositions, mais en vertu d’elles-mêmes (concernant les principes de la connaissance scientifique, on ne doit pas se mettre en quête de leur pourquoi, chacun de ces principes doit de lui-même produire la conviction) ; sont admises les opinions reçues par tous les hommes, ou par la plupart d’entre eux, ou par les plus avisés, et, parmi ces derniers, soit par tous, soit par la plupart, soit enfin par les plus réputés et les plus connus. C’est un syllogisme éristique quand il part de propositions qui, tout en paraissant admises, en réalité ne le sont pas ; ou encore le syllogisme qui ne conclut qu’en apparence de propositions admises ou paraissant admises.
Aristote, Topiques, I 1100a25, (IVème av. JC)
Bourdieu, d’où vient le pouvoir de la parole
La compétence suffisante pour produire des phrases susceptibles d’être comprises peut être tout à fait insuffisante pour produire des phrases susceptibles d’être écoutées, des phrases propres à être reconnues comme recevables dans toutes les situations où il y a lieu de parler. Ici encore, l’acceptabilité sociale ne se réduit pas à la seule grammaticalité. Les locuteurs dépourvus de la compétence légitime se trouvent exclus en fait des univers sociaux où elle est exigée, ou condamnés au silence. Ce qui est rare donc, ce n’est pas la capacité de parler qui, étant inscrite dans le patrimoine biologique, est universelle, donc essentiellement non distinctive, mais la compétence nécessaire pour parler la langue légitime qui, dépendant du patrimoine social, retraduit des distinctions sociales dans la logique proprement symbolique des écarts différentiels ou, en un mot, de la distinction.
Bourdieu, Ce que parler veut dire, Fayard, 1982, p. 42
Aristote, l’homme est un animal politique grâce au langage
L’homme est par nature un animal politique, et que celui qui est hors cité, naturellement bien sûr et non par le hasard des circonstances, est soit un être dégradé soit un être surhumain [...] L’homme est un animal politique plus que n’importe quelle abeille et que n’importe quel animal grégaire. Car, comme nous le disons, la nature ne fait rien en vain ; or seul parmi les animaux l’homme a un langage. Certes la voix est le signe du douloureux et de l’agréable, aussi la rencontre-t-on chez les animaux ; leur nature, en effet, est parvenue jusqu’au point d’éprouver la sensation du douloureux et de l’agréable et de se le signifier mutuellement. Mais le langage existe en vue de manifester l’avantageux et le nuisible, et par suite aussi le juste et l’injuste. Il n’y a en effet qu’une chose qui soit propre aux hommes par rapport aux autres animaux : le fait que seuls ils aient la perception du bien, du mal, du juste et de l’injuste et des autres notions de ce genre. Or, avoir de telles notions en commun c’est ce qui fait une famille et une cité.
Aristote, Les politiques (IVe siècle av. JC), Livre I, 2.
Aristote : la délibération collective est meilleure que l’expertise
Un choix correct est l'affaire de ceux qui savent ; par exemple choisir un géomètre est l'affaire de ceux qui savent la géométrie, choisir un pilote, de ceux qui savent le pilotage. Car si certains travaux ou certains arts sont quelquefois pratiqués par des hommes étrangers à ces professions, toujours est-il que c'est plutôt le fait de ceux qui savent. De sorte que, suivant cette manière de raisonner, ce ne serait pas la multitude qu'il faudrait rendre maîtresse du choix et de la reddition de comptes des magistrats (1). Mais peut-être aussi que cette objection n'est pas très juste, à moins qu'on ne suppose une multitude par trop abrutie. Car chacun des individus qui la composent sera sans doute moins bon juge que ceux qui savent ; mais, réunis tous ensemble, ils jugeront mieux, ou du moins aussi bien. Ensuite, il y a des choses dont celui qui les fait n'est ni le seul ni le meilleur juge ; ce sont tous les ouvrages que ceux mêmes qui ne possèdent pas l'art peuvent connaître : pour une maison, ce n'est pas seulement à celui qui l'a bâtie qu'il appartient de la connaître ; celui qui s'en sert en jugera aussi et mieux ; et celui-là, c'est celui qui tient la maison. Le pilote, de même, jugera mieux d'un gouvernail que le charpentier ; un festin, c'est le convive qui en juge et non le cuisinier. C'est ainsi qu'on pourrait résoudre d'une manière satisfaisante l'objection proposée.
(1) Dans la cité démocratique grecque, les magistrats devaient, en fin de mandat, rendre compte de leur gestion devant le peuple ou un jury populaire.
Aristote, Les politiques
3) Autre proposition de textes
HLP – Semestre 1 – Recueil de textes - philosophie
Ancien Testament, Pentateuque, Exode (traduction Segond, 1874, révisée en 1910)
Rappel du contexte : Dieu demande à Moïse de se présenter, en son nom, au peuple d’Israël, comme son guide et de le faire sortir d’Egypte où il est réduit en esclavage. Mais Moïse, craignant de n’être cru ni du peuple, ni de Pharaon, s’inquiète de la manière dont il pourra s’acquitter de cette tâche
« Moïse répondit, et dit : Voici, ils ne me croiront point, et ils n’écouteront point ma voix. Mais ils diront : L’Éternel ne t’est point apparu.
L’Éternel lui dit : Qu’y a-t-il dans ta main ? Il répondit : Une verge.
L’Éternel dit : Jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui.
L’Éternel dit à Moïse : Étends ta main, et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main.
C’est là, dit l’Éternel, ce que tu feras, afin qu’ils croient que l’Éternel, le Dieu de leurs pères, t’est apparu, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob.
L’Éternel lui dit encore : Mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein ; puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige.
L’Éternel dit : Remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein ; puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair.
S’ils ne te croient pas, dit l’Éternel, et n’écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe.
S’ils ne croient pas même à ces deux signes, et n’écoutent pas ta voix, tu prendras de l’eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l’eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre.
Moïse dit à l’Éternel : Ah ! Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n’est ni d’hier ni d’avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur ; car j’ai la bouche et la langue embarrassées.
L’Éternel lui dit : Qui a fait la bouche de l’homme ? et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle ? N’est-ce pas moi, l’Éternel ?
Va donc, je serai avec ta bouche, et je t’enseignerai ce que tu auras à dire.
Moïse dit : Ah ! Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer.
Alors la colère de l’Éternel s’enflamma contre Moïse, et il dit : N’y a t-il pas ton frère Aaron, le Lévite ? Je sais qu’il parlera facilement. Le voici lui-même, qui vient au-devant de toi ; et, quand il te verra, il se réjouira dans son cœur.
Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche ; et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire.
Il parlera pour toi au peuple ; il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu »
Saint Augustin, Du Maître, Chapitre premier
Du Maître est un dialogue entre Saint Augustin (354-430) et son fils, Adéodat, âgé d’une quinzaine d’années.
« Augustin. : Que penses-tu que nous voulions faire en parlant ?
Adéodat. : Je crois, au moins pour le moment, que nous voulons enseigner ou nous instruire.
Aug. : Je le reconnais, car la chose est manifeste : en parlant, nous voulons instruire ; mais comment voulons-nous apprendre nous-mêmes ?
Ad. : Comment ? n'est-ce pas en interrogeant ?
Aug. : Mais, alors même, je le vois, nous ne voulons qu'instruire. Quand, en effet, tu interroges quelqu'un, n'est-ce pas uniquement pour lui apprendre ce que tu veux ?
Ad. : C'est vrai.
Aug. : Tu comprends donc qu'en parlant, nous ne cherchons qu'à instruire ?
Ad. : Je ne le vois pas parfaitement. Car si parler n'est autre chose que proférer des paroles, il est certain que nous parlons en chantant. Or, quand nous chantons seuls, comme il arrive souvent, et que personne n'est là pour entendre, voulons-nous enseigner quelque chose ? Je ne le pense pas.
Auq. : Pour moi, je pense que le chant appartient à une manière fort générale d'instruire elle consiste à réveiller les souvenirs, et cet entretien la fera comprendre suffisamment. Si néanmoins tu n'es pas d'avis que parle souvenir nous instruisions, ni nous-mêmes, ni celui en qui nous le ranimons, je ne conteste pas. Ainsi voilà deux motifs déjà pour lesquels nous parlons : nous voulons en effet, ou enseigner, ou rappeler des souvenirs soit à nous-mêmes, soit à d'autres ; ce que nous faisons aussi en chantant : ne le crois-tu pas comme moi ?
Ad. : Non, car il est fort rare qu'en chantant je cherche des souvenirs, je cherche plutôt le plaisir.
Auq. : Je vois ta pensée. Mais ne remarques-tu point que le plaisir du chant vient en toi de l'harmonie des sons, et que cette Harmonie étant indépendante des paroles auxquelles elle peut s'unir, comme elle en peut être séparée, le chant est autre chose que la parole ? On chante sur la flûte et sur la guitare, les oiseaux chantent aussi, il nous arrive à nous-mêmes de faire entendre des airs de musique sans les accompagner de paroles : ces airs peuvent alors s'appeler un chant et non un langage. Peux-tu me contredire ?
Ad. : Nullement.
Auq. : Tu vois donc que le langage n'a été institué que pour enseigner ou rappeler des souvenirs ? »
Homère, l’Odyssée, chant I
Rappel du contexte : Télémaque vient d’avoir une longue conversation avec Athéna, déguisée sous la forme d’un voyageur modeste. A la fin de l’échange, Athéna redonne du courage à Télémaque qui reconnait la déesse en elle. C’est donc le cœur à nouveau vaillant qu’il rejoint l’endroit où la troupe des prétendants boit en écoutant Phémios l’Aède.
« Puis, le divin jeune homme s’approcha des Prétendants.
Et l’Aède très-illustre chantait, et ils étaient assis, l’écoutant en silence. Et il chantait le retour fatal des Acchéens, que Pallas Athèna leur avait infligé au sortir de Troie. Et, de la haute chambre, la fille d’Ikarios, la sage Pènélope, entendit ce chant divin, et elle descendit l’escalier élevé, non pas seule, mais suivie de deux servantes. Et quand la divine femme fut auprès des Prétendants, elle resta debout contre la porte, sur le seuil de la salle solidement construite, avec un beau voile sur les joues, et les honnêtes servantes se tenaient à ses côtés. Et elle pleura et dit à l’Aède divin :
— Phèmios, tu sais d’autres chants par lesquels les Aèdes célèbrent les actions des hommes et des Dieux. Assis au milieu de ceux-ci, chante-leur une de ces choses, tandis qu’ils boivent du vin en silence ; mais cesse ce triste chant qui déchire mon cœur dans ma poitrine, puisque je suis la proie d’un deuil que je ne puis oublier. Car je pleure une tête bien aimée, et je garde le souvenir éternel de l’homme dont la gloire emplit la Grèce et Argos.
Et le sage Tèlémaque lui répondit :
— Ma mère, pourquoi défends-tu que ce doux Aède nous réjouisse, comme son esprit le lui inspire ? Les Aèdes ne sont responsables de rien, et Zeus dispense ses dons aux poètes comme il lui plaît. Il ne faut point t’indigner contre celui-ci parce qu’il chante la sombre destinée des Danaens, car les hommes chantent toujours les choses les plus récentes. Aie donc la force d’âme d’écouter. Ulysse n’a point perdu seul, à Troie, le jour du retour, et beaucoup d’autres y sont morts aussi. Rentre dans ta demeure ; continue tes travaux à l’aide de la toile et du fuseau, et remets tes servantes à leur tâche. La parole appartient aux hommes, et surtout à moi qui commande ici.
Étonnée, Pènélope s’en retourna chez elle, emportant dans son cœur les sages paroles de son fils »
Philippe BRETON, Éloge de la parole (2003)
« D'un côté, on peut constater que la parole humaine n'a probablement jamais connu autant de possibilités de déploiement qu'aujourd'hui. Où qu'on se tourne dans les sociétés modernes, on trouve, souvent comme signe de progrès, des techniques de communication ou encore des institutions qui sont directement une concrétisation ou une facilitation de la parole. La parole aujourd'hui est un fait social majeur. C'est par elle que nous agissons, que nous prenons des décisions, que nous négocions, que nous tentons de faire reculer la violence, que nous organisons et transformons le monde qui nous entoure.
Pourtant, d'un autre côté, en même temps que ce déplacement du statut de la parole, qui lui confère une position toujours plus centrale, chacun sent bien que ce déploiement est souvent au mieux retenu, au pire dévoyé. Nous sommes là au cœur de l'injonction contradictoire : parlez, mais taisez-vous ! Il s'agit d'un véritable paradoxe, car à la fois la parole est libre, encouragée, elle est un des principaux opérateurs du changement social, et à la fois elle est difficile à prendre ou encore réduite à un discours sans effet, quand elle n'est pas travestissement de la pure violence. De plus, cette importance, cette centralité de la parole n'est qu'en partie visible à nos yeux. La parole moderne n'est qu'en partie consciente d'elle-même, elle n'est même parfois que l'ombre de son idéal.
Une vision optimiste des choses permettra de dire que ce qui compte le plus aujourd'hui est la place prise par la parole qui fait de nos sociétés de véritables sociétés de parole. Le symbole le plus fort de cet aspect des choses sera par exemple la « liberté d'expression » qui connaît un déploiement sans égal dans l'histoire. On insistera également sur les immenses possibilités offertes par les techniques modernes de communication, dont Internet n'est qu'une avant-garde. Ou encore sur le fait que nous vivons en démocratie, ou, pour être plus précis, dans des sociétés« en voie de démocratisation », c'est-à-dire un régime où la parole tend de plus en plus à être au centre des processus sociaux de décision et d'action.
Une vision pessimiste de la même réalité soulignera les immenses inégalités d'accès à la parole et le fait qu'elle est souvent manipulée par les puissants. La parole, pour reprendre l'expression de Jacques Ellul, est trop souvent une « parole humiliée ». Dans cette optique, on insistera sur le fait que les nombreuses techniques de communication déployées aujourd'hui ne correspondent pas forcément à un accroissement de la qualité des paroles qu'elles servent à transmettre, ou même que, à être tant délayée, la parole s'y affadit considérablement.
Il faut donc tenter une approche la plus objective possible de ce phénomène. La question n'est pas l'optimisme ou le pessimisme, mais bien une juste évaluation de la place prise par la parole dans les sociétés modernes. [...] Toute évaluation, dans le domaine social, est souvent une question d'échelle. Le point de vue optimiste se révèle pertinent si l'on place l'observation sur une échelle temporelle large : on a assisté à un déplacement du statut de la parole (par exemple, en France, de la fin du Moyen Âge à l'époque contemporaine) qui lui confère une position de plus en plus centrale et qui contribue largement, entre autres, au progrès des mœurs et de la civilité.
Le point de vue pessimiste est imbattable pour décrire les très nombreuses situations, au présent, qui témoignent de notre frustration devant les dévoiements de ce qui apparaît le plus souvent comme une potentialité en lieu et place d'une réalité. En somme, la direction est bonne mais on risque à chaque moment de verser dans le fossé.
L'optimiste a une vision globale, mais celle-ci ne le protège pas contre les accidents, y compris ceux qui risquent d'arrêter la course. Le pessimiste a un point de vue précieux puisqu'il pointe du doigt, avec rigueur, tout écart du chemin, ou toute retenue dans l'élan, mais il risque de décourager la poursuite de la course en répétant inlassablement que l'on se trompe de direction, alors que l'on va peut-être, globalement, dans le bon sens.
Il est tentant malgré tout de prendre de la hauteur par rapport à ce balancement entre optimisme et pessimisme pour voir que sur la longue durée, celle des civilisations, partout où il y a de la parole, il y a du progrès. Thèse renversable, tant les deux termes sont identifiés l'un à l'autre : partout où il y a du progrès, il y a de la parole. Que ce progrès soit aujourd'hui en partie retenu ne change rien à sa direction.
Nous l'avons vu, ces progrès sont de deux ordres : d'abord, une capacité toujours accrue pour l'homme de prendre en main son destin (c'est-à-dire de ne plus être subordonné au fatalisme), en inventant des représentations (par exemple celle de l'homme comme individu), des pratiques sociales (comme la « civilité,) et des institutions (notamment démocratiques) qui permettent à la parole de se déployer; ensuite, à un autre niveau, celui des moyens, un affinement de la parole ellemême dans sa capacité à changer le monde. Ce progrès peut connaître des revers, mais, dans un certain sens, la direction d'ensemble est la bonne et c'est, au bout du compte, toujours, la société des hommes qui s'en porte mieux. C'est dans ce sens que la parole, comme fondement d'un humanisme renouvelé, mérite, pour le moins, un éloge. »
Apollonios de Rhodes (3ème siècle av. JC), l’expédition des Argonautes ou la conquête de la toison d’or, Chant I
Rappel du contexte : Jason est élu chef de l’expédition des Argonautes ; avant le départ de l’expédition, les hommes se rassemblent en un grand banquet. Mais une querelle éclate entre deux Argonautes. Orphée prend alors sa lyre…
« Dans le même temps le divin Orphée prit en main sa lyre, et mêlant à ses accords les doux accents de sa voix, il chanta comment la terre, le ciel et la mer, autrefois confondus ensemble, avaient été tirés de cet état funeste de chaos et de discorde, la route constante que suivent dans les airs le soleil, la lune et les autres astres, la formation des montagnes, celle des fleuves, des Nymphes et des animaux. Il chantait encore comment Ophyon et Eurynome, fille de l'Océan, régnèrent sur l'Olympe, jusqu'à ce qu'ils en fussent chassés et précipités dans les flots de l'Océan par Saturne et Rhéa, qui donnèrent des lois aux heureux Titans. Jupiter était alors enfant ; ses pensées étaient celles d'un enfant. Il habitait dans un antre du mont Dicté, et les Cyclopes n'avaient point encore armé ses mains de la foudre, instrument de la gloire du souverain des dieux. Orphée avait fini de chanter, et chacun restait immobile. La tête avancée, l'oreille attentive, on l'écoutait encore, tant était vive l'impression que ses chants laissaient dans les âmes. »
Chant IV : les argonautes ont conquis la toison d’or mais le navire erre sur les eaux.
« Les Argonautes, s'étant ensuite rembarqués à la faveur d'un vent du midi, voguaient au hasard et ne savaient quelle route tenir pour sortir du lac Triton. Tel qu'au milieu des ardeurs du jour un serpent, brûlé par les rayons du soleil, se traîne obliquement et l'œil en feu tourne de tous côtés sa tête en poussant d'horribles sifflements, jusqu'à ce qu'il ait gagné l'entrée de sa retraite, ainsi le navire Argo erre longtemps çà et là pour parvenir à l'embouchure du lac. Dans ce cruel embarras, Orphée commande à ses compagnons de descendre à terre et de se rendre les divinités du pays favorables en leur consacrant un grand trépied, présent d'Apollon. La cérémonie fut à peine achevée que le dieu Triton lui-même leur apparut sous la forme d'un jeune homme tenant dans la main une poignée de terre qu'il leur présenta en disant : « Recevez, mes amis, ce gage de l'hospitalité : je n'en ai pas dans ce moment de plus précieux à vous offrir, mais si, comme étrangers, vous ignorez les chemins de ces mers, je suis prêt à vous les enseigner. »
Platon, Gorgias, (208a-211a)
« SOCRATE : Lorsqu’une ville s’assemble pour faire choix de médecins, de constructeurs de vaisseaux, ou de toute autre espèce d’ouvriers, n’est-il pas vrai que l’orateur n’aura point alors de conseil à donner, puisqu’il est évident que, dans chacun de ces cas, il faut choisir le plus instruit ? Ni lorsqu’il s’agira de la construction des murs, des ports, ou des arsenaux ; mais que l’on consultera là-dessus les architectes : ni lorsqu’on délibérera sur le choix d’un général, sur l’ordre dans lequel on marchera à l’ennemi, sur les postes dont on doit s’emparer ; mais qu’en ces circonstances les gens de guerre diront leur avis, et les orateurs ne seront pas consultés. Qu’en penses-tu, Gorgias ? Puisque tu te dis orateur, et capable de former d’autres orateurs, on ne peut mieux s’adresser qu’à toi pour connaître à fond ton art. Figure-toi d’ailleurs que je travaille ici dans tes intérêts. Peut-être parmi ceux qui sont ici[10] y en a-t-il qui désirent d’être de tes disciples, comme j’en sais quelques-uns et même beaucoup, qui ont cette envie, et qui n’osent pas t’interroger. Persuade-toi donc que, quand je t’interroge, c’est comme s’ils te demandaient eux-mêmes : Gorgias, que nous en reviendra-t-il, si nous prenons tes leçons ? sur quoi serons-nous en état de conseiller nos concitoyens ? Sera-ce seulement sur le juste et l’injuste, ou, en outre, sur les objets dont Socrate vient de parler ? Essaie de leur répondre.
GORGIAS. : Je vais, Socrate, essayer de te développer en son entier toute la vertu de la rhétorique ; car tu m’as mis parfaitement sur la voie. Tu sais sans doute que les arsenaux des Athéniens, leurs murailles, leurs ports, ont été construits, en partie sur les conseils de Thémistocle, en partie sur ceux de Périclès, et non sur ceux des ouvriers.
SOCRATE. : Je sais, Gorgias, qu’on le dit de Thémistocle. À l’égard de Périclès, je l’ai entendu moi-même, lorsqu’il conseilla aux Athéniens d’élever la muraille qui sépare Athènes du Pirée.
GORGIAS. : Ainsi tu vois, Socrate, que quand il s’agit de prendre un parti sur les objets dont tu parlais, les orateurs sont ceux qui conseillent, et dont l’avis l’emporte.
SOCRATE. : C’est aussi ce qui m’étonne, Gorgias, et ce qui est cause que je t’interroge depuis si longtemps sur la vertu de la rhétorique. À le prendre ainsi, elle me paraît merveilleusement grande.
GORGIAS. : Et si tu savais tout, Socrate, si tu savais que la rhétorique embrasse, pour ainsi dire, la vertu de tous les autres arts ! Je vais t’en donner une preuve bien frappante. Je suis souvent entré, avec mon frère et d’autres médecins, chez certains malades qui ne voulaient point ou prendre une potion, ou souffrir qu’on leur appliquât le fer ou le feu. Le médecin ne pouvant rien gagner sur leur esprit, j’en suis venu à bout, moi, sans le secours d’aucun autre art que de la rhétorique. J’ajoute que, si un orateur et un médecin se présentent dans une ville, et qu’il soit question de disputer de vive voix devant le peuple, ou devant quelque autre assemblée, sur la préférence entre l’orateur et le médecin, on ne fera nulle attention à celui-ci, et l’homme qui a le talent de la parole sera choisi, s’il entreprend de l’être. Pareillement, dans la concurrence avec un homme de toute autre profession, l’orateur se fera choisir préférablement à qui que ce soit, parce qu’il n’est aucune matière sur laquelle il ne parle en présence de la multitude d’une manière plus persuasive que tout autre artisan, quel qu’il soit. Telle est l’étendue et la puissance de la rhétorique. »
M. Heidegger, Acheminement vers la parole, p. 13
« L'être humain parle. Nous parlons éveillés ; nous parlons en rêve. Nous parlons sans cesse, même quand nous ne proférons aucune parole, et que nous ne faisons qu'écouter ou lire ; nous parlons même si, n'écoutant plus vraiment, ni ne lisant, nous nous adonnons à un travail, ou bien nous abandonnons à ne rien faire. Constamment nous parlons, d'une manière ou d'une autre. Nous parlons parce que parler nous est naturel. Cela ne provient pas d'une volonté de parler qui serait antérieure à la parole. On dit que l'homme possède la parole par nature. L'enseignement traditionnel veut que l'homme soit, à la différence de la plante et de la bête, le vivant capable de parole. Cette affirmation ne signifie pas seulement qu'à côté d'autres facultés, l'homme possède aussi celle de parler. Elle veut dire que c'est bien la parole qui rend l'homme capable d'être le vivant qu'il est en tant qu'homme. L'homme est homme en tant qu'il est celui qui parle. »
Platon, Phèdre 259e-261c
« SOCRATE.
N'est-il pas nécessaire, pour qu'un discours soit parfait, que l'orateur connaisse la vérité des choses dont il doit discourir ?
PHÈDRE.
J'ai entendu dire à ce sujet, mon cher Socrate qu'il n'était pas nécessaire, pour être orateur, de connaître ce qui est véritablement juste, mais ce qui le paraît à la multitude chargée de prononcer, ni ce qui est vraiment bon et beau, mais ce qui paraît tel : car la persuasion naît plutôt de cette apparence que de la vérité.
SOCRATE.
Non, il ne faut pas rejeter, mon cher Phèdre, les paroles des hommes habiles; il faut examiner ce qu'elles signifient, et ce que tu viens de dire mérite d'être approfondi.
PHÈDRE.
Tu as raison.
SOCRATE.
Prenons-nous-y de cette manière.
PHÈDRE.
Voyons.
SOCRATE.
Si je te conseillais d'acheter un cheval pour t'en servir dans les combats, et que ni l'un ni l'autre nous n'eussions jamais vu de cheval, mais que j'eusse seulement appris que Phèdre appelle cheval celui de tous les animaux domestiques qui a les plus longues oreilles...
PHÈDRE.
Tu veux rire, Socrate.
SOCRATE.
Un moment. La chose serait bien plus risible si, voulant te persuader sérieusement, je composais un discours où je fisse l'éloge de l'âne, en lui donnant le nom de cheval; si je disais que c'est un animal très utile à la maison et à l'année, qu'on peut se défendre assis sur son dos, et qu'il est fort commode pour porter les bagages, et pour mille autres choses semblables.
PHÈDRE.
Oui, cela serait le comble du ridicule.
SOCRATE.
Mais enfin ne vaut-il pas mieux encore être ridicule dans sa bienveillance que dangereux et nuisible?
PHÈDRE.
Sans doute.
SOCRATE.
Or, lorsqu'un orateur, ignorant la nature du bien et du mal, trouvera ses concitoyens dans une égale ignorance, et leur conseillera, non plus de prendre un âne pour un cheval, mais le mal pour le bien, et qu'en étudiant les penchants de la multitude, il réussira à faire prévaloir l'un sur l'autre, quels fruits crois-tu que la rhétorique puisse recueillir d'une telle semence ?
PHÈDRE.
D'assez mauvais. »
Quintilien, Institution oratoire, Livre I Ch 1
Quintilien (auteur romain du Ier siècle) indique dans ce texte des conseils à suivre pour former un orateur.
« Vous est-il né un fils, concevez d'abord de lui les plus hautes espérances : cela vous rendra plus soigneux dès le commencement. On dit tous les jours qu'il n'est donné qu'à un très petit nombre d'hommes de comprendre ce qu'on leur enseigne, et que la plupart, faute d'intelligence, perdent leur peine et leur temps. Cette plainte n'est pas fondée : il s'en rencontre beaucoup, au contraire, qui ont autant de facilité à concevoir que d'aptitude à apprendre. C'est que cela est dans la nature de l'homme ; et de même que l'oiseau est né pour voler, le cheval pour courir, la bête féroce pour nuire ; de même l'homme est né pour penser, et exercer cette intelligence active et subtile qui a fait attribuer à l'âme une origine céleste. Les esprits stupides et rebelles à toute instruction sont dans l'ordre intellectuel ce que les monstres sont dans l'ordre physique : le nombre en est infiniment petit. Ce qui le prouve, c'est qu'on voit briller dans les enfants des lueurs très vives d'espérance, qui s'évanouissent avec l'âge ; d'où il faut conclure que ce n'est pas la nature qui leur a manqué, mais les soins. Il y en a pourtant qui ont plus d'esprit que d'autres : d'accord ; mais de ce qu'on montre plus ou moins de capacité, il ne s'ensuit pas que personne n'ait jamais rien gagné à l'étude. Quiconque est pénétré de cette vérité, dès qu'il sera devenu père ne saurait cultiver avec trop de soin l'espérance de former un orateur.
Avant tout, choisissez des nourrices qui n'aient point un langage vicieux. Chrysippe les souhaitait savantes, si cela se pouvait, ou du moins aussi vertueuses que possible ; et sans doute c'est à leurs mœurs qu'il faut principalement regarder. Il faut tenir aussi pourtant à ce qu'elles parlent correctement. Ce sont elles que l'enfant entendra d'abord, ce sont elles dont il essayera d'imiter et de reproduire les paroles ; et naturellement les impressions que nous recevons dans le premier âge sont les plus profondes. Ainsi un vase conserve toujours l'odeur dont il a été imbu étant neuf, et la laine, une fois teinte, ne recouvre jamais sa blancheur primitive. Mais ce sont surtout les mauvaises impressions qui laissent les traces les plus durables. Le bien se change aisément en mal : mais quand vient-on à bout de changer le mal en bien ? Que l'enfant ne s'accoutume donc pas, si jeune qu'il soit, à un langage qu'il lui faudra désapprendre. »
Rousseau, Essai sur l’origine des langues (1781)
« La parole distingue l'homme entre les animaux : le langage distingue les nations entre elles ; on ne connaît d'où est un homme qu'après qu'il a parlé. L'usage et le besoin font apprendre à chacun la langue de son pays ; mais qu'est-ce qui fait que cette langue est celle de son pays et non pas d'un autre ? Il faut bien remonter, pour le dire, à quelque raison qui tienne au local, et qui soit antérieure aux mœurs mêmes : la parole, étant la première institution sociale, ne doit sa forme qu'à des causes naturelles.
Sitôt qu'un homme fut reconnu par un autre pour un être sentant, pensant et semblable à lui, le désir ou le besoin de lui communiquer ses sentiments et ses pensées lui en fit chercher les moyens. Ces moyens ne peuvent se tirer que des sens, les seuls instruments par lesquels un homme puisse agir sur un autre. Voilà donc l'institution des signes sensibles pour exprimer la pensée. Les inventeurs du langage ne firent pas ce raisonnement, mais l'instinct leur en suggéra la conséquence.
Les moyens généraux par lesquels nous pouvons agir sur les sens d'autrui se bornent à deux, savoir, le mouvement et la voix. L'action du mouvement est immédiate par le toucher ou médiate par le geste : la première, ayant pour terme la longueur du bras, ne peut se transmettre à distance : mais l'autre atteint aussi loin que le rayon visuel. Ainsi restent seulement la vue et l'ouïe pour organes passifs du langage entre des hommes dispersés. Quoique la langue du geste et celle de la voix soient également naturelles, toutefois la première est plus facile et dépend moins des conventions : car plus d'objets frappent nos yeux que nos oreilles, et les figures ont plus de variété que les sons ; elles sont aussi plus expressives et disent plus en moins de temps. L'amour, dit-on, fut l'inventeur du dessin ; il put inventer aussi la parole, mais moins heureusement. Peu content d'elle, il la dédaigne : il a des manières plus vives de s'exprimer. Que celle qui traçait avec tant de plaisir l'ombre de son amant lui disait de choses ! Quels sons eût-elle employés pour rendre ce mouvement de baguette ?
[…]
L'on parle aux yeux bien mieux qu'aux oreilles. Il n'y a personne qui ne sente la vérité du jugement d'Horace à cet égard. On voit même que les discours les plus éloquents sont ceux où l'on enchâsse le plus d'images ; et les sons n'ont jamais plus d'énergie que quand ils font l'effet des couleurs. Mais lorsqu'il est question d'émouvoir le cœur et d'enflammer les passions, c'est toute autre chose. L'impression successive du discours, qui frappe à coups redoublés, vous donne bien une autre émotion que la présence de l'objet même, où d'un coup d'œil vous avez tout vu. Supposez une situation de douleur parfaitement connue, en voyant la personne affligée vous serez difficilement ému jusqu'à pleurer ; mais laissez-lui le temps de vous dire tout ce qu'elle sent, et bientôt vous allez fondre en larmes. Ce n'est qu'ainsi que les scènes de tragédie font leur effet
[...]
Ceci me fait penser que si nous n'avions jamais eu que des besoins physiques, nous aurions fort bien pu ne parler jamais, et nous entendre parfaitement par la seule langue du geste. Nous aurions pu établir des sociétés peu différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui, ou qui même auraient marché mieux à leur but. Nous aurions pu instituer des lois, choisir des chefs, inventer des arts, établir le commerce, et faire, en un mot, presque autant de choses que nous en faisons par le secours de la parole. [...] Il paraît encore par les mêmes observations que l'invention de l'art de communiquer nos idées dépend moins des organes qui nous servent à cette communication, que d'une faculté propre à l'homme, qui lui fait employer ses organes à cet usage, et qui, si ceux-là lui manquaient, lui en ferait employer d'autres à la même fin. Donnez à l'homme une organisation tout aussi grossière qu'il vous plaira : sans doute il acquerra moins d'idées ; mais pourvu seulement qu'il y ait entre lui et ses semblables quelque moyen de communication par lequel l'un puisse agir et l'autre sentir, ils parviendront à se communiquer enfin tout autant d'idées qu'ils en auront. Les animaux ont pour cette communication une organisation plus que suffisante, et jamais aucun d'eux n'en a fait cet usage. Voilà, ce me semble, une différence bien caractéristique. Ceux d'entre eux qui travaillent et vivent en commun, les castors, les fourmis, les abeilles, ont quelque langue naturelle pour s'entre-communiquer, je n'en fais aucun doute. Il y a même lieu de croire que la langue des castors et celle des fourmis sont dans le geste et parlent seulement aux yeux. Quoiqu'il en soit, par cela même que les unes et les autres de ces langues sont naturelles, elles ne sont pas acquises ; les animaux qui les parlent les ont en naissant, ils les ont tous, et partout la même ; ils n'en changent point, ils n'y font pas le moindre progrès. La langue de convention n'appartient qu'à l'homme. Voilà pourquoi l'homme fait des progrès soit en bien soit en mal, et pourquoi les animaux n'en font point. Cette seule distinction paraît mener loin : on l'explique, dit-on, par la différence des organes. Je serais curieux de voir cette explication. […]
Il est donc à croire que les besoins dictèrent les premiers gestes, et que les passions arrachèrent les premières voix. En suivant avec ces distinctions la trace des faits, peut-être faudrait-il raisonner sur l'origine des langues tout autrement qu'on n'a fait jusqu'ici. Le génie des langues orientales, les plus anciennes qui nous soient connues, dément absolument la marche didactique qu'on imagine dans leur composition. Ces langues n'ont rien de méthodique et de raisonné ; elles sont vives et figurées. On nous fait du langage des premiers hommes des langues de géomètres, et nous voyons que ce furent des langues de poètes.
Cela dut être. On ne commença pas par raisonner, mais par sentir. On prétend que les hommes inventèrent la parole pour exprimer leurs besoins ; cette opinion me paraît insoutenable. L'effet naturel des premiers besoins fut d'écarter les hommes et non de les rapprocher. Il le fallait ainsi pour que l'espèce vînt à s'étendre, et que la terre se peuplât promptement ; sans quoi le genre humain se fût entassé dans un coin du monde, et tout le reste fût demeuré désert.
De cela seul il suit avec évidence que l'origine des langues n'est point due aux premiers besoins des hommes ; il serait absurde que de la cause qui les écarte vînt le moyen qui les unit. D'où peut donc venir cette origine ? Des besoins moraux, des passions. Toutes les passions rapprochent les hommes que la nécessité de chercher à vivre force à se fuir. Ce n'est ni la faim, ni la soif, mais l'amour, la haine, la pitié, la colère, qui leur ont arraché les premières voix. Les fruits ne se dérobent point à nos mains, on peut s'en nourrir sans parler ; on poursuit en silence la proie dont on veut se repaître : mais pour émouvoir un jeune cœur, pour repousser un agresseur injuste, la nature dicte des accents, des cris, des plaintes. Voilà les plus anciens mots inventés, et voilà pourquoi les premières langues furent chantantes et passionnées avant d'être simples et méthodiques. »
4) Nouvel exemple de textes
Formation HLP – Première
Recueil de textes -philosophie
Semestre 1 : Les pouvoirs de la parole
Homère, l’Odyssée, chant I
Rappel du contexte : Télémaque vient d’avoir une longue conversation avec Athéna, déguisée sous la forme d’un voyageur modeste. A la fin de l’échange, Athéna redonne du courage à Télémaque qui reconnait la déesse en elle. C’est donc le cœur à nouveau vaillant qu’il rejoint l’endroit où la troupe des prétendants boit en écoutant Phémios l’Aède.
« Puis, le divin jeune homme s’approcha des Prétendants.
Et l’Aède très-illustre chantait, et ils étaient assis, l’écoutant en silence. Et il chantait le retour fatal des Acchéens, que Pallas Athèna leur avait infligé au sortir de Troie. Et, de la haute chambre, la fille d’Ikarios, la sage Pènélope, entendit ce chant divin, et elle descendit l’escalier élevé, non pas seule, mais suivie de deux servantes. Et quand la divine femme fut auprès des Prétendants, elle resta debout contre la porte, sur le seuil de la salle solidement construite, avec un beau voile sur les joues, et les honnêtes servantes se tenaient à ses côtés. Et elle pleura et dit à l’Aède divin :
— Phèmios, tu sais d’autres chants par lesquels les Aèdes célèbrent les actions des hommes et des Dieux. Assis au milieu de ceux-ci, chante-leur une de ces choses, tandis qu’ils boivent du vin en silence ; mais cesse ce triste chant qui déchire mon cœur dans ma poitrine, puisque je suis la proie d’un deuil que je ne puis oublier. Car je pleure une tête bien aimée, et je garde le souvenir éternel de l’homme dont la gloire emplit la Grèce et Argos.
Et le sage Tèlémaque lui répondit :
— Ma mère, pourquoi défends-tu que ce doux Aède nous réjouisse, comme son esprit le lui inspire ? Les Aèdes ne sont responsables de rien, et Zeus dispense ses dons aux poètes comme il lui plaît. Il ne faut point t’indigner contre celui-ci parce qu’il chante la sombre destinée des Danaens, car les hommes chantent toujours les choses les plus récentes. Aie donc la force d’âme d’écouter. Ulysse n’a point perdu seul, à Troie, le jour du retour, et beaucoup d’autres y sont morts aussi. Rentre dans ta demeure ; continue tes travaux à l’aide de la toile et du fuseau, et remets tes servantes à leur tâche. La parole appartient aux hommes, et surtout à moi qui commande ici.
Étonnée, Pènélope s’en retourna chez elle, emportant dans son cœur les sages paroles de son fils »
Aristote, Les politiques, I, 2
« Seul parmi les animaux l’homme possède la parole (logos). Certes la voix (phonè) est le signe du douloureux et de l’agréable, aussi la rencontre-t-on chez les animaux ; leur nature, en effet, est parvenue jusqu’au point d’éprouver la sensation du douloureux et de l’agréable, et de se les signifier mutuellement. Mais le logos existe en vue de manifester l’avantageux et le nuisible, et par suite aussi le juste et l’injuste. Il n’y a en effet qu’une chose qui soit propre aux hommes par rapport aux animaux : le fait que seuls ils aient la perception du bien, du mal, du juste, de l’injuste et autres perceptions de ce genre. Or, mettre cela en commun c’est ce qui fait une famille et une cité. »
Platon, Gorgias, (208a-211a)
« SOCRATE : Lorsqu’une ville s’assemble pour faire choix de médecins, de constructeurs de vaisseaux, ou de toute autre espèce d’ouvriers, n’est-il pas vrai que l’orateur n’aura point alors de conseil à donner, puisqu’il est évident que, dans chacun de ces cas, il faut choisir le plus instruit ? Ni lorsqu’il s’agira de la construction des murs, des ports, ou des arsenaux ; mais que l’on consultera là-dessus les architectes : ni lorsqu’on délibérera sur le choix d’un général, sur l’ordre dans lequel on marchera à l’ennemi, sur les postes dont on doit s’emparer ; mais qu’en ces circonstances les gens de guerre diront leur avis, et les orateurs ne seront pas consultés. Qu’en penses-tu, Gorgias ? Puisque tu te dis orateur, et capable de former d’autres orateurs, on ne peut mieux s’adresser qu’à toi pour connaître à fond ton art. Figure-toi d’ailleurs que je travaille ici dans tes intérêts. Peut-être parmi ceux qui sont ici[10] y en a-t-il qui désirent d’être de tes disciples, comme j’en sais quelques-uns et même beaucoup, qui ont cette envie, et qui n’osent pas t’interroger. Persuade-toi donc que, quand je t’interroge, c’est comme s’ils te demandaient eux-mêmes : Gorgias, que nous en reviendra-t-il, si nous prenons tes leçons ? sur quoi serons-nous en état de conseiller nos concitoyens ? Sera-ce seulement sur le juste et l’injuste, ou, en outre, sur les objets dont Socrate vient de parler ? Essaie de leur répondre.
GORGIAS. : Je vais, Socrate, essayer de te développer en son entier toute la vertu de la rhétorique ; car tu m’as mis parfaitement sur la voie. Tu sais sans doute que les arsenaux des Athéniens, leurs murailles, leurs ports, ont été construits, en partie sur les conseils de Thémistocle, en partie sur ceux de Périclès, et non sur ceux des ouvriers.
SOCRATE. : Je sais, Gorgias, qu’on le dit de Thémistocle. À l’égard de Périclès, je l’ai entendu moi-même, lorsqu’il conseilla aux Athéniens d’élever la muraille qui sépare Athènes du Pirée.
GORGIAS. : Ainsi tu vois, Socrate, que quand il s’agit de prendre un parti sur les objets dont tu parlais, les orateurs sont ceux qui conseillent, et dont l’avis l’emporte.
SOCRATE. : C’est aussi ce qui m’étonne, Gorgias, et ce qui est cause que je t’interroge depuis si longtemps sur la vertu de la rhétorique. À le prendre ainsi, elle me paraît merveilleusement grande.
GORGIAS. : Et si tu savais tout, Socrate, si tu savais que la rhétorique embrasse, pour ainsi dire, la vertu de tous les autres arts ! Je vais t’en donner une preuve bien frappante. Je suis souvent entré, avec mon frère et d’autres médecins, chez certains malades qui ne voulaient point ou prendre une potion, ou souffrir qu’on leur appliquât le fer ou le feu. Le médecin ne pouvant rien gagner sur leur esprit, j’en suis venu à bout, moi, sans le secours d’aucun autre art que de la rhétorique. J’ajoute que, si un orateur et un médecin se présentent dans une ville, et qu’il soit question de disputer de vive voix devant le peuple, ou devant quelque autre assemblée, sur la préférence entre l’orateur et le médecin, on ne fera nulle attention à celui-ci, et l’homme qui a le talent de la parole sera choisi, s’il entreprend de l’être. Pareillement, dans la concurrence avec un homme de toute autre profession, l’orateur se fera choisir préférablement à qui que ce soit, parce qu’il n’est aucune matière sur laquelle il ne parle en présence de la multitude d’une manière plus persuasive que tout autre artisan, quel qu’il soit. Telle est l’étendue et la puissance de la rhétorique. »
M. Heidegger, Acheminement vers la parole, p. 13
« L'être humain parle. Nous parlons éveillés ; nous parlons en rêve. Nous parlons sans cesse, même quand nous ne proférons aucune parole, et que nous ne faisons qu'écouter ou lire ; nous parlons même si, n'écoutant plus vraiment, ni ne lisant, nous nous adonnons à un travail, ou bien nous abandonnons à ne rien faire. Constamment nous parlons, d'une manière ou d'une autre. Nous parlons parce que parler nous est naturel. Cela ne provient pas d'une volonté de parler qui serait antérieure à la parole. On dit que l'homme possède la parole par nature. L'enseignement traditionnel veut que l'homme soit, à la différence de la plante et de la bête, le vivant capable de parole. Cette affirmation ne signifie pas seulement qu'à côté d'autres facultés, l'homme possède aussi celle de parler. Elle veut dire que c'est bien la parole qui rend l'homme capable d'être le vivant qu'il est en tant qu'homme. L'homme est homme en tant qu'il est celui qui parle. »
Philippe BRETON, Éloge de la parole (2003)
« D'un côté, on peut constater que la parole humaine n'a probablement jamais connu autant de possibilités de déploiement qu'aujourd'hui. Où qu'on se tourne dans les sociétés modernes, on trouve, souvent comme signe de progrès, des techniques de communication ou encore des institutions qui sont directement une concrétisation ou une facilitation de la parole. La parole aujourd'hui est un fait social majeur. C'est par elle que nous agissons, que nous prenons des décisions, que nous négocions, que nous tentons de faire reculer la violence, que nous organisons et transformons le monde qui nous entoure.
Pourtant, d'un autre côté, en même temps que ce déplacement du statut de la parole, qui lui confère une position toujours plus centrale, chacun sent bien que ce déploiement est souvent au mieux retenu, au pire dévoyé. Nous sommes là au cœur de l'injonction contradictoire : parlez, mais taisez-vous ! Il s'agit d'un véritable paradoxe, car à la fois la parole est libre, encouragée, elle est un des principaux opérateurs du changement social, et à la fois elle est difficile à prendre ou encore réduite à un discours sans effet, quand elle n'est pas travestissement de la pure violence. De plus, cette importance, cette centralité de la parole n'est qu'en partie visible à nos yeux. La parole moderne n'est qu'en partie consciente d'elle-même, elle n'est même parfois que l'ombre de son idéal.
Une vision optimiste des choses permettra de dire que ce qui compte le plus aujourd'hui est la place prise par la parole qui fait de nos sociétés de véritables sociétés de parole. Le symbole le plus fort de cet aspect des choses sera par exemple la « liberté d'expression » qui connaît un déploiement sans égal dans l'histoire. On insistera également sur les immenses possibilités offertes par les techniques modernes de communication, dont Internet n'est qu'une avant-garde. Ou encore sur le fait que nous vivons en démocratie, ou, pour être plus précis, dans des sociétés « en voie de démocratisation », c'est-à-dire un régime où la parole tend de plus en plus à être au centre des processus sociaux de décision et d'action.
Une vision pessimiste de la même réalité soulignera les immenses inégalités d'accès à la parole et le fait qu'elle est souvent manipulée par les puissants. La parole, pour reprendre l'expression de Jacques Ellul, est trop souvent une « parole humiliée ». Dans cette optique, on insistera sur le fait que les nombreuses techniques de communication déployées aujourd'hui ne correspondent pas forcément à un accroissement de la qualité des paroles qu'elles servent à transmettre, ou même que, à être tant délayée, la parole s'y affadit considérablement.
Il faut donc tenter une approche la plus objective possible de ce phénomène. La question n'est pas l'optimisme ou le pessimisme, mais bien une juste évaluation de la place prise par la parole dans les sociétés modernes. [...] Toute évaluation, dans le domaine social, est souvent une question d'échelle. Le point de vue optimiste se révèle pertinent si l'on place l'observation sur une échelle temporelle large : on a assisté à un déplacement du statut de la parole (par exemple, en France, de la fin du Moyen Âge à l'époque contemporaine) qui lui confère une position de plus en plus centrale et qui contribue largement, entre autres, au progrès des mœurs et de la civilité.
Le point de vue pessimiste est imbattable pour décrire les très nombreuses situations, au présent, qui témoignent de notre frustration devant les dévoiements de ce qui apparaît le plus souvent comme une potentialité en lieu et place d'une réalité. En somme, la direction est bonne mais on risque à chaque moment de verser dans le fossé.
L'optimiste a une vision globale, mais celle-ci ne le protège pas contre les accidents, y compris ceux qui risquent d'arrêter la course. Le pessimiste a un point de vue précieux puisqu'il pointe du doigt, avec rigueur, tout écart du chemin, ou toute retenue dans l'élan, mais il risque de décourager la poursuite de la course en répétant inlassablement que l'on se trompe de direction, alors que l'on va peut-être, globalement, dans le bon sens.
Il est tentant malgré tout de prendre de la hauteur par rapport à ce balancement entre optimisme et pessimisme pour voir que sur la longue durée, celle des civilisations, partout où il y a de la parole, il y a du progrès. Thèse renversable, tant les deux termes sont identifiés l'un à l'autre : partout où il y a du progrès, il y a de la parole. Que ce progrès soit aujourd'hui en partie retenu ne change rien à sa direction.
Nous l'avons vu, ces progrès sont de deux ordres : d'abord, une capacité toujours accrue pour l'homme de prendre en main son destin (c'est-à-dire de ne plus être subordonné au fatalisme), en inventant des représentations (par exemple celle de l'homme comme individu), des pratiques sociales (comme la « civilité,) et des institutions (notamment démocratiques) qui permettent à la parole de se déployer; ensuite, à un autre niveau, celui des moyens, un affinement de la parole ellemême dans sa capacité à changer le monde. Ce progrès peut connaître des revers, mais, dans un certain sens, la direction d'ensemble est la bonne et c'est, au bout du compte, toujours, la société des hommes qui s'en porte mieux. C'est dans ce sens que la parole, comme fondement d'un humanisme renouvelé, mérite, pour le moins, un éloge. »
5) Exemple de parcours possible
Proposition de séquence HLP 1ère : Autorité et séductions de la parole
Etape 1 a : Réflexion collective dirigée autour de l’autorité du livre / du Livre, à partir de la citation tirée du premier extrait du Roman de Renart (sans nécessairement leur donner la référence)
« J'ai découvert un jour, enfermé dans un étui, un livre qui avait pour nom Aucupre. (…) Je découvris là, tracée en grands caractères vermillon, mainte histoire extraordinaire. Si je n'en avais trouvé le récit dans ce livre, j'aurais jugé ivre quiconque aurait raconté semblable aventure, mais on doit croire ce qui est écrit. C'est à bon droit que meurt dans l'opprobre celui qui n'a pas le respect des livres et qui ne leur accorde pas de crédit. »
Questionnement (en vrac) : tous les livres ? quels livres ? en vertu de quoi ? dans quelle mesure, quelles limites ? dans quels domaines ? comment se pose, se transmet cette autorité ? Quel est le rôle du contexte, de la culture ? quelles formes prend la soumission à cette autorité ? quels problèmes cela pose-t-il ?
Compétences visées : aptitude à entrer dans un questionnement, à formuler des hypothèses, à les analyser, à mobiliser sa culture, à synthétiser les éléments de réponse.
Echange oral + rédaction éventuelle d’une brève synthèse
Etape 1 b : distribution de deux textes : l’extrait de la Genèse et la Création de Renart :
« Messieurs, vous avez entendu bien des contes, de la bouche de plus d’un conteur : comment Pâris enleva Hélène, les souffrances et la peine qui furent les siennes, l’histoire de Tristan selon La Chèvre, qui traite son sujet de manière très élégante, des fables et des chansons de geste ; plus d'un autre raconte également dans notre pays des romans de Lui et de sa geste. Mais jamais vous n'avez entendu traiter de la guerre, qui fut terrible, entre Renart et Isengrin ; elle fut très longue et acharnée. Ces deux seigneurs, voici la pure vérité, ne se portèrent jamais la moindre affection. Il y eut entre eux deux maintes querelles et maintes batailles, voilà la vérité vraie. Je vais maintenant vous raconter l'histoire de leur conflit et de leur brouille. Vous allez maintenant entendre, depuis le tout début de l'histoire, pour quelle raison et à la suite de quelle triste affaire la discorde apparut entre eux deux. Écoutez donc, et que cette histoire vous soit plaisante. Je vous raconterai, pour le plaisir de conter, ainsi que je l'ai trouvé dans mes lectures, dans quelles circonstances Renart et Isengrin apparurent, et qui ils furent. J'ai découvert un jour, enfermé dans un étui, un livre qui avait pour nom Aucupre. Je trouvai là de nombreux récits, à propos de Renart et d'autres matières dont il est bien légitime d'avoir la hardiesse de parler. Je découvris là, tracée en grands caractères vermillon, mainte histoire extraordinaire. Si je n'en avais trouvé le récit dans ce livre, j'aurais jugé ivre quiconque aurait raconté semblable aventure, mais on doit croire ce qui est écrit. C'est à bon droit que meurt dans l'opprobre celui qui n'a pas le respect des livres et qui ne leur accorde pas de crédit. Aucupre raconte dans cet ouvrage - béni soit de Dieu celui qui lui a inspiré cette initiative ! - comment Dieu chassa du paradis Adam et Eve parce qu'ils avaient outrepassé ses ordres. Il les prit cependant en pitié, leur fît don d'une verge et leur en montra l'usage : lorsqu'ils auraient besoin de quoi que ce soit, ils frapperaient la mer de cette verge. Adam prit la verge à la main, et en frappa la mer sous les yeux d'Eve. Aussitôt qu'il eut frappé la mer, une brebis jaillit des flots. Adam dit alors : « Madame, prenez cette brebis, et ayez soin d'elle : elle nous donnera suffisamment de lait et de fromage pour que nous ayons de quoi manger avec notre pain. » Eve pensait en elle-même que si elle pouvait obtenir une autre brebis, plus belle serait la compagnie. Elle s'empare aussitôt de la verge, et en frappe un grand coup sur la mer : un loup surgit, s'empare de la brebis. À grands bonds, le loup s'enfuit vivement vers le bois. Quand Eve se rend compte qu'elle a perdu sa brebis si personne ne lui vient en aide, elle se met à gémir et à crier de toute sa voix : « Ha ! ha ! » Adam reprend en main la verge et, de colère, frappe la mer : un chien en bondit avec impétuosité, et voyant le loup, il s'élance au secours de la brebis. Il la dispute au loup ; bien à contrecœur, le loup abandonne la brebis sur place ; mais s'il pouvait la tenir dans quelque bois ou en plaine, il agirait bien demain de la même façon. Parce que le loup avait manqué son coup, il s'enfuit dans le bois tout honteux. Adam avait désormais son chien et sa bête, et il en fît de grandes démonstrations de joie. Selon ce qu'affirme le livre, ces deux animaux ne peuvent pas vivre ni subsister très longtemps loin de la compagnie des hommes. À quelque bête que vous puissiez penser, il n'en est aucune qui ne puisse mieux se passer de cette fréquentation. Chaque fois qu'Adam frappa la mer, et qu'il en sortit une bête, Adam et Eve gardaient cette bête auprès d'eux, quelle qu'elle fût, et ils l'apprivoisaient. Mais celles qu'Eve fit apparaître, ils ne purent jamais les retenir : aussitôt qu'elles sortaient de la mer, elles allaient rejoindre le loup dans le bois : les bêtes d'Eve devenaient sauvages, et celles d'Adam domestiques. Entre autres sortit de la mer le goupil, qui devint sauvage. Le poil roux comme Renart, il avait très belle allure et était un vrai pillard ; grâce à son intelligence, il trompait toutes les bêtes qu'il trouvait. Ce goupil est à nos yeux le symbole de Renart, lui qui fut un maître accompli : tous ceux qui sont versés dans la ruse et les artifices sont désormais appelés Renart, à cause de Renart et du goupil. L'un et l'autre étaient très savants dans leur art. Si Renart sait couvrir de honte les hommes, et si le goupil de son côté trompe les bêtes, c'est qu'ils appartenaient bien à la même race, suivant les mêmes mœurs et partageant les mêmes sentiments. «
Document 1 : Le roman de Renart , La création de Renart
- ANONYME, Le Roman de Renart, « La création de Renart ». Texte revu, présenté et traduit par Gabriel Bianciotto ; Le Livre de Poche n° 4568, Lettres gothiques, 2005. p 93-99.
Document 2 :
Livre de la Genèse, 3
01 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait faits. Il dit à la femme : « Alors, Dieu vous a vraiment dit : “Vous ne mangerez d’aucun arbre du jardin” ? »
02 La femme répondit au serpent : « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin.
03 Mais, pour le fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : “Vous n’en mangerez pas, vous n’y toucherez pas, sinon vous mourrez.” »
04 Le serpent dit à la femme : « Pas du tout ! Vous ne mourrez pas !
05 Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. »
06 La femme s’aperçut que le fruit de l’arbre devait être savoureux, qu’il était agréable à regarder et qu’il était désirable, cet arbre, puisqu’il donnait l’intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea.
07 Alors leurs yeux à tous deux s’ouvrirent et ils se rendirent compte qu’ils étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier, et ils s’en firent des pagnes.
08 Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L’homme et sa femme allèrent se cacher aux regards du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin.
09 Le Seigneur Dieu appela l’homme et lui dit : « Où es-tu donc ? »
10 Il répondit : « J’ai entendu ta voix dans le jardin, j’ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. »
11 Le Seigneur reprit : « Qui donc t’a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l’arbre dont je t’avais interdit de manger ? »
12 L’homme répondit : « La femme que tu m’as donnée, c’est elle qui m’a donné du fruit de l’arbre, et j’en ai mangé. »
13 Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu’as-tu fait là ? » La femme répondit : « Le serpent m’a trompée, et j’ai mangé. »
Réflexion sur la différence de statut entre ces deux livres. Mise en contexte.
Se profile l’idée que Renart pourrait être assimilé au Serpent.
Etape 2 : analyse rhétorique de la stratégie de séduction vicieuse du serpent qui détourne et déforme la parole divine pour tenter l’homme et la femme et créer la division. Je cite Y. Martin : « La séduction est là, dans une parole qui provoque l’attirance (se ducere), l’attrait en cela même qu’elle ne donne pas réellement à connaître, mais simplement à imaginer confusément. »
Compétence enseignée et développée : l’analyse rhétorique d’un dialogue (visée du propos, implicite, mauvaise foi, équivoques, etc...). Travail de commentaire. Peut être initié par le professeur puis conduit par les élèves seuls ou à deux.
Mise en commun. Utiliser ces éclairages pour rédiger les répliques / commentaires que pourrait prononcer un Choeur dans l’idée de mettre en scène le dialogue. (exige tout de même des connaissances en ce qui concerne la tragédie grecque Parodos-Episode-Stasimon-Exodos)
Ouverture vers une activité orale : mise en scène et lecture théâtralisée du dialogue avec les interventions du Chœur qui mettront au jour la perfidie du séducteur et la faiblesse d’Adam et Eve. On évitera toutefois de faire jouer les élèves tout nus…
Un peu de chant grégorien en fond sonore ?
Etape 3 : reprise du premier extrait de Renart + distribution du prologue
Extrait 1 : ANONYME, Le Roman de Renart, « Avertissement du conteur ».
Maintenant, il faut que je vous raconte
une histoire qui vous divertisse,
car, je le sais bien, la vérité
c'est que vous n'avez aucune envie d'entendre un sermon
ou la vie d'un saint martyr ;
ce que vous préférez,
c'est quelque chose de plaisant.
Que chacun donc veille à se taire
car j'ai l'intention de vous raconter une belle histoire,
et j'en connais plus d'une, que Dieu m'assiste !
Avec un peu d'attention,
vous pourriez en tirer une leçon
fort utile.
Certes, on a l'habitude de me prendre pour un fou,
pourtant, j'ai appris à l'école
que la vérité sort de la bouche des fous.
Inutile de s'appesantir sur le prologue.
Donc, sans plus attendre,
Je vais raconter une histoire et un seul bon tour
du maître de l'astuce :
je veux parler de Renart, vous le savez bien
à force de l'avoir entendu dire.
Personne ne peut damer le pion à Renart,
Renart dore la pilule à tout le monde,
Renart enjôle, Renart cajole,
Renart n'est pas un modèle à suivre.
Personne, fût-il son ami,
ne le quitte indemne.
Renart est plein de sagesse et d'habileté,
et aussi de discrétion.
Mais en ce bas monde personne n'est assez sage
pour être à l'abri d'une folie.
Je vais donc vous raconter la fâcheuse mésaventure
qui survint à Renart.
Réflexion collective : on peut revenir sur la visée morale de ces textes, les difficultés interprétatives et les ambiguïtés qu’ils peuvent receler.
Compétence écrite : reprendre la première synthèse rédigée à la fin de l’étape 1 et l’enrichir en intégrant des références aux textes lus et éventuellement à la tragédie grecque (l’Essai)
Evaluation ?
Mais surtout, les élèves seront certainement très sensibles à la misogynie qui semble en émaner et souhaiteront peut-être débattre de la question !
Etape 4 : lecture et étude du texte de Saint-Augustin.
Saint Augustin
La cité de Dieu, livre XIV
L’orgueil, cause du péché
C’est le nom de « superbes » que les Ecritures saintes donnent à ceux qui se complaisent en eux-mêmes. Certes, il est bon d’avoir « le cœur en haut » (1), non pour soi, ce qui est de l’orgueil, mais pour Dieu, ce qui est de l’obéissance qui n’appartient qu’aux humbles. Il est vraiment admirable que l’humilité puisse aboutir au cœur en haut, alors que l’élévation aboutit au cœur en bas ! N’est-il pas contradictoire de constater que l’élévation est en bas, l’humilité en haut ? Mais une pieuse humilité rend l’homme soumis à ce qui lui est supérieur. Or, que peut-il y avoir de supérieur à Dieu ? Et l’humilité exalte celui qu’elle rend soumis à Dieu. Mais l’élévation, qui est de l’ordre du vice, conspue cette soumission et se détache de celui au-dessus duquel il n’existe rien ; aussi sera-t-elle déchue, selon ce qui est écrit : « Tu les as abattus, alors qu’ils s’élevaient » (2). Le psalmiste ne dit pas : « après qu’ils s’étaient élevés », comme s’ils s’étaient d’abord élevés, puis avaient été abattus, mais « alors qu’ils s’élevaient, ils ont été abattus ». Car s’élever, c’est déjà tomber. (…)
Donc, par ce péché manifeste et évident, par lequel il a fait ce que Dieu avait interdit, l’homme n’aurait pas été victime du diable s’il n’avait commencé par se complaire en lui-même. C’est pourquoi il se réjouit de cette parole : « Vous serez comme des dieux » (3). Ce qu’ils auraient pu être davantage en restant attachés par leur obéissance au principe souverain et véritable, au lieu de se faire par orgueil le propre principe de leur existence. Les dieux, en effet, ne sont pas dieux par leur vérité propre, mais par leur participation au dieu de vérité. Celui qui cherche plus d’être en a moins et celui qui cherche à se suffire à lui-même perd l’être qui lui suffit vraiment. C’est pourquoi ce mal de l’homme qui, en se complaisant en lui-même comme s’il était lumière, se détourne de cette lumière qui l’aurait rendu lumière s’il s’y était complu, ce mal, dis-je, a préexisté en lui secrètement avant d’être un mal perpétré ouvertement. Et il est justement écrit : « Avant la ruine, le cœur s’exalte et, avant la gloire, il s’humilie » (…) (4)
C’est pourquoi Dieu a interdit un acte qui, une fois commis, ne pouvait se justifier par aucun prétexte. Et j’ose dire qu’il est utile pour les superbes de tomber dans un péché évident et manifeste par lequel ils se déplaisent, eux qui, en se complaisant en eux-mêmes, étaient déjà tombés. Il fut plus salutaire à Pierre de se déplaire, lorsqu’il pleura, que de se complaire en lui-même en présumant de ses forces. C’est ce que dit le psaume sacré : « Remplis leurs faces d’ignominie et ils chercheront ton nom, Seigneur ! ».
(1) Expression liturgique en vigueur au temps d’Augustin
(2) Psaume 73,18
(3) Genèse 3, 5
(4) Proverbes 16,18
(5) Psaume 83,17
Compétence de commentaire en trois temps : - compréhension du texte et mise au jour du thème, de la thèse, des arguments, du plan. - Puis on se focalise sur le recours aux citations : choix, place, portée. - Enfin on s’interroge sur les qualités littéraires et oratoires de la prose de Saint-augustin.
Exercice du commentaire philosophique et littéraire.
Objectif : faire émerger l’idée de « séduction vertueuse » (je cite encore Yann Martin) respectueuse de la parole divine convoquée à travers les références aux Ecritures. Vertueuse également de par sa portée édifiante : il fustige l’orgueil qui éloigne l’homme de Dieu pour mieux inviter son prochain à tendre vers le rapprochement.
Voilà quelqu’un qui recourt à un discours institué -qui fait autorité-, à des fins nobles et pieuses auxquelles il fait servir ses talents rhétoriques.
Et c’est le retour de Renart
Etape 5 :
ANONYME, Le Roman de Renart, « L'aventure du puits ». Texte établi et traduit par Jean Dufournet et Andrée Méline ; GF-Flammarion, 1985. Tome 1, p 315-331.
Il y avait un puits au milieu de la cour. Le voyant, Renart s'y précipite, tout au désir d'apaiser sa soif ; mais impossible d'arriver jusqu'à l'eau. Le voici donc au puits dont il découvre la largeur et la profondeur. Seigneurs, écoutez bien cette prodigieuse aventure !
Dans ce puits, il y a deux seaux : l'un remonte quand l'autre descend. Et Renart le malfaisant
s'est appuyé sur la margelle, irrité, contrarié, perplexe... Soudain, s'avisant de regarder dans le puits et de contempler son reflet, il croit que c'était Hermeline, son épouse bien-aimée,
qui se trouve logée à l'intérieur. Perplexe et mécontent, il lui demande avec rudesse :
"Dis-moi, que fais-tu là-dedans ?" L'écho de sa voix remonta. Renart l'entend ; il redresse la tête, il appelle Hermeline une autre fois, et l'écho de recommencer à monter. Stupéfait d'entendre cette voix, Renart met les pattes dans un seau et, sans même s'en rendre compte, le voici qui descend. Vraiment, quelle fâcheuse aventure ! Une fois dans l'eau il découvre son erreur. Renart s'est fourré dans un drôle de pétrin : C'est un coup des démons ! Il se retient à une pierre, Il préférerait être à six pieds sous terre... Le malheureux souffre le martyre, Il est plus d'une fois trempé. C'est le moment de pêcher à la ligne mais personne ne pourrait le dérider. Ah ! il ne donnerait pas deux sous de son intelligence. Seigneurs, il arriva qu'au même moment, cette même nuit à la même heure, Isengrin quitta sans s'attarder une vaste lande, en quête de nourriture, pressé par une faim cruelle. De fort méchante humeur,
il s'est dirigé vers la maison des moines où il s'est rendu au triple galop. Il trouva l'endroit dévasté. "C'est le pays des démons, dit-il, puisqu'on ne peut trouver ni nourriture, ni rien à sa convenance !" Il a fait demi-tour au pas, au trot il est allé au guichet ; le voici arrivé devant le couvent au galop. Sur son chemin, il tomba sur le puits où Renart le roux prenait du bon temps. Il s'est penché au-dessus du puits, irrité, contrarié, perplexe... Soudain, il s'avise de regarder dans le puits et de contempler son reflet : plus il le voit et plus il le fixe, exactement comme l'avait fait Renart. Il crut que c'était dame Hersant qui était logée à l'intérieur du puits en compagnie de Renart. Sachez qu'il n'en fut pas heureux et qu'il dit : "Quel sort cruel que le mien ! Je suis outragé et déshonoré par la faute de ma femme que Renart le rouquin m'a enlevée et qu'il a entraînée avec lui dans ce puits. Il faut être un sacré voleur sans foi ni loi, pour traiter ainsi sa commère et je n'y peux rien ! Mais, si je pouvais l'attraper, Je m'en vengerais si bien que je n'aurais plus rien à craindre de lui." Alors, il a hurlé de toutes ses forces et, s'adressant à son ombre : "Qui es-tu ? Sale putain, putain déclarée que j'ai surprise ici avec Renart !" Il a hurlé une seconde fois et l'écho est remonté. Pendant qu'Isengrin se désolait, Renart se tenait tranquille. Il le laissa hurler un moment, puis entreprit de l'appeler : "Quelle est cette voix, mon Dieu, qui m'appelle ? De vrai, je dirige ici-bas une école. - Dis, qui es-tu ? demanda Isengrin. - C'est moi, votre bon voisin, jadis votre compère, que vous chérissiez plus qu'un frère. Mais on m'appelle feu Renart, moi qui étais maître ès ruses. - Je respire, dit Isengrin. Depuis quand, Renart, es-tu donc mort ? - Depuis l'autre jour, répond le goupil. Personne ne doit s'étonner de ma mort car de la même façon mourront tous les vivants. Il leur faudra passer de vie à trépas au jour voulu par Dieu. A présent, mon âme est entre les mains du Seigneur qui m'a délivré du calvaire de ce monde. Je vous en supplie, mon très cher compère, pardonnez-moi de vous avoir mécontenté l'autre jour. - J'y consens, dit Isengrin. Que toutes ces fautes vous soient pardonnées, compère, dans ce monde et dans l'autre ! Mais votre mort m'afflige. - Moi au contraire, dit Renart, j'en suis ravi - Tu en es ravi ? - Oui, vraiment, par ma foi. - Cher compère, dis-moi pourquoi. - Parce que, si mon corps repose dans un cercueil, chez Hermeline, dans notre tanière, mon âme est transportée en paradis, déposée aux pieds de Jésus. Compère, je suis comblé, je n'eus jamais une once d'orgueil. Toi, tu es dans le monde terrestre ; moi, je suis dans le paradis céleste. Ici, il y a des prés, des bois, des champs, des prairies. Ici, il y a d'immenses richesses, ici, tu peux voir de nombreuses vaches, une foule de brebis et de chèvres, ici, tu peux voir quantité de lièvres, de boeufs, de vaches, de moutons, des éperviers, des vautours et des faucons..." Isengrin jure par saint Sylvestre qu'il voudrait bien s'y trouver. "N'y compte pas, dit Renart. Il est impossible que tu entres ici. Bien que le Paradis soit à Dieu, tout le monde n'y a pas accès. Tu t'es toujours montré fourbe, cruel, traître et trompeur. Tu m'as soupçonné au sujet de ta femme : pourtant, par la toute-puissance divine, je ne lui ai jamais manqué de respect et je ne l'ai jamais sautée. J'aurais dit, affirmes-tu, que tes fils étaient des bâtards. Je ne l'ai pas pensé une seconde. Au nom de mon créateur, je t'ai dit maintenant l'entière vérité. - Je vous crois, dit Isengrin, et je vous pardonne sans arrière-pensée, mais faites-moi pénétrer en ce lieu. - N'y compte pas, dit Renart. Nous ne voulons pas de disputes ici. Là-bas, vous pouvez voir la fameuse balance." Seigneurs, écoutez donc ce prodige ! Du doigt, il lui désigne le seau et se fait parfaitement comprendre, lui faisant croire qu'il s'agit des plateaux à peser le Bien et le Mal. "Par Dieu, le père spirituel, la puissance divine est telle que, lorsque le bien l'emporte, il descend vers ici tandis que tout le mal reste là-haut. Mais personne, s'il n'a reçu l'absolution, ne pourrait en aucune façon descendre ici, crois-moi. T'es-tu confessé de tes péchés ? - Oui, dit l'autre, à un vieux lièvre et à une chèvre barbue en bonne et due forme et fort pieusement. Compère, ne tardez donc plus à me faire pénétrer à l'intérieur !" Renart se met à le considérer : "Il nous faut donc prier Dieu et lui rendre grâce très dévotement pour obtenir son franc pardon et la rémission de vos péchés : de cette façon, vous pourrez entrer ici." Isengrin, brûlant d'impatience, tourna son cul vers l'orient et sa tête vers l'occident. Il se mit à chanter d'une voix de basse et à hurler très fort. Renart, l'auteur de maints prodiges, se trouvait en bas dans le second seau qui était descendu. Il avait joué de malchance en s'y fourrant. À Isengrin de connaître bientôt l'amertume. "J'ai fini de prier Dieu, dit le loup. - Et moi, dit Renart, je lui ai rendu grâce. Isengrin, vois-tu ce miracle ? Des cierges brûlent devant moi ! Jésus va t'accorder son pardon et une très douce rémission." Isengrin, à ces mots, s'efforce de faire descendre le seau à son niveau et, joignant les pieds, il saute dedans. Comme il était le plus lourd des deux, il se met à descendre. Mais écoutez leur conversation ! Quand ils se sont croisés dans le puits, Isengrin a interpellé Renart : " Compère, pourquoi t'en vas-tu ?" Et Renart lui a répondu : "Pas besoin de faire grise mine. Je vais vous informer de la coutume : quand l'un arrive, l'autre s'en va. La coutume se réalise. Je vais là-haut au paradis tandis que toi, tu vas en enfer en bas. Me voici sorti des griffes du diable et tu rejoins le monde des démons. Te voici au fond de l'abîme, moi j'en suis sorti, sois-en persuadé. Par Dieu, le père spirituel, là en bas, c'est le royaume des diables." Dès que Renart revint sur terre, il retrouva son ardeur guerrière.
Tout l’intérêt du texte réside dans le détournement des Ecritures et des dogmes de la religion chrétienne selon un mode de séduction vicieuse.
Compétence réinvestie : commentaire de la stratégie de Renart (le rôle de l’éthos est ici essentiel) qui peut être d’emblée effectué par les élèves (aguerris depuis la première séance). L’immoralité en est évidente et ils ont appris à identifier la mauvaise foi, l’aplomb, la ruse et ont enrichi leur vocabulaire.
Insistance sur sa dimension séductrice, blasphématoire mais de surcroit irrationnelle. Renart fait essentiellement appel à l’imagination et à la libido d’Ysengrin.
Il serait donc opportun d’associer l’étude du texte à des recherches sur l’imagerie médiévale, religieuse ou /et profane, sa richesse, ses codes, sa visée, l’usage rhétorique qui en est fait.
Présentations d’élèves.
La réflexion sur l’autorité de la parole, du livre/Livre, peut ainsi s’enrichir d’une réflexion sur l’autorité de l’image en matière de morale.
Etape 6 : Lecture de l’extrait de Thomas d’Aquin.
Saint Thomas d’Aquin
Somme Théologique I,II
Question 71
Article 2
Le vice est-il contraire à la nature?
Objections : 1. Cela ne parait pas possible. On vient de voir que le vice est le contraire de la vertu. Mais la vertu ne nous est pas naturelle, elle est chez nous infuse ou acquise. Les vices ne sont donc pas contraires à la nature.
2. On ne peut pas s'accoutumer à ce qui est contraire à la nature : « Une pierre ne s'accoutume jamais à monter en l'air » dit Aristote. Or il y a des gens qui s'accoutument aux vices. Ceux-ci ne sont donc pas contraires à la nature.
3. Ce qu'il y a de plus commun chez ceux qui ont une nature ne saurait être contraire à la nature. Or le vice est ce qu'il y a de plus commun parmi les hommes, suivant la parole de l'Évangile (Mt 7,13) : « La route qui mène à la perdition est large, et il y passe beaucoup de monde. » Donc le vice n'est pas contre la nature.
4. D'après ce que nous avons dit, le péché se rattache au vice comme l'acte à l'habitus. Mais le péché est défini par S. Augustin comme « une parole, un acte ou un désir contraire à la loi de Dieu ». Or la loi de Dieu est au-dessus de la nature. Il vaut donc mieux dire aussi que le vice est contre la loi plutôt que contre la nature.
En sens contraire, S. Augustin affirme « Tout vice, du fait qu'il est un vice, est contraire à la nature. »
Réponse : Le vice est le contraire de la vertu, nous venons de le dire. Or la vertu consiste pour chacun à être dans les bonnes dispositions qui conviennent à sa nature, nous l'avons dit précédemment. Il faut donc appeler vice, en quelque réalité que ce soit, le fait que celle-ci est dans des dispositions contraires à sa nature. C'est bien en pareil cas qu'il y a lieu de vitupérer, ce qui fait croire, dit S. Augustin, que « le mot vitupération dérive du mot vice ».
Mais il faut remarquer que la nature d'une chose c'est avant tout sa forme, qui lui donne l'espèce. Or ce qui fait l'espèce humaine c'est l'âme raisonnable. Voilà pourquoi tout ce qui est contre l'ordre de la raison est proprement contre la nature de l'homme considéré en tant qu'homme, et ce qui est selon la raison est selon la nature de l'homme en tant qu'homme : « Le bien de l'homme, dit Denys, est de se conformer à la raison, et son mal est de s'en écarter. » Par conséquent, la vertu humaine, celle qui rend l'homme bon, et son oeuvre aussi, est en conformité avec la nature humaine dans la mesure même où elle est en harmonie avec la raison, et le vice est contre la nature humaine dans la mesure où il est contre l'ordre de la raison.
Solutions : 1. Les vertus ne sont pas causées par la nature, du moins en leur état parfait. Cependant elles nous inclinent dans le sens de la nature, autrement dit de la raison. Cicéron dit en effet que « la vertu est l'habitus qui se conforme à la raison comme naturellement ». C'est ainsi que la vertu est appelée conforme à la nature, et le vice, tout à l'opposé, contraire à la nature.
2. Le Philosophe [il s’agit d’Aristote] parle là de ce qui est contraire à la nature dans le sens où cela s'oppose à ce qui est un effet de la nature ; non en ce sens où contraire à la nature s'oppose à ce qui est conforme à la nature. C'est ainsi qu'on dit les vertus conformes à la nature en tant qu'elles inclinent à ce qui convient à la nature.
3. Il y a dans l'homme une double nature, raisonnable et sensible. Et puisque c'est par l'activité des sens que l'on parvient à celle de la raison, il y a plus de gens à suivre les inclinations de la nature sensible qu'il y en a à suivre l'ordre de la raison; car il se trouve toujours plus de monde pour commencer une chose que pour la finir. Or les vices et les péchés proviennent justement chez les hommes de ce qu'on suit le penchant de la nature sensible contre l'ordre de la raison.
4. C'est la même chose de pécher contre une oeuvre d'art et de pécher contre l'art dont elle est le produit. Or la loi éternelle est dans le même rapport avec l'ordre de la raison humaine que l'art avec l'oeuvre d'art. Aussi est-ce au même titre que le vice et le péché s'opposent à l'ordre de la raison humaine, et qu'ils s'opposent à la loi éternelle. Ce qui explique cette affirmation de S. Augustin : « Dieu donne à toutes les natures d'être ce qu'elles sont. Et elles deviennent vicieuses dans la mesure où elles s'éloignent de l'art de celui qui les a créées. »
On pourrait amener ici les élèves à réfléchir à la façon dont Thomas d’Aquin se réfère aux auteurs aussi bien profanes que religieux. Qu’est-ce que cela nous dit de l’universalité de la raison ?
On pourrait aussi profiter de la singularité formelle de ce texte pour demander aux élèves d’écrire un texte qui aurait une configuration similaire (question, objections, réponse, solutions). La question pourrait porter directement sur le statut de la parole, par exemple :
Chercher à convaincre, est-ce toujours chercher à séduire ?
A mettre éventuellement en regard avec le jugement de Renart et son plaidoyer.
Messieurs, prêtez-moi attention, vous qui avez entendu conter les aventures de Renart, et vous pourrez écouter l'histoire d'une ruse extraordinaire qui lui fut d'un grand secours. Renart le roux a réfléchi au fait qu'il est à tel point brouillé avec le roi qu'il ne pourra jamais obtenir la paix, si ce n'est en usant d'une très grande habileté.
« Sire, sire, déclare Renart, à votre égard je ne m'oppose en rien à tout ce que vous exigerez. Vous en userez avec moi selon votre bon plaisir. Je me suis rendu à votre convocation, agissez entièrement selon votre volonté. Si j'avais commis envers vous des crimes tels qu'ils devraient me valoir la mort, je me serais tenu à l'écart de vous, je n'aurais pas mis le nez hors de mon château ; tout au contraire, j'aurais attendu que l'on engage la guerre contre moi et que l'on m'assiège, car un malheur arrive toujours assez vite. Je me suis présenté devant vous de mon plein gré, tant j'ai la totale conviction d'être exempt de tout acte condamnable, et je m'en remets entièrement à votre sens de la justice.
Je vous ai servi bien souvent - puisse Dieu me venir en aide ! - avec une entière fidélité ; c'est pourquoi ce serait pour vous un total déshonneur si j'étais mis à mort sans jugement et sans motif, alors que je suis sous la protection de votre toit. Mais je sais très bien, en toute vérité, qu'il existe en vous tant de charité, bien que vous soyez puissant et redoutable, que vous êtes parfaitement juste. Même pour tous les trésors de Rome, vous ne causeriez de tort à personne. J'ai l'entière certitude, même si un mauvais sort s'acharne sur moi, que vous êtes un roi bon et loyal, que vous n'êtes pas simoniaque au point de faire subir de mauvais traitements à vos hommes en vue d'obtenir de l'or ou de l'argent. Sire, si tel est votre bon plaisir, faites taire ces aboyeurs et apaiser tout ce tapage. Après quoi, que celui qui ne voudra pas y renoncer exprime devant vous ses plaintes contre moi, et vous, de votre côté, examinez pour quelles raisons ils se plaignent, et de quel crime. Parmi ces hauts barons qui ici-même sont mes accusateurs, que chacun dise ce qu'il a envie de dire. Si je suis incapable de m'en justifier et si je ne sais pas faire la preuve de mon bon droit, alors on doit m'exhiber lié à la queue d'une vieille bête de somme. Faites-moi obtenir un procès équitable. — Voilà qui est bien parler, dit l'empereur ; par le respect que je dois à l'âme de mon père, je ne veux pas avoir la réputation d'être injuste par cupidité, ni que ma cour soit vénale ; tout au contraire, je veux être un juge loyal. Si quelqu'un a quoi que ce soit à reprocher à Renart, qu'il vienne exprimer sa plainte contre lui ; quant à Renart, il doit être bien certain que s'il est convaincu de crime à travers ces procès, il ne s'en tirera pas vivant, et il mourra d'une manière infamante. »
Isangrin bondit sur ses pieds : il est encore gonflé de colère, parce qu'il veut obtenir de Renart un serment conforme aux termes du jugement que les barons ont rendu en vue de lui faire expier son crime. Il s'approche du roi et lui dit : « Sire roi, ne soyez pas fâché si je dépose plainte à nouveau contre Renart. Vos barons avaient énoncé un jugement selon lequel il devait se justifier auprès de moi par serment de l'adultère qu'on l'a accusé d'avoir commis avec mon épouse, ce dont elle a été très sévèrement blâmée. Ce dont je me plains, c'est qu'il est allé se dissimuler dans ma tanière, qu'il a battu mes louveteaux et leur a pissé dessus, sans qu'aucun d'eux puisse jamais se venger de lui. Ce que nous savons en toute certitude, c'est qu'il est venu jusqu'au lieu du serment. Peut-être s'imaginait-il que l'affection que je lui portais irait jusqu'à lui accorder le pardon. Lorsqu'il se rendit compte qu'il ne pourrait y échapper, il sut bien vite se mettre hors de portée, et il s'enfuit se réfugier dans sa demeure. Tous les barons ici présents savent bien qu’ils ne pourraient approuver sa conduite, à moins de se déjuger entièrement. Faites donc justice pour moi de ce forfait, faites en sorte de gagner ma reconnaissance. Il est juste qu’il reçoive ce qu'il a voulu obtenir. Mais peut-être Renart est-il assez rusé, même s'il ne cherche pas querelle, pour prétendre faussement que jamais il n'a cherché à trahir. Cependant, je maintiens mon accusation pour tout ce que j'ai déclaré. Par le Seigneur qui demeure là-haut, j'agirai en tout point ainsi qu'on le voudra, selon ce qu'en décidera la cour. Je m'en rapporte à son jugement, pourvu qu'elle le rende loyalement. »
Renart répond : « Seigneur Isangrin, avez-vous tout dit ? Voulez-vous ajouter quelque chose ? » Isangrin rétorque : « J'en ai assez dit. Tout cela suffira à vous lasser, avant que vous en soyez quitte. Je n'ai rien bu aujourd'hui qui doive m'enivrer. » Renart répond : « Sire, écoutez-moi. Jugez qui de l'un ou de l'autre est dans son droit. À propos de ce dont Isangrin m'accuse, je retournerai entièrement la charge contre lui. Il est bien vrai que vous m'avez convoqué, et que par la bouche de Grimbert, vous m'avez ordonné de me présenter devant Roonel, et de me conduire selon ses recommandations. Je trouvai ensuite dans votre missive je ne sais quelle chose écrite selon laquelle, au moins pour tout ce qui relève des choses de ce monde, il me fallait prêter serment ; cela fait, je devrais être tenu pour quitte. Une fois que j’eus fini de lire la lettre, j’étais disposé à prononcer ce serment, et Roonel devait en être le garant. Je suis venu à la cour tout prêt et protégé par votre convocation, mais on aurait dû me jouer là un très mauvais tour, et je vais vous raconter comment. Lorsque j'arrivai au jour qui m'était fixé, sans excuse dilatoire ni retard, Isangrin me donna à entendre, dans l'intention de me tromper, que Roonel était mort étouffé par un os. Il était adossé à un tombeau ; c'est là, disait-on, qu'il était mort. Les barons décidèrent, à tort ou à raison, que je devais jurer sur la dent de Roonel et que je m'acquitterais ainsi de mon serment. Je ne pris absolument pas la fuite ; tout au contraire je m'avançais, bien que cette décision m'ait irrité, et je voulus prononcer mon serment, afin d'obtenir la paix aux conditions qu'ils souhaitaient. Ayant relevé mes manches, je m'avançai vers la dent ; je faillis avoir de bons motifs de me lamenter : si je ne m'étais rendu compte de rien, j'aurais été victime d'une belle tromperie. Je vis Roonel lever la tête et avoir peine à trouver son souffle. Je me rendis bien compte que l'on cherchait à me trahir bassement, et si j'ai voulu me mettre à l'abri afin de ne pas tomber entre leurs mains, personne ne doit me blâmer pour cela, car ils auraient eu tôt fait de me faire perdre conscience. On prétendait Roonel mort, mais il fût bien rapide quand il se mit à ma poursuite ! Il me suivit et malmena désagréablement, et mit en pièces ma pelisse. Sire, c'est ainsi que je fus maltraité et assailli en dépit de votre sauf-conduit. La honte est vôtre et le mal mien, tout cela à cause de votre juge, qui était déloyal. Roonel a agi ainsi par haine, à cause de ma femme, madame Hermeline, qui n'a pas voulu satisfaire son désir amoureux. L'autre jour, il y eut plainte en justice pour la honte qu'il vous a faite lorsqu'il resta ainsi étendu, la langue pendant hors de la gueule. Il vous faut faire bonne justice de lui, et le pendre plus haut que tout autre brigand. Messire Frimaux le putois et Grimbert, qui a de si bonnes manières, ont assisté à la scène, ainsi que tous les barons qui se trouvaient là et qui ont eu une conduite tout à fait loyale. S'il plaît à Dieu, ils vous diront la vérité sur cette affaire, car ils ne mentiront absolument pas en ma faveur. Tous savent très bien que je dis la vérité. Et cependant, pour obtenir la paix, je prononcerais volontiers le serment ici même devant vous et toute loyauté. Je n'aurais que faire de la guerre, car je souhaiterais que la paix règne dans ce royaume : je jurerais cette paix au plus humble de vos sujets, et je lui manifesterais les plus grands égards. Et si les barons ici présents se prononcent selon le droit, je ne me soucierais pas de plaider. J'obéirai très volontiers à leur décision, et je ne m'y opposerai en aucune manière. — Ça alors ! Par les saints de Bethléem, répond Noble en souriant, Renart, si tu dis la vérité, alors tous verront leurs biens confisqués. Si malgré mon sauf-conduit tu as été victime d’une traîtrise, je suis moi-même concerné. Seigneurs, écoutez ce que dit Renart : cette affaire requiert un examen très attentif; que ceux de la partie adverse expriment leurs plaintes. Quant à vous, examinez chaque cause avec la meilleure bonne volonté ; appliquez tout votre discernement à rendre un jugement loyal. »
Les deux textes mettent bien en lumière le caractère fallacieux de la fausse rationalité de Renart (qui ne cesse d’en appeler au droit, à la justice, à l’équité) opposée à une rationalité qui est réellement mise au service de la recherche de la vérité et suit des voies droites et rigoureuses.
Le corpus aura permis d’interroger les fondements de l’autorité de la parole et la manière dont on use de la parole d’autorité. Sujet d’essai final ? Activité d’ouverture : lancer l’élaboration d’un cahier de « lieux communs », comme à la Renaissance (avec des citations d’auteurs qui font autorité)
6) Trame de parcours