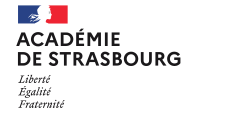Progression syntaxique 6e - 1re
Cette progression de langue a été élaborée par les professeurs membres du groupe académique de formation « La maîtrise de la langue française, un pilier de la réussite des élèves », pilote par l’Inspection pédagogique régionale. Les IA-IPR de lettres remercient vivement l’ensemble des professeurs ayant contribué à la production de cette ressource.
Cette progression se fonde sur les documents de référence actuellement en vigueur, et disponibles en ligne sur Eduscol :
- programmes d’enseignement,
- repères de progression,
- attendus de fin d’année,
- attendus de fin de cycle,
- guide fondamental Grammaire du français. Terminologie grammaticale.
Elle prend en compte les apports de la recherche en didactique les plus récents pour ce qui concerne les démarches d’enseignement et les stratégies d’apprentissage.
Présentation de la progression
La progression syntaxique suivante se donne pour ambition de permettre aux élèves de s’approprier de manière progressive la structure et le fonctionnement de la phrase, dans une logique spiralaire.
Elle est organisée en deux niveaux, qui contiennent eux-mêmes plusieurs blocs :
- LE NIVEAU DE LA PHRASELa phrase (structure, types et formes)
- La fonction sujet
- Les compléments essentiels du verbe (1) : les compléments d’objet
- Les compléments essentiels du verbe (2) : l’attribut du sujet
- L’attribut du COD (facultatif)
- Les compléments circonstanciels
- LE NIVEAU DU GROUPE NOMINAL, AU SEIN DE LA PHRASE
- La composition du GN minimal
- Les expansions du nom et du GN (1) : épithète
- Les expansions du nom et du GN (2) : complément du nom
- Les expansions du nom et du GN (3) : apposition.
Les deux niveaux de la progression peuvent être abordés en parallèle.
Chacun des blocs donne lieu à une leçon, qui peut être reprise et complexifiée, année après année. Certains blocs pourraient être abordés conjointement (les différents compléments d’objet, voire le sujet et les compléments essentiels, les différentes expansions du nom et du GN, par exemple).
A côté de cette progression autonome, on intègre à la progression thématique l’étude de la morphologie verbale, de l’orthographe et du lexique, en tenant compte du niveau réel et des besoins des élèves, et en tissant des liens avec les textes lus et avec les activités d’écriture et d’oral proposées.
Principes didactiques :
- Cette progression propose une approche qui va de la macro-structure (la phrase ; le groupe nominal) à la micro-structure (les blocs fonctionnels qui constituent la phrase ; les mots ou groupes de mots qui occupent une fonction d’enrichissement au sein du groupe nominal). Dans le cadre de l’analyse de la phrase, les fonctions essentielles sont abordées avant les fonctions facultatives. Dans le cadre de l’analyse du groupe nominal, le groupe nominal minimal est abordé avant les expansions qui l’enrichissent.
- Pour que les élèves s’approprient le fonctionnement de la phrase, dans la perspective de mieux lire et de mieux s’exprimer à l’écrit et à l’oral, et pour éviter la confusion fréquente entre les fonctions et les natures, on aborde dans un premier temps les fonctions, en insistant sur les opérations linguistiques qui permettent de les circonscrire, avant d’étudier les natures grammaticales en tant que réalisations possibles d’une fonction donnée dans la phrase. Si l’on revient chaque année sur les opérations qui permettent de discriminer les fonctions, on aborde progressivement des réalisations de plus en plus variées et complexes de ces fonctions.
- Point de vigilance : l’approche syntaxique, fondée la démarche manipulatoire (voir ci-dessous, « Démarche à privilégier »), ne doit pas conduire à un abandon de la dimension sémantique, mais cette dernière ne saurait constituer le critère d’identification premier et discriminant. Il va de soi, en revanche, que la question du sens des phrases étudiées et produites est au cœur de la réflexion sur la langue (construction et sens d’un verbe, lien de sens entre le sujet et l’attribut du sujet, nuances sémantiques des compléments essentiels et circonstanciels, relation entre grammaticalité et sens, etc.)
Démarches à privilégier :
- Dans la mise en œuvre de l’enseignement de la langue, on focalise prioritairement l’attention des élèves sur des régularités et des exemples prototypiques, en visant un apprentissage fréquentiel. Les cas rares ou particuliers peuvent être envisagés par la suite, à la faveur de la progression des élèves.
- On ritualise un protocole d’analyse grammaticale fondé sur le recours aux opérations linguistiques, que l’on verbalise et que l’on explicite de manière systématique. Ainsi, on permet aux élèves de développer des compétences métalinguistiques et des automatismes. Pour s’approprier le système de la langue, il est en effet essentiel que les élèves soient en mesure d’expliciter leur raisonnement et de le confronter à ceux de leurs pairs. À ce titre, les activités de reformulation et la négociation entre pairs gagneront à trouver toute leur place dans les classes.
- L’enseignement de la langue doit, par ailleurs, se déployer sur un temps long, favorable au développement des automatismes : dans la mesure où cette progression repose sur un petit nombre d’unités d’enseignement (ou blocs), l’on pourra y passer du temps, et y revenir régulièrement, notamment sous la forme de rituels quotidiens sur un temps très court (analyse de phrases, écritures de phrases en respectant des contraintes grammaticales, par exemple).
- Les différentes étapes permettant de s’approprier les notions de langue :
- Le travail sur des corpus de phrases, élaborés par l’enseignant en fonction des besoins de la leçon, constitue une modalité d’enseignement efficace. Constitués de phrases sélectionnées ou créés au regard des objectifs de la leçon et adaptées au niveau des élèves, les corpus permettent au professeur de faire découvrir les manipulations syntaxiques à privilégier pour chaque fonction (au moins deux par fonction). Le travail sur corpus permet en effet aux élèves d’observer, de manipuler et de réfléchir sur la langue pour en déduire des protocoles d’analyse pertinents ; le professeur peut aussi choisir de présenter ces protocoles, en guise de modélisation. Au fil du temps, les occurrences des corpus deviennent de plus en plus complexes.
- On privilégiera une trace écrite courte et opératoire : il ne s’agit pas de rédiger une longue leçon théorique sur chaque notion abordée, mais bien de faire figurer dans le cahier des élèves les opérations linguistiques à privilégier et les protocoles d’analyse à mettre en œuvre pour circonscrire une fonction ; la trace écrite précisera également les différentes réalisations possibles d’une même fonction (les natures). Cette trace écrite peut prendre la forme d’un texte court ou d’une carte mentale, construits avec les élèves.
- Des exercices fréquents et variés, notamment sous la forme de rituels, permettent aux élèves d’automatiser les apprentissages.
- On veille à réinvestir fréquemment les notions de langue abordées, au service des autres domaines de l’enseignement du français (la lecture, l’écriture et l’oral).
- Progression syntaxique 6e - 1re(pdf, 240 Ko)