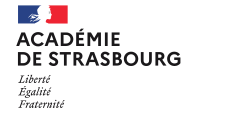Carrière
STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES
LES DROITS ET LES OBLIGATIONS
Ces notions sont en adéquation avec la compétence "Agir en fonctionnaire de l'Etat et de façon éthique et responsable" (BO N°29 du 22 juillet 2010).
Principaux droits Les principaux droits sont :- liberté d'opinion politique, syndicale, philosophique ou religieuse,
- droit de grève,
- droit syndical,
- à la formation permanente
- droit de participation
- rémunération après service fait,
- droit à la protection (voir la circulaire B8 n°2158 du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l'État)
Droits à la protection
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, article 11 Les fonctionnaires et les agents non titulaires ont droit à une protection et le cas échéant à une réparation lorsqu'ils ont fait l'objet, à l'occasion de leurs fonctions, de menaces, d'outrages, de voies de fait, d'injures ou de diffamations. Ils ont droit à une protection, dans certaines circonstances, en cas de poursuites pénales et civiles engagées par un tiers pour faute de service.Secret professionnel
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, article 26 Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. Les fonctionnaires sont donc tenus au secret professionnel visé par le code pénal en tant que dépositaires de renseignements concernant ou intéressant des particuliers à moins que les nécessités du service ou des obligations légales ne leur imposent la communication des informations dont ils ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction. Cette disposition a pour objet de protéger les intérêts matériels et moraux des particuliers. L'obligation n'est pas absolue. La révélation des secrets acquis est parfois permise, voire même obligatoire. Elle est permise notamment :- pour prouver son innocence,
- lorsque la personne intéressée a donné son autorisation.
- dénonciation de crimes ou délits dont un fonctionnaire a connaissance dans l'exercice de ses fonctions (Art 40 du code de procédure pénale),
- communication de renseignements, pièces et documents aux autorités de justice agissant en matière criminelle ou correctionnelle,
- témoignage en justice en matière criminelle ou correctionnelle (Art 109 du code de procédure pénale),
- communication au juge administratif saisi d'un recours contre un acte administratif ou au juge judiciaire saisi d'un litige des pièces et documents nécessaires au jugement de l'affaire.
Obligation de discrétion professionnelle d'information au public
Loi n° 83.634 du 13 juillet 1983, article 26 ... "Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent."Obligation d'information au public
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, article 27. "Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect des règles mentionnées à l'article 26 loi du 13/07/83 ". Par ailleurs, la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée par la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dispose que "le droit de toute personne à l'information est garanti en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif". Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. Les modalités d'application de cette loi ont été précisées par une circulaire FP n° 1430 du 5 octobre 1981.
Obligation d'effectuer les tâches confiées
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, article 28. " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés."Obligation d'obéissance hiérarchique
Loi n°83.634 du 13 juillet 1983, article 28 Le fonctionnaire "doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public." Le refus d'obéissance équivaut à une faute professionnelle. La subordination hiérarchique impose également de se soumettre au contrôle hiérarchique de l'autorité supérieure compétente et de faire preuve de loyauté dans l'exercice de ses fonctions. Le devoir d'obéissance impose enfin au fonctionnaire de respecter les lois et règlements de toute nature.Obligation de réserve
Le principe de neutralité du service public interdit au fonctionnaire de faire de sa fonction l'instrument d'une propagande quelconque. La portée de cette obligation est appréciée au cas par cas par l'autorité hiérarchique sous contrôle du juge administratif. L'obligation de réserve est une construction jurisprudentielle complexe qui varie d'intensité en fonction de critères divers (place du fonctionnaire dans la hiérarchie, circonstances dans lesquelles il s'est exprimé, modalités et formes de cette expression). C'est ainsi que le Conseil d'Etat a jugé de manière constante que l'obligation de réserve est particulièrement forte pour les titulaires de hautes fonctions administratives en tant qu'ils sont directement concernés par l'exécution de la politique gouvernementale. A l'inverse, les fonctionnaires investis d'un mandat politique ou de responsabilités syndicales disposent d'une plus grande liberté d'expression. La réserve n'a pas trait uniquement à l'expression des opinions. Elle impose au fonctionnaire d'éviter en toutes circonstances les comportements portant atteinte à la considération du service public par les usagers.Régime du cumul d'activités dans la fonction publique
Loi du 13 juillet 1983 modifiée par la loi du 3 août 2009 (art. 25)Décret du 2 mai 2007
Circulaire du 11 mars 2008
Formulaire de demande d'autorisation de cumul Soumis à un principe d’exclusivité, leur interdisant l’exercice d’une activité professionnelle hors de leur emploi dans l’administration, les agents publics peuvent toutefois bénéficier de certaines dérogations. Ce régime de cumul d’activités, qui concerne les fonctionnaires, les agents non titulaires et les ouvriers, a été réformé en 2007. Tout en maintenant l’interdiction de cumul avec une activité privée lucrative, la nouvelle réglementation a assoupli les possibilités de dérogation pour l’exercice d’activités accessoires, soumises à autorisation, et ouvre ces possibilités aux agents à temps partiel. Les agents à temps complet ou incomplet (jusqu’à 70%) continuent à bénéficier d’un dispositif de cumul moins contraignant. Par ailleurs, dans le cas du cumul d’activités à caractère public, le montant des rémunérations perçues n’est plus plafonné. En outre, les agents publics peuvent désormais créer ou reprendre une entreprise en restant dans l'administration, ou bien poursuivre une activité dans une entreprise lorsqu'ils deviennent agents publics : cette nouvelle dérogation, d'une durée de deux ans renouvelable une fois pour une durée d'un an, soit trois ans au maximum, est soumise à l'avis de la commission de déontologie. En exerçant ce cumul, l'agent peut rester à temps plein ou demander un temps partiel de droit.
La liste des activités a été rénovée par le décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011 et adaptée aux évolutions économiques et sociales et aux aspirations des agents publics : élargissement de la liste des activités accessoires aux activités sportives et de loisirs, possibilité expressément ouverte de recourir au régime de l’auto-entrepreneur, simplification de la procédure devant la commission de déontologie. Dans le respect du fonctionnement normal du service public.
STATUT ET MISSIONS DU CONSEILLER PRINCIPAL D'EDUCATION
Les responsabilités des conseillers principaux s'inscrivent dans la perspective de la mission éducative de l'établissement scolaire. Tout adulte membre de la communauté scolaire, à quelque titre que ce soit, participe à cette mission par les responsabilités qu'il exerce (pédagogie, administration, entretien, gestion, documentation, orientation, animation culturelle, etc...). L'ensemble des responsabilités exercées par les conseillers d'éducation se situe dans le cadre général de la "Vie scolaire" qui peut se définir ainsi : placer les adolescents dans les meilleures conditions de vie individuelle et collective et d'épanouissement personnel.
Interlocuteurs privilégiés, chaque fois qu'il est question de l'organisation et du déroulement de la vie quotidienne, notamment en ce qui concerne les rythmes scolaires, ils organisent la vie collective, hors du temps de classe, en étroite liaison avec la vie pédagogique de l'établissement. Ils assument les contacts avec les élèves sur le plan individuel et collectif. L'exercice de ces responsabilités exclut le travail individualiste et se situe dans un contexte de relation, d'échanges et de prise on charge en commun de l'activité éducative. L'ensemble de responsabilités exercées par le conseiller d'éducation et le conseiller principal doit toujours être assuré dans une perspective éducative et dans le cadre global du projet d'établissement.
Textes de références
Création du corps des CPE
- Décret n°70-738 du 12 août 1970 :Décret relatif au statut particulier des conseillers principaux d’éducation.
Textes de référence instituant les missions du CPE
La circulaire du 10 août 2015 La circulaire de 1972 sur les missions du CPE Circulaire no 82-482 du 28 octobre 1982. Rôle et conditions d'exercice de la fonction des conseillers d'éducation et des conseillers principaux d'éducation Extraits: L’ensemble de responsabilités exercées par le conseiller d’éducation et le conseiller principal doit toujours être assuré dans une perspective éducative et dans le cadre global du projet d’établissement. Ces responsabilités se répartissent en trois domaines : - Le fonctionnement de l’établissement : responsabilité du contrôle des effectifs, de l’exactitude et de l’assiduité des élèves, organisation du service des personnels de surveillance, mouvements des élèves. Il participe, pour ce qui le concerne, à l’application des mesures propres à assurer la sécurité, notamment des élèves. - La collaboration avec le personnel enseignant : échanges d’informations avec les professeurs sur le comportement et sur l’activité de l’élève : ses résultats, les conditions de son travail, recherche en commun de l’origine de ses difficultés et des interventions nécessaires pour lui permettre de les surmonter ; suivi de la vie de la classe, notamment par la participation au conseil des professeurs et au conseil de classe, collaboration dans la mise on oeuvre des projets. - L’animation éducative : relations et contacts directs avec les élèves sur le plan collectif (classes ou groupes) et sur le plan individuel (comportements, travail, problèmes personnels) ; foyer socio-éducatif et organisation des temps de loisirs (clubs, activités culturelles et récréatives) ; organisation de la concertation et de la participation (formation, élection et réunions des délégués élèves, participation aux conseils d’établissement). Dans ces trois domaines, l’action éducative du conseiller d’éducation et du conseiller principal d’éducation implique le dialogue avec les parents ou toutes personnes qui assument des responsabilités à l’égard de l’adolescent, collaboration nécessaire en vue de permettre à ce dernier de se prendre on charge progressivement. BO n° 37 du 19 octobre 1989 Modification du décret n°70-738 du 12 août 1970 portant statut particulier des conseillers principaux et conseillers d’éducation Extrait: ARTICLE 4 – Sous l’autorité du chef d’établissement et éventuellement de son adjoint, les conseillers principaux d’éducation et les conseillers d’éducation exercent leurs responsabilités éducatives dans l’organisation et l’animation de la vie scolaire, organisent le service et contrôlent les activités des personnels chargés des tâches de surveillance. Ils sont associés aux personnels enseignants pour assurer le suivi individuel des élèves et procéder à leur évaluation En collaboration avec les personnels enseignants et d’orientation, ils contribuent à conseiller les élèves dans le choix de leur projet d’orientation.D'autres documents proposent des réflexions sur la fonction de CPE voire précisent des orientations.
Ces documents n'ont aucune valeur juridique.
Note d'information de l'EN sur "La fonction de conseiller d'éducation et conseiller principal d'éducation", juillet 1996 Le métier de CPE aujourd'hui quelques repères, Mars 2006 Conseiller principal d’éducation. Un métier au cœur des enjeux sociaux. CEREQ, Juin 2007 CPE. Métier en redéfinition permanente. CEREQ, Septembre 2007EVALUATION DU CONSEILLER PRINCIPAL D'EDUCATION
- Définition des compétences à acquérir par les conseillers principaux d’éducation pour l’exercice de leur métier.
Arrêté du 1er juillet 2013
LE TEMPS DE TRAVAIL
L'aménagement du temps de travail.
L'Arrêté du 4 septembre 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 précise les cycles de travail des personnels d’éducation des établissements publics d’enseignement du second degré relevant du ministère de l’éducation nationale. le temps de travail effectif des personnels d’éducation se répartit, dans le respect de la durée annuelle de référence de 1 600 heures prévue à l’article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, sur une période comprenant : - la totalité de l’année scolaire définie à l’article L. 521-1 du code de l’éducation susvisé ; - dans le cadre de leurs missions, un service d’été d’une semaine après la sortie des élèves et d’une semaine avant la rentrée des élèves et un service de petites vacances ne pouvant excéder une semaine. A cela s'ajoute la journée de solidarité qui s'élève à 7h. La durée hebdomadaire de travail est fixée à 40 heures 40 minutes, dont 4 heures hebdomadaires laissées sous la responsabilité des agents pour l’organisation de leurs missions.Le service à temps partiel.
Le décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l’État, publié au Journal officiel de la République française du 10 août 2002 ouvre la possibilité, à tous les fonctionnaires, agents non titulaires et personnels ouvriers de l’État, de travailler à temps partiel sur une base annuelleLe congé de formation.
Les CPE qui souhaitent compléter leur formation en vue de satisfaire des projets professionnels ou personnels peuvent bénéficier d'un congé de formation professionnelle. Le site du service-public.fr en présente les contours.ASTREINTES DES PERSONNELS LOGÉS PAR NÉCESSITÉ ABSOLUE DE SERVICE
Extraits Article 1 : Les temps d'astreinte des personnels d'éducation logés par nécessité absolue de service ne donnent pas lieu à compensation. Article 2 : Le temps d'intervention pendant l'astreinte donne lieu à récupération ; celle-ci s'opère au plus tard dans le trimestre suivant l'accomplissement de cette intervention sous réserve des nécessités du service. Les conditions et le niveau de cette récupération sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Pour consulter l'intégralité du décret
GRILLES DE REMUNERATION
| Échelon | Durée de l’échelon au grand choix | Durée de l’échelon au choix | Durée de l’échelon à l’ancienneté | IM | Salaire brut mensuel |
|---|---|---|---|---|---|
| 11ème | ... | ... | ... | 658 | 3 046,73 € |
| 10ème | 3 ans | 4 ans et 6 mois | 5 ans et 6 mois | 612 | 2 833,74 € |
| 9ème | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 567 | 2 625,38 € |
| 8ème | 2 ans et 6 mois | 4 ans | 4 ans et 6 mois | 531 | 2 458,68 € |
| 7ème | 2 ans et 6 mois | 3 ans | 3 ans et 6 mois | 495 | 2 291,99 € |
| 6ème | 2 ans et 6 mois | 3 ans | 3 ans et 6 mois | 467 | 2 162,35 € |
| 5ème | 2 ans et 6 mois | 3 ans | 3 ans et 6 mois | 453 | 2 097,52 € |
| 4ème | 2 ans | 2 ans et 6 mois | 2 ans et 6 mois | 431 | 1 995,65 € |
| 3ème | ... | ... | 1 an | 410 | 1 898,42 € |
| 2ème | ... | ... | ... | ||
| 1er | ... | ... | ... |
Suite à la réforme de la masterisation, les nouveaux CPE intègrent directement l’échelon 3 (cf. Décret n°2010-1605 du 21 décembre 2010, article 2)
CPE Hors classe Peuvent accéder à la hors-classe de leur corps tous les agents de classe normale ayant atteint au moins le 7ème échelon de la classe normale. Le Bulletin Officiel N°47 du 21 décembre 2006 en fixe les modalités.| Échelon | Durée de l’échelon | IMIMIndice majoré | Salaire brut mensuel |
|---|---|---|---|
| 7ème | ... | 783 | 3 625,52 € |
| 6ème | 3 ans | 741 | 3 431,05 € |
| 5ème | 3 ans | 695 | 3 218,05 € |
| 4ème | 2 ans et 6 mois | 642 | 2 972,65 € |
| 3ème | 2 ans et 6 mois | 601 | 2 782,81 € |
| 2ème | 2 ans et 6 mois | 560 | 2 592,96 € |
| 1er | 2 ans et 6 mois | 495 | 2 291,99 € |
Guide des services pour gérer votre carrière.
SIAM pour déposer votre demande de mutation inter-académique et/ou intra-académique et suivre votre demande
SIAC pour vous inscrire aux concours qui vous intéressent et consulter vos résultats.
GAIA pour consulter le plan académique de formation et le calendrier des formations.
SIAD pour vous informer sur le détachement.
SIAT pour saisir votre demande de mutation dans les COM.